 par Thierry Pech, entretien avec Danielle Kaisergruber
par Thierry Pech, entretien avec Danielle Kaisergruber
Quelles sont les ruptures françaises ? Economiques et sociales ? Générationnelles ? Territoriales ? Comment y répondre ? Alors que nous avons perdu « le fil de notre histoire sociale » quitte à nous réfugier dans le roman national, les inégalités les plus prégnantes semblent être dans nos rapports à l’avenir. Thierry Pech, directeur général de Terra Nova, apporte un regard éclairé sur ces problématiques.
–
Nous avons eu dans la rédaction de Metis des interrogations et des discussions sur « l’état de la société française », sous la forme « quelles sont les fractures les plus significatives actuellement » ou bien « combien de France(s) y a-t-il » ? Les fractures sont-elles surtout économiques et sociales ? Des « classes populaires » qui s’opposeraient à des « classes moyennes » ? Des salariés en emploi stable qui s’opposeraient à des « précaires » de tout type (y compris travailleurs indépendants, autoentrepreneurs…) ? Des « Français de souche » qui s’opposeraient à des « devenus Français » ? Qu’en pensez-vous ?
Je pense que chacune des propositions énoncées a sa part de vérité. Et, d’une certaine façon, toutes les sociétés sont divisées et hétérogènes. Nous nous berçons de l’idée d’un paradis perdu qui n’a jamais existé. La société française des Trente glorieuses était elle-même très conflictuelle : conflits de classes dans une société encore très industrielle et où l’espérance révolutionnaire était bien vivante, conflits de générations qui ont éclaté au grand jour en mai 68, conflits de répartition sur les dividendes de la croissance, etc. La société française vivait également des déchirements culturels majeurs : déclin du monde paysan et de la pratique catholique, transformation des structures familiales, progressive émancipation des femmes… Tout cela ne s’est pas passé dans la joie et la bonne humeur. La France des villages, des paroisses, des petits commerces, des familles traditionnelles, des petits propriétaires fonciers comptait de nombreux perdants.
Mais il y avait une dynamique collective de progrès nouée autour d’un pacte implicite aux termes duquel, en échange de leur subordination au travail, de leur discipline de consommation et de leur docilité politique, on promettait aux Français, y compris aux classes populaires, la sécurité professionnelle, des droits sociaux toujours plus ambitieux, un accès élargi à l’éducation, des gains de pouvoir d’achat et un imaginaire d’abondance sans fin. « L’appartement témoin » de cette dynamique de progrès, c’étaient les classes moyennes salariées, celles dont le sociologue Henri Mendras avait théorisé la centralité et le leadership social.
C’est cette dynamique qui s’est rompue à la fin du XXe siècle et au début du XXIe. Si on regarde la société comme un plan cadastral, on peut repérer toutes sortes de fractures qui en témoignent (statutaires, économiques, territoriales, sanitaires, etc.), mais c’est un exercice sans fin où chacun met l’accent sur ce qui lui paraît le plus préoccupant ou ce qui l’arrange. Je crois qu’il faut aussi regarder la société comme un récit collectif. Et là, ce qui apparaît, c’est que nous avons perdu le fil de notre histoire sociale. Les tendances observables prennent presque toutes à revers le contrat implicite qui avait fait notre cohésion dans la seconde moitié du XXe siècle : la quête de flexibilité et l’incertitude économique ont puissamment développé la précarité ; le taux de croissance a atterri autour de 1,4 % en moyenne décennale au début du XXIe siècle, étouffant bien des espoirs de redistribution ; les progrès de l’éducation se heurtent aux terribles constats de Pisa ; l’imaginaire d’abondance se fracasse sur les réalités écologiques…
Face à cette cascade de déconvenues, certains trouvent refuge dans le roman national et le culte de quelques mantras identitaires qui ne résoudront rien. D’autres, dans le procès des boucs émissaires, à commencer par celui de l’Europe. D’autres encore dans un malthusianisme à visage humain qui essaie d’imaginer les conditions du bien-vivre dans un monde où le travail et la croissance seraient durablement appelés à se raréfier. Mais ce qui me frappe, c’est qu’il y a finalement peu de réflexions et de discours politiques qui pointent nos propres insuffisances et qui nous responsabilisent collectivement face à ce qui nous arrive.
Il va de soi que la notion de « classe » n’est sans doute plus appropriée dans son sens ancien (marxiste au départ). D’ailleurs, dans votre dernier livre qui vient de paraître, Insoumissions Portrait de la France qui vient, vous signalez que seuls 6 % des personnes se reconnaissent dans le terme « classe ouvrière », pour 65 % dans le terme « classe moyenne ». Comment peut-on penser tout cela, sachant qu’il s’agit bien de repérer, décrire, un ensemble de gens ayant des caractéristiques communes en termes de revenu, de patrimoine, de position dans les hiérarchies professionnelles et donc d’espérance de carrière ou de parcours, de réussite scolaire pour les enfants, et peut-être de « culture » et de « mode de vie » ?
Le débat sur le « retour des classes sociales » a fait couler beaucoup d’encre chez les sociologues ces quinze dernières années. Après deux décennies d’éclipse, cette question est revenue sur le tapis au début des années 2000. Et les géomètres du social se sont évertués à délimiter de nouvelles parcelles sur le plan cadastral dont je parlais tout à l’heure. Je crois qu’il n’y a aucun doute sur le fait que la société française est traversée par d’importantes distances de classe, non seulement en termes de revenus, de patrimoines et de qualification, mais aussi en termes de subordination. Il faut dire les choses comme elles sont : elle est toujours composée de dominants et de dominés… Mais il ne fait hélas pas beaucoup de doute non plus que la dimension subjective des classes sociales a, elle, largement périclité.
Essayons cependant de regarder les choses en dynamique, encore une fois. Ce qui me frappe dans le grand catalogue des inégalités actuelles, c’est la prégnance et le caractère très structurant des inégalités de rapport à l’avenir. Il y a d’importantes différences de statut et de crédit social entre ceux qui maîtrisent leur avenir et ceux qui ne voient pas à deux semaines… Tout en haut, on a les hyper-compétitifs, très qualifiés, à l’aise dans la mondialisation et qui ont les moyens de voir loin. En dessous, ceux qui sont protégés par un statut, l’appartenance à une grande structure ou des barrières à l’entrée sur leur marché, ce qui leur assure une certaine stabilité. A côté, ceux qui s’en sortent convenablement ou à peu près, mais qui ont des raisons de redouter l’avenir, qui vivent dans la peur de perdre ou de « dévisser ». Et tout en bas, ceux qui sont en grande difficulté et qui n’ont malheureusement pas beaucoup de raisons de penser que leur avenir pourrait s’améliorer à court ou moyen terme. Ces perceptions de l’avenir pour soi-même délimitent des ensembles sociaux assez distincts. Ils sont bien sûr très schématiques et ne forment nullement des « classes » au plein sens du terme, mais les frontières qui les séparent rendent compte d’expériences très différentes de la vie en société. Ils renvoient en outre à des enjeux de justice sociale : à qui donne-t-on sa chance ? à qui la refuse-t-on ?
Les fractures sociales sont-elles aussi – ou d’abord – territoriales ? Les banlieues vs les centres-villes « gentrifiés », les métropoles vs les zones périurbaines, les villes vs les campagnes ?
Oui, les questions territoriales ont pris une importance croissante, y compris dans la façon dont les gens se situent eux-mêmes dans la société. C’est en partie l’effet d’un puissant processus de métropolisation de l’activité : les métropoles sont plus que jamais les poumons de notre économie. Dans une enquête récente réalisée par Terra Nova et Jobijoba, on a constaté qu’en 2015, sur un échantillon de plus de 6 millions d’offres d’emplois, entre la moitié et les deux tiers étaient localisées dans les Villes-centres des grandes aires urbaines françaises. C’est du jamais vu. Surtout que, dans le même temps, la population a tendu à se « périurbaniser » : un nombre croissant de Français en quête de logements abordables et de contexte de socialisation favorables pour leurs enfants, se sont éloignés, non seulement des centres-villes où les prix du logement sont souvent dissuasifs, mais des beaux quartiers de première couronne et des Zones urbaines sensibles. On voit donc se dessiner une typologie territoriale assez marquée. Les représentations que l’on en a sont souvent caricaturales, mais les caricatures finissent par façonner des rapports sociaux caractérisés par des passions plus ou moins aigres : les « bobos » de centre-ville, les « bourgeois pas bohèmes » des belles banlieues (ceux qui ont voté Fillon aux primaires de la droite et du centre), les jeunes des « cités », les oubliés de la « France périphérique »…
C’est important, car selon l’analyse que l’on fait de la société, de ses fractures et de ses tensions, on peut être amené à proposer et mettre en œuvre des politiques publiques et des mesures différentes. Peut-on se contenter de proposer à chacun des outils individuels de construction de son parcours et de son destin ?
Se contenter, certainement pas. Mais faire davantage dans cette direction, sûrement ! On a longtemps pensé, dans notre pays, que les individus ne pouvaient être aidés qu’à travers des collectifs – l’entreprise, la branche professionnelle, la famille, etc. – et que, pour cette raison, les droits sociaux devaient être attachés pour l’essentiel à la relation d’emploi, voire au statut d’emploi. En France, l’émancipation des individus a été pensée à partir de ces collectifs et de l’action de l’Etat. C’est l’héritage de la conjonction tapageuse d’une tradition corporatiste et d’une forte culture jacobine. Mais les étals sur lesquels reposait ce modèle se sont considérablement affaiblis : la grande entreprise intégrée de type fordiste a décliné, les relations d’emploi se sont fragilisées, le sentiment d’appartenance à des collectifs s’est affaibli… Les structures de la société civile étaient souvent trop faibles pour prendre le relai. Résultat : notre « modèle social » protège les individus de façon de plus en plus sélective. Les standards sociaux n’ont pas grand-chose à voir dans les grandes entreprises et dans les petites, chez les donneurs d’ordre et chez leurs sous-traitants… Si l’on veut que les filets de l’Etat social soient moins sélectifs, il faut, je crois, attacher les droits aux personnes et accompagner davantage les individus en tant que tels. Cela n’empêche pas, par ailleurs et dans le même temps, de renforcer les collectifs qui peuvent l’être, à commencer par le collectif de travail en donnant plus de poids à la négociation et au contrat.
Si l’on caractérise les « classes populaires contemporaines » par leur représentation d’une forme de « séparation » : il y a « eux » (les élites, plus largement ceux qui réussissent, ceux qui ont des positions sociales de pouvoir, ceux qui voyagent de par le monde…) et il y a « nous » (les « petits » comme le disent certains partis, les « sans grades », les « périphériques »…), que faut-il proposer pour ce deuxième et très large groupe ? Historiquement, les classes populaires se sont toujours retrouvées dans le « nous on n’est pas comme ça ». Comment s’adresser à ces personnes d’une part et comment d’autre part leur permettre de faire entendre une voix, en dehors des jours d’élections ?
Les classes populaires méritent bien leur pluriel ! Car elles sont très hétérogènes, en réalité. Si l’on considère cet ensemble, non seulement à partir des CSP « ouvriers » et « employés », mais aussi à partir d’un critère de revenu (en gros, la moitié basse de la distribution), on s’aperçoit qu’il y a au moins deux mondes : celui des « subalternes non démunis », comme disent les sociologues, et celui des « subalternes démunis ». Les premiers sont relativement intégrés dans l’emploi et participent à la consommation de masse ; les seconds sont dans une forme plus ou moins permanente d’instabilité et souvent relégués dans les quartiers d’habitat social. Non seulement ces deux mondes diffèrent « objectivement », mais ils s’approchent rarement l’un de l’autre, voire se fuient. La distance sociale « objective » (revenus, patrimoine, qualifications…) entre eux et le reste de la société est souvent plus grande que celle qui les sépare l’un de l’autre, mais l’antagonisme qui marque leurs relations peut être assez intense. Les uns soupçonnent ainsi volontiers les autres d’assistanat, de contestation plus ou moins sourde des valeurs républicaines, etc. Honnêtement, aujourd’hui, je ne suis pas sûr qu’il y ait une politique qui soit capable de satisfaire également les mondes populaires. Mais il est certain que l’une des conditions pour détendre ces rapports sociaux et résorber le déficit d’intégration sociale des plus démunis, c’est un recul significatif du chômage et de sa menace.
Vous observez très justement que les catégories populaires n’ont pas de visibilité sociale et n’acquièrent une visibilité politique que lors des élections (on pourrait rajouter essentiellement par le vote FN). Ces mêmes catégories ne sont pas ou très peu représentées dans les partis politiques. En 2012, il y avait un ouvrier à l’Assemblée, 6 % de « catégories intermédiaires » alors que ces deux groupes représentent 67 % des actifs. Qui plus est, on ne les retrouve pas non plus dans les organisations syndicales ni dans les ONG ou l’associatif. « En somme ce sont presque toujours les mêmes qui participent, se syndiquent, militent et s’engagent dans la société civile », dites-vous. Alors que faire ?
Si j’avais la réponse, je ne l’aurais pas gardée pour moi ! Il faut être modeste face à ces difficultés. Mais enfin, une chose est sûre : il faut commencer par écouter, par aller frapper aux portes. Ensuite, il faut raconter les réalités vécues, les faire connaître et reconnaître. Ce n’est pas seulement la responsabilité des acteurs politiques et des militants. C’est aussi la responsabilité des médias, des cinéastes, des artistes… Dans une société démocratique, le travail de la représentation est aussi et peut-être d’abord un travail de figuration collective. Chacun doit y prendre sa part. De ce point de vue, se contenter de faire le procès de la classe politique a quelque chose d’infantile.
Vous décrivez des « insoumissions » : ceux qui veulent travailler, mais en échappant à la relation de subordination dans le salariat, à l’organisation bureaucratisée et souvent stupide des grandes entreprises, les consommateurs qui choisissent des modes de consommation alternatifs, les citoyens qui recherchent de nouvelles formes de démocratie. Ces insoumissions sont plurielles, elles se recoupent parfois, mais forment-elles des groupes, des communautés autres qu’éphémères ?
Non, elles ne forment pas des groupes très cohérents. J’y insiste dans mon livre. Elles tirent même dans des directions parfois opposées. Des différentes formes d’insubordination qui agitent le monde du travail monte une demande d’autonomie. Tandis que des formes d’insoumissions politiques monte parfois une demande d’ordre, de sécurité et d’autorité. Mais, quelle que soit leur orientation, je ne crois pas que ce soient des mouvements éphémères : ce sont plutôt des réponses encore désordonnées – et pour certaines dangereuses – à des dysfonctionnements structurels de notre contrat social.
A propos du travail, l’émergence de nouvelles formes d’emploi et de nouvelles manières de travailler (travail indépendant, co-working, makers…) est-elle plutôt un souhait ou une nécessité ?
C’est la combinaison de deux séries de facteurs : des facteurs exogènes liés aux transformations du capitalisme, d’une part, et des facteurs plus endogènes liés aux mutations culturelles de notre société d’autre part. Mais la littérature sociologique et les médias ont ces dernières années surtout insisté sur les premiers. Ils s’expliquent l’érosion de la « société salariale » par la quête d’une plus grande flexibilité et d’une plus grande mobilité des facteurs de production en général dans un contexte d’incertitude, d’exposition croissante à la concurrence internationale et de financiarisation de l’économie. Tout cela est vrai et a sérieusement entamé les contreparties attendues par les travailleurs en termes de sécurité, de stabilité, etc. Mais on a moins commenté les mutations culturelles qui sont à l’oeuvre aujourd’hui et qui se combinent aux transformations du capitalisme pour éloigner un nombre croissant d’actifs de la conception traditionnelle du travail. La hausse tendancielle du niveau de formation de la main-d’oeuvre couplée à des attentes d’épanouissement plus fortes au travail, ainsi qu’à une intériorisation de la norme d’autonomie des individus, tout cela contribue à valoriser des situations d’activité où l’on est davantage son propre maître et où l’on voit davantage le produit de son effort. D’où ce paradoxe : le prestige social de l’entrepreneur – véritable mythologie contemporaine de la réussite individuelle – a souvent pour revers le dépérissement du prestige de l’entreprise comme organisation intégrée et hiérarchisée. Un nouvel idéal du travail désaliéné est en train de se diffuser dans la société et les organisations collectives sont loin d’être prêtes à affronter cette transformation.
Pour en savoir plus :
– Thierry Pech, Insoumissions Portrait de la France qui vient, Seuil 2017
– Metis, Danielle Kaisergruber, « Pavillons, les pièges du péri-urbain », à propos du livre d’Anne Lambert Tous propriétaires. L’envers du décor pavillionnaire, Seuil, 2015
– Thomas Allaire, Jérémie Bureau, Anne-Julie Le Serviget, Thierry Pech, « Le marché du travail dans les grandes aires urbaines en 2015 », rapport de Terra Nova et Jobi-Joba, 10 février 2016







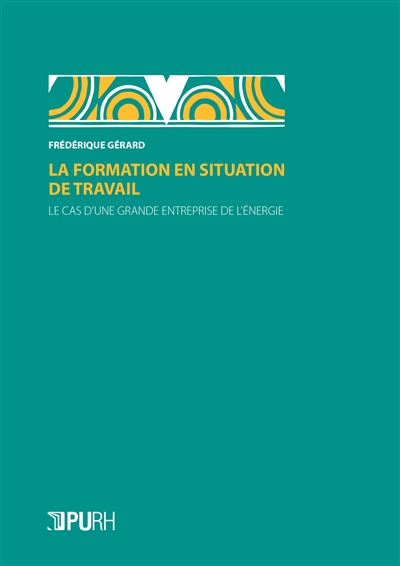
Laisser un commentaire