par Thierry Le Guellec, propos recueillis par Odile Chagny
Comment les entreprises appréhendent-elles l’effet de l’automatisation et de la robotisation sur l’emploi, l’organisation du travail ? La question des compétences et des stratégies de formation va devenir un enjeu central pour les entreprises dans le contexte de la transformation digitale. Thierry Le Guellec conseille les représentants du personnel au sein du cabinet Secafi. Il nous livrait en avril 2018 ses clefs de lecture de l’impact de l’automatisation et de la robotisation au travers des missions qu’il mène, en particulier dans l’industrie automobile.

Pour mesurer l’impact de la transformation digitale sur l’emploi, on mobilise souvent une grille d’analyse du risque d’automatisation des différentes tâches d’un métier, en mettant en avant le fait que de plus en plus de tâches cognitives et non routinières sont concernées par le risque d’automatisation. Qu’évoque pour vous cette approche ? Quelle est votre grille de lecture ?
Cette approche un peu mécaniste laisse supposer qu’il y aurait une « rationalité du chemin ». Or ce que l’on constate, c’est que les entreprises raisonnent d’abord en termes de décision stratégique d’investissement, et de retour sur investissement : quels sont les moyens pour investir ? Pour rentabiliser l’investissement ? Pour l’optimiser ? L’impact de ces investissements sur l’organisation du travail est vu et traité de manière globale et systémique. Plus qu’une approche atomisée métier par métier, ce sont donc l’ensemble des interactions entre métiers, l’enchaînement des activités, mais aussi les rôles à tenir par les titulaires des différents emplois qui sont appréhendés.
L’optimisation des équipements a toujours été une constante dans les entreprises. Le problème nouveau apporté par la transformation numérique est que la complexification et la variété des technologies utilisées supposent effectivement de bien coordonner l’ensemble des interactions entre métiers.
Il en résulte que l’on assiste à une sorte de recherche de solutions un peu improvisée, de bricolages organisationnels visant à répondre aux nouveaux besoins de compétences, aux besoins de compétences rares, ou encore aux insuffisances de compétences.
On met souvent en avant les gains de productivité massifs pouvant être obtenus avec le déploiement de l’usine du futur. En juin 2017 par exemple, une étude de l’Alliance Industrie du Futur (AIF), du Cercle de l’Industrie, du Conseil National de l’Industrie (CNI) et du Groupe des Fédérations Industrielles (GFI) montrait que l’on pouvait multiplier par quasiment 3 le « retour sur investissement » par une diminution de 50 % de la main-d’œuvre directe et de 30 % des indirects. Comment les gains de productivité se manifestent-ils ?
Au niveau industriel, la digitalisation des entreprises passe par une variété de solutions et de technologies de plus en plus pointues. Les investissements, le déploiement des solutions et technologies sont progressifs, planifiés, et étalés, par exemple sur une période de 4-5 ans.
Les gains de productivité sont donc très loin d’être immédiats. Parce que les investissements réalisés une année n sur l’une des machines ou sur l’automatisation du flux d’approvisionnement génèrent des nouvelles contraintes, de nouveaux problèmes, de nouvelles interactions, parce que les machines sont aussi de plus en plus complexes. Tout cela entraîne des investissements en termes de compétences, génère de nouveaux emplois, suppose des réaménagements d’emploi à court terme. Et du fait de la réorganisation des espaces de travail, du réaménagement des postes de travail, des rôles, des investissements en termes de compétences, se glissent toute une série de biais entre l’investissement et la productivité escomptée. Ce n’est qu’une fois que les procédés, les process, l’organisation et les métiers seront bien en place et optimisés que les gains de productivité se manifesteront.
Cela ne veut pas dire que ponctuellement on n’observe pas de gains « directs » de productivité. Mais cela dépend du type de technologie et du degré de maîtrise de cette technologie. Dans la plasturgie par exemple, quand des presses sont mises en place, les gains sont automatiques : on supprime le poste d’opérateur, ne reste plus que la maintenance.
Mais ce qui est observable au niveau d’une seule technologie l’est beaucoup moins dès lors que les investissements sont plus complexes sur le plan technologique, ou encore au niveau de l’assemblage d’un ensemble de machines, c’est-à-dire d’une ligne de production. Car l’écosystème de la ligne repose sur la maîtrise de plusieurs technologies, l’interaction de plusieurs acteurs, et suppose de réaménager le contenu du travail, les postes, ainsi que les interactions entre les différents métiers.
Vous venez d’évoquer le fait que l’automatisation et la robotisation amènent des investissements majeurs en termes de compétences. Pourriez-vous développer ?
Un moyen pratique d’illustrer l’équation emploi-compétences est de prendre l’exemple des différents postes clefs sur une ligne de production : le conducteur de ligne, le cariste, le technicien de maintenance.
Le conducteur de ligne
Une évolution symptomatique de ce poste est que l’on parle de plus en plus de pilote de ligne, et non plus de conducteur de ligne. Avec la complexification et le coût élevé des lignes, le raccourcissement des séries, il est nécessaire pour le conducteur de maîtriser des process complexes et variés. Il doit aussi optimiser les temps, orienter la maintenance, avoir une réactivité forte. Le pilote est donc chargé de veiller de manière permanente au bon fonctionnement de la ligne de production, de ses machines, d’opérer un premier niveau d’intervention en cas de problème. Et il est également attendu sur sa capacité de coopération avec les différents autres métiers censés intervenir sur la ligne de production pour la fluidité, l’accélération de la maintenance de la ligne de production par exemple. Le pilote de ligne devient en quelque sorte le « garant de la ligne ». Il organise les interactions autour des machines. Ce poste évolue alors dans le sens d’une qualification plus accrue en lien avec l’augmentation des responsabilités et des attentes par rapport à son rôle. On parle par exemple beaucoup du développement du rôle de « leader » dans les milieux de la production, et non plus de celui de « chef d’équipe ».
Il en résulte une évolution des profils attendus, d’ouvriers qualifiés vers des profils de techniciens (Bac +2), là où auparavant on avait surtout beaucoup de Bac pros (ouvriers).
Le cariste et l’opérateur de ligne
L’automatisation dans l’approvisionnement des chaînes de production, avec le déploiement des AGV (les véhicules à guidage automatique) a pour effet la disparition de l’emploi de cariste. On pourrait penser qu’il en résulte des gains de productivité à court terme. Mais, en fait, la chaîne logistique s’enrichit d’un nouvel emploi d’approvisionneurs de chaîne, uniquement consacrée à cette tâche, de sorte qu’avec l’optimisation des lignes de production, l’opérateur de production, qui va intervenir sur la ligne soit vraiment en capacité d’intervenir en cas de besoin. Et ces postes d’approvisionneurs de chaîne ont une qualification plus basse que les caristes, et sont considérés comme dévalorisants. Car contrairement aux caristes, qui nécessitent un vrai savoir-faire sur la conduite d’un chariot ou d’un transpalette, aucune certification professionnelle ne leur est associée.
Les programmateurs
À côté de cela se développent de nouveaux métiers de programmateurs de l’AGV et des machines. Il faut bien intégrer cette étape de programmation de la machine, puisque désormais ce sont les logiciels d’« ERP » qui vont planifier la chaîne de bout en bout, depuis l’achat des composants jusqu’à la livraison des produits finis.
On assiste ainsi à un mouvement souvent décrit dans la littérature managériale, d’explosion en deux branches d’un métier certifié et qualifié : d’un côté le métier d’approvisionneur, déqualifié, de l’autre un métier plus qualifié (Bac +2) de programmateur.
Tout cela est quand même assez contradictoire avec ce qui peut se dire sur l’élévation des qualifications grâce à la digitalisation, et montre bien que l’automatisation ne génère pas automatiquement la disparition d’emplois, mais les transforme.
Les opérateurs de production
Enfin, s’agissant des opérateurs de production, on va désormais attendre d’eux non pas forcément plus de responsabilité, mais plus de compétences élargies, de poly-compétences. On va leur demander par exemple d’intervenir sur d’autres machines que les leurs, d’autres lignes de production que les leurs avec d’autres technologies, d’autres process. Les postes d’opérateurs vont sans doute peu à peu disparaître au profit des postes de techniciens de production, avec à la clef une polyvalence et une poly-compétence plus importante.
Et cette montée en polyvalence est d’autant plus importante que la nécessité d’allonger la durée d’utilisation des équipements se renforce avec l’automatisation.
Les techniciens de maintenance industrielle
Enfin, on assiste aussi à une rareté de plus en plus marquée des profils de maintenance, en particulier en automatisation et robotisation, alors même que le développement et le déploiement et la maintenance d’équipements à forte valeur ajoutée entraînent de nouvelles questions sur le recours aux prestataires externes.
Cette rareté a, on le sait, plusieurs causes. La maintenance est une filière de formation à part entière, pour laquelle il y a eu une baisse des effectifs dans les filières de formation, alors même que l’on constate un manque d’appétence des jeunes pour ces filières. Il en résulte une compétition féroce sur certains marchés locaux du travail, et une compétition salariale.
On voit bien que l’automatisation redistribue les cartes dans les qualifications, dans la hiérarchie des qualifications et donc dans les grilles de classification et de salaires qui y sont accolées, et que cela va devenir un problème de gestion des ressources humaines à part entière. Pourriez-vous nous donner votre vision de l’impact que tout cela peut avoir en termes de « compromis social » ?
Sur certains métiers, la question de l’investissement salarial va se poser assez crûment, en particulier pour la maintenance, comme je viens de l’évoquer.
L’automatisation et la robotisation rebattent les cartes au niveau du management, de la structuration des équipes de travail et, d’une manière générale, de la qualité des relations de travail et de la qualité de vie au travail (la « QVT »). Et la qualité de vie au travail va probablement devenir un enjeu important de la fidélisation des salariés, des compétences et des ressources critiques et/ou stratégiques.
Le compromis salarial va devoir s’élaborer sur le salaire, la qualité de vie au travail et la capacité à se former. Or les statistiques de formation dont nous disposons montrent que les temps de formation sont de plus en plus réduits parce que justement la formation va contre la productivité, puisque lorsque l’on forme on continue à rémunérer la personne en formation et qu’il faut de surcroît payer un intérimaire.
La question de la stratégie de formation va dans ce contexte devenir centrale. Cela va faire jouer la capacité des entreprises à pallier les déficiences de certaines compétences en envoyant en formation parfois sur des blocs de compétences plus que des certifications complètes et homogènes d’un seul tenant. La formation va devenir essentielle aussi en termes de fidélisation.
En résumé, il va falloir que les entreprises réfléchissent vraiment à leurs compétences en place, un point que manifestement beaucoup d’entreprises françaises ont laissé en friche depuis quelques années… et qu’elles s’intéressent au développement de leurs compétences en lien avec les compétences déficientes ou insuffisantes.
Typiquement se pose la question de l’évolution des métiers : à quelles conditions un technicien de production ou conducteur de machine peut-il par exemple devenir technicien maintenance ou technicien process ? À quelles conditions un technicien process peut-il devenir technicien de maintenance ? Cela va-t-il être permanent ?
Cela nous ramène de nouveau à la question de l’organisation du travail, et au fait qu’une fois de plus que cela va entraîner une série d’arbitrages, de réflexions, de bricolages, de réaménagements en cascade.
Le compromis social doit faire la part belle à tous ces paramètres : qualité de vie au travail, stratégie de formation, capacité à former et identifier les compétences, passerelles entre compétences, moyens de formation, accompagnement des personnes formées. En d’autres termes, le compromis social est et doit forcément être systémique.
– Cette interview, réalisée en avril 2018, est également disponible sur le Medium de Sharers & Workers –






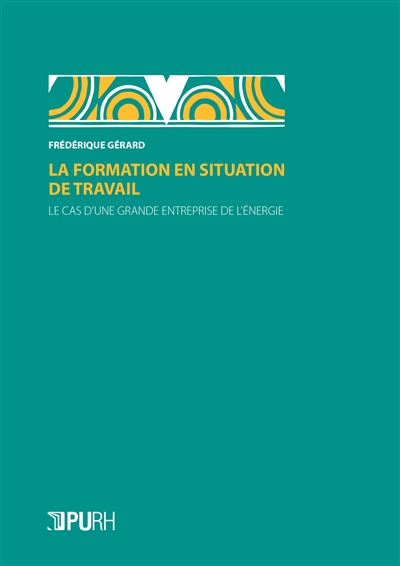

Laisser un commentaire