Les partenaires sociaux, à l’appel du MEDEF, à l’exception de la CGT, ont entrepris une évaluation « autonome » des dispositions relatives à la formation professionnelle et à l’apprentissage, de la loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » du 5 septembre 2018 qui devait être le « big bang » de la formation. Jean-Marie Luttringer en fait une analyse juridique et conceptuelle.
Les signataires de cette évaluation s’inscrivent, sans la mettre en cause dans la philosophie de cette loi. Ils considèrent « qu’elle a posé les bases d’une transformation profonde du système. Parmi les principaux objectifs (…), la valorisation de la voie professionnelle et le développement de l’apprentissage constituent, en termes quantitatifs, une réussite indéniable dont se félicitent les partenaires sociaux. Il en va de même pour le recours individuel au droit à la formation professionnelle puisque les actifs, salariés comme demandeurs d’emploi, sont de plus en plus nombreux à consulter et mobiliser leur compte personnel de formation (CPF) (…). Il s’agit cependant de ne pas s’arrêter aux constats, mais de questionner ce qu’ils impliquent et d’évaluer les autres aspects de la réforme avec la même exigence. Sur un certain nombre de points en effet, des progrès restent à faire pour convaincre les entreprises et les salariés de s’investir conjointement dans le développement des compétences. Sur ces sujets, l’importance du dialogue social tant dans les entreprises que dans les branches doit être soulignée. Dans le cadre des entreprises, le CSE constitue un interlocuteur privilégié. La crise sanitaire et économique du Covid-19 a aussi mis en évidence le manque d’accompagnement des salariés et des entreprises face aux évolutions profondes et rapides des métiers et face aux transitions à l’œuvre, quelle que soit la nature de ces dernières. »
La plupart des 49 propositions des signataires ont pour objectif « d’accompagner, de mobiliser, d’informer, de simplifier, de clarifier, d’encourager, de valoriser, de réinterroger… » Toutefois, à y regarder de plus près, les propositions relatives au financement, à la gouvernance, et au CPF font apparaître des enjeux de nature juridique qui sont loin d’être anodins.
La CGT qui a décliné l’invitation du MEDEF a remis à la ministre du Travail son propre diagnostic et ses préconisations. Elle rejette en bloc aussi bien les fondements philosophiques de la réforme de 2018 que les dispositifs juridiques et financiers qui en sont issus.
« La négociation de 2018 s’est engagée dans un contexte particulier où le nouveau président conduisait à marche forcée une série de réformes remettant profondément en cause le droit du travail et le modèle social français construit par des décennies de luttes. Comme la loi l’exige, il a été proposé aux organisations syndicales et patronales d’engager une négociation sur la formation professionnelle, mais il leur a fixé, dans son document d’orientation, des objectifs si contraignants que la négociation s’est trouvée dès le départ largement vidée de son sens. Les ressources financières que redistribue France compétences sont aujourd’hui considérées par l’administration comme étant de nature fiscale. La CGT s’est toujours opposée à ce principe, car les sommes collectées sont générées par le travail des salariés, calculées sur un pourcentage de la masse salariale et destinées à la formation des salariés. Elles devraient être considérées à ce titre comme du salaire socialisé et conférer aux salariés et à leurs représentants un droit d’intervention sur leur utilisation ».
Identifions quelques-unes des questions que soulève la traduction juridique des 49 préconisations faites par les partenaires sociaux dans le rapport de juillet 2021 et notamment :
- La nature et la qualification juridique des ressources allouées à la formation professionnelle et à l’apprentissage ;
- L’accès des salariés à la formation entre prescription et libre choix ;
- L’introuvable gouvernance du système de formation professionnelle et d’apprentissage.
C’est quoi les « cotisations formation » ?
Tous les acteurs du système de formation professionnelle partagent le constat d’un sous-financement de la réforme de 2018. Étonnamment, les préconisations en vue de construire un modèle économique viable, qui englobe toutes les étapes de la formation tout au long de la vie, se concentrent principalement sur la question des ressources financières. Or, ce modèle économique repose sur la combinatoire entre trois catégories de ressources que sont, certes, les ressources financières, au demeurant d’origine très diverse, mais également le temps, et les ressources pédagogiques.
Le temps passé en formation pose la question du revenu de remplacement qui représente de l’ordre de deux tiers du budget de la nation consacrée à cette activité. Lorsque la formation et assimilée à un temps de travail effectif, ce revenu est pris en charge par l’employeur. Cependant, certaines formations, notamment les formations longues de reconversion, ne sauraient relever dans tous les cas et exclusivement de cette qualification et de ce régime juridique (Chronique 144 « 50 nuances du temps de formation »). Le recours à un possible compte épargne temps affecté à la formation, débattu à l’occasion de la réforme de 2009[1] ne semble pas faire partie des préoccupations actuelles des partenaires sociaux. Il le mériterait pourtant vu dans le temps long de la formation tout au long de la vie qui peut conduire de nombreux actifs à changer de métier, à leur initiative ou non, au cours de leur vie. (Voir dans Métis le dossier « Changer de vie (professionnelle) ? »)
Quant aux ressources pédagogiques, le texte des partenaires sociaux s’inscrit dans la nouvelle définition de l’action de formation issue de la réforme de 2018. Il prend acte de la diversification des ressources disponibles (notion de parcours, alternance, formation en situation de travail, formations en ligne, micro formations…) et encourage leur usage.
Les propositions relatives au financement se rattachent à plusieurs qualifications et régimes juridiques fondés sur le principe de solidarité et celui de responsabilité.
Quid de la solidarité nationale, de branche ou interprofessionnelle ?
Au nom du principe de solidarité nationale, les partenaires sociaux demandent aux pouvoirs publics de contribuer au financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage par le recours au budget de l’État et des régions ainsi qu’au Plan de relance. Ni la création de ces ressources, ni leur volume, ni leur affectation, ni leur gestion ne relèvent de leur compétence. En revanche, en raison du fait qu’elles sont destinées à financer la formation professionnelle des salariés il est légitime que les partenaires sociaux puissent faire connaître leur avis dans le cadre de procédures de concertation.
Au nom du principe de solidarité au niveau interprofessionnel entre toutes les entreprises du secteur privé, les partenaires sociaux demandent aux pouvoirs publics de maintenir la « contribution fiscale » mise à la charge des entreprises par le code général des impôts au bénéfice des salariés et des apprentis.
Cette ressource relève de la qualification juridique de « contribution fiscale de toute nature. » Son régime juridique est fixé par le Code du travail. Le fait que cette ressource soit collectée à partir de 2022 par l’URSSAF ne modifie pas sa qualification juridique. Les sommes ainsi collectées conservent leur qualification juridique originelle et sont transférées à France compétences qui les redistribue aux OPCO. Ces derniers en assurent la gestion dans le cadre strict de dispositions réglementaires et sous le contrôle les pouvoirs publics.
Le principe de solidarité peut également s’exprimer au niveau des branches professionnelles grâce à l’exercice par les partenaires sociaux « du droit des salariés à la négociation collective de la formation professionnelle et de leurs garanties sociales ». La qualification ainsi que le régime juridique des ressources instituées par voie d’accord de branche ne sauraient être assimilés à une contribution de nature fiscale. Elles relèvent du droit privé. Leur volume, leur affectation et leur gestion relèvent de la sphère d’autonomie des partenaires sociaux au même titre que les retraites complémentaires ou de la contribution gérée par l’APEC au bénéfice des cadres. Ces Cotisations sont gérées au seul bénéfice des salariés relevant du champ d’application de l’accord collectif de travail qui les a institués. Les partenaires sociaux font mention de cette ressource dans plusieurs de leurs propositions sans pour autant en préciser le régime juridique.
La CFE-CGC, en revanche, va plus loin dans cette voie (interview de Jean-François Foucard). Elle préconise, en effet, de compléter la contribution fiscale fixée aujourd’hui à 1,68 % de la masse salariale par une cotisation obligatoire de 0,32 % ce qui permettrait d’atteindre l’objectif de 2 % de la masse salariale composée d’un socle fiscal contrôlé par la puissance publique et d’un régime complémentaire géré en toute autonomie par les partenaires sociaux au niveau des branches.
Au-delà de cette cotisation obligatoire, la CFE CGC propose que les branches professionnelles qui ont identifié des besoins de qualification et/ou de reconversion instituent pour une durée déterminée des cotisations permettant d’assurer le financement des besoins identifiés, dans leur champ d’application professionnel ou territorial.
Qui est responsable de quoi ?
Il y a lieu de distinguer responsabilité pénale, responsabilité contractuelle et responsabilité sociale des entreprises (RSE). La responsabilité pénale, d’ordre public, concerne notamment les formations à la sécurité. Elle échappe à la compétence des partenaires sociaux.
En revanche ils sont légitimes à exercer à travers le droit des salariés à la négociation collective leur pouvoir normatif pour encadrer la responsabilité contractuelle de l’employeur et du salarié. L’une des propositions s’inscrit dans cette logique rappelant que l’entretien professionnel, au demeurant rendu obligatoire par la loi, est un outil pertinent pour favoriser l’accès des salariés à la formation.
Au titre de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) les partenaires sociaux reconnaissent qu’il appartient aux entreprises de financer sur leurs fonds propres une partie des formations nécessaires à leur bon fonctionnement et au développement des compétences des salariés. Toutefois, ils demandent aux pouvoirs publics de mettre en place une incitation fiscale pouvant prendre la forme d’un crédit d’impôt, pour encourager les entreprises à s’acquitter de leur responsabilité.
De la même manière, ils proposent une incitation fiscale au bénéfice du salarié qui utilise son CPF pour une transition professionnelle.
Petit détour historique : la théorie du salaire socialisé
La CGT, qui ne fait confiance ni aux employeurs ni à l’État, propose néanmoins de revenir à une contribution de nature fiscale, de 1, 6 % de la masse salariale, tout en rappelant la promesse de la loi fondatrice de 1971 de faire évoluer progressivement cette contribution à 2 % de la masse salariale.
La proposition de la CGT fondée sur la théorie du salaire socialisé se distingue radicalement de celle des signataires de l’évaluation du 20 juillet. Selon la définition proposée par le site WIKIROUGE « Le salaire socialisé est une partie du salaire qui n’est pas versée directement au salarié, mais prélevée sur son salaire brut sous forme de cotisations sociales, et redistribuée à lui ou d’autres travailleurs sous forme de prestations (assurance-chômage, assurance-maladie, retraite, formation professionnelle) ». Le principe est de financer un pot commun de sécurité sociale, répondant aux besoins de chacun. La distinction entre cotisations patronales et salariales est purement artificielle selon cette théorie de même que le caractère fiscal ou social de cette contribution. Elle est le produit du travail des salariés et doit par conséquent leur revenir. C’est à leurs représentants qu’il appartient d’en assurer la gestion.
La CGT ne dit rien sur la traduction juridique et institutionnelle de sa proposition :
- Gestion paritaire de cotisations sociales avec le patronat sans intervention de l’État ? Une conception réformiste défendue notamment par André Bergeron ancien secrétaire général de Force Ouvrière pour qui : « le paritarisme s’oppose à la conception marxiste-léniniste de la lutte des classes. On y gère ensemble entre gens qui s’opposent par ailleurs ».
- Gestion directe par des organisations « satellites » créées à cet effet par les organisations syndicales de salariés sous la forme de mutuelles
- Syndicalisme de services au bénéfice des adhérents sur le modèle de la gestion de l’assurance-chômage en Belgique ou dans les pays scandinaves ?
- Ou encore dans la recherche d’un équilibre entre le capital et le travail, création de « chambres du travail » gérées par les seules organisations syndicales de salariés, à l’image des chambres de Commerce et d’industrie (CCI) gérée sous contrôle des organisations patronales ? Ce modèle mis en place en Allemagne par la république de Weimar, en réponse au mouvement des conseils ouvriers, après la révolution de 1918, existe toujours en Autriche au Luxembourg et dans quelques Länder allemands (la Sarre, Bremen).
L’apprentissage : formation initiale, formation d’insertion, ou formation tout au long de la vie ?
Dans une contribution de la revue Droit social (octobre 2021) consacrée au 50e anniversaire du droit de la formation professionnelle et de l’apprentissage, Jean-Pierre Willems souligne que la loi de 2018 a véritablement révolutionné l’apprentissage en libéralisant les conditions de sa production, tout en garantissant un financement par l’État du dispositif. Le succès quantitatif de la réforme pose la question de son avenir. Si un retour en arrière paraît peu probable, trois voies semblent praticables : le recentrage du dispositif sur les premiers niveaux de qualification pour concentrer les moyens sur les jeunes les plus en difficulté, la réallocation de moyens (y compris ceux du système éducatif) vers l’apprentissage pour en faire une véritable voie massive d’éducation et enfin la généralisation de l’apprentissage comme moyen privilégié d’accès à la qualification et à l’emploi à tout âge, dans le cadre de la formation tout au long de la vie.
Ceci suppose une clarification préalable des choix stratégiques. Si la qualification juridique du système d’apprentissage est celle d’une voie de formation professionnelle initiale, il appartient à la solidarité nationale d’en assurer le financement. S’il évolue vers une modalité de formation professionnelle tout au long de la vie (n’est-il pas déjà ouvert aux salariés jusqu’à 30 ans révolus…), l’allocation des ressources reposera nécessairement sur une responsabilité partagée entre la collectivité publique, l’entreprise et les apprentis qui ne seraient plus des jeunes dont l’éducation repose sur la gratuité. Par ailleurs, on ne pourra pas s’exonérer d’une réflexion sur l’intérêt que représente la coexistence du contrat d’apprentissage et du contrat de professionnalisation.
Ces scénarios n’apparaissent guère dans les propositions des partenaires sociaux. Si l’hypothèse d’un nouvel Accord devait se concrétiser, un chapitre sur les nouveaux fondements juridiques du système de formation professionnelle en alternance dont l’apprentissage, et de son financement serait bienvenu.
L’accès des salariés à la formation entre prescription et libre choix
Selon le modèle idéal type, l’engagement de toute personne adulte, quel que soit son statut, dans un parcours de formation reposerait sur le principe du libre choix de la formation, car « on ne forme pas une personne, elle se forme si elle y trouve un intérêt ». La personnalisation du droit de la formation engagée depuis plusieurs années en France et dont le CPF est une traduction emblématique, repose sur ce postulat. Mais la vie professionnelle ne correspond pas toujours pour les salariés à ce modèle. Ils sont tout à la fois soumis à des obligations de formation imposée par l’employeur pour des raisons d’ordre public de sécurité ou de santé, et pour des raisons d’évolutions technologiques. En effet le contrat de travail entraîne des obligations de formation au bénéfice du salarié à la charge de l’employeur ainsi que l’obligation pour le salarié de suivre une formation prescrite par l’employeur.
C’est dans ce contexte juridique que le modèle idéal type du libre choix cherche peu à peu sa place.
La CGT dans son diagnostic et ces préconisations considère que la situation de subordination juridique dans laquelle se trouve le salarié est incompatible avec le principe de libre choix de la formation. Elle n’accorde guère de crédit au CPF et demande le retour au congé individuel de formation, à son mode de financement et à sa gestion paritaire, garantis par la loi.
Les partenaires sociaux dans leur évaluation de 2021, en revanche, se félicitent du développement du CPF. Ils demandent que les formations qui relèvent d’une obligation à la charge de l’employeur ne soient pas éligibles. Ils rappellent l’existence de dispositifs d’accompagnement : le conseil en évolution professionnelle et l’entretien professionnel dans l’entreprise. On remarquera que rien n’est dit sur l’extension de l’abondement correctif aux entreprises occupant moins de 50 salariés qui n’auraient pas respecté les obligations légales d’entretien professionnel, de bilan de parcours et de formation. Par ailleurs le libre choix trouve ses limites dans la référence à une certification professionnelle obligatoire en principe pour le financement du CPF.
Pour l’essentiel les partenaires sociaux se prononcent en faveur du développement du mécanisme de financement fondé sur un socle fiscal égal pour tous et d’abondements « ciblés ». Ce mécanisme permet de construire un moyen terme entre la prescription par l’employeur et « la liberté de choisir » du salarié, grâce à la possibilité de bénéficier d’un abondement.
Gouvernance : qui a le pouvoir sur la formation ?
La formation professionnelle et l’apprentissage sont des enjeux de pouvoir dans la sphère publique, au niveau national et régional, ainsi que dans la sphère de l’entreprise. La loi de 2018 a procédé à un renforcement du pouvoir sur la formation de la sphère publique et a maintenu en l’état le pouvoir sur la formation dans l’entreprise.
La notion de gouvernance a progressivement colonisé l’univers de la formation professionnelle dans la dernière décennie. Ce concept n’a guère de portée juridique. Il constitue « un habillage soft » du pouvoir sur le système de formation professionnelle qui s’exprime à travers l’allocation des ressources, le droit d’accès des personnes à la formation ainsi que la reconnaissance juridique des acquis de la formation.
À travers les propositions relatives au pilotage et à la gouvernance les partenaires sociaux demandent davantage de pouvoir au sein de France compétences, établissement public administratif caractérisé par le principe de spécialité. Il serait contre nature pour une structure juridique de ce type d’adopter un processus de décision paritaire. En tout état de cause le dernier mot appartiendra toujours à la puissance publique. Ainsi les préconisations des partenaires sociaux relatives à la gouvernance de France compétences ne modifient en rien l’équilibre du pouvoir de décision sur la formation.
Le renforcement du rôle de la puissance publique dans la régulation et la gestion du système de formation professionnelle réduit ipso facto la compétence des partenaires sociaux. Tel est le cas de la mission de régulation confiée à France compétences, établissement public administratif, des OPCO placés sous le contrôle étroit des pouvoirs publics, du service public de conseil et d’orientation professionnelle confié aux conseils régionaux, de la gestion du CPF et des autres comptes gérés au sein du CPA par la Caisse des dépôts et consignations (Chronique 162), établissement public sui generis placé sous la surveillance du Parlement.
Par ailleurs, les ressources affectées au financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage ont pour l’essentiel un caractère public, qu’il s’agisse du budget de l’État, ou encore de la contribution mutualisée due par les entreprises dont la qualification juridique est celle de « contributions fiscales de toute nature ».
Côté entreprises : sauf à introduire par la loi une obligation juridique de codécision dans ce domaine entre l’employeur et les représentants du personnel, le pouvoir de décision demeurera entre les mains du chef d’entreprise. Les obligations et les incitations à négocier, qu’il s’agisse d’un accord GPEC ou d’un accord formation laissant à l’employeur la liberté de conclure, et, s’il décide de conclure, de fixer les limites du pouvoir qu’il consent à partager.
En conclusion
Il est peu probable que l’évaluation des partenaires sociaux et celle engagée par le Parlement débouchent sur une loi au cours du premier trimestre 2022. Peut-être la question redeviendra-t-elle d’actualité durant le prochain quinquennat ?
À ce stade, à l’exception d’une opposition frontale exprimée par la CGT à la philosophie de la réforme de 2018, les 49 préconisations des partenaires sociaux signataires du texte du 20 juillet 2021 s’inscrivent dans une perspective d’appropriation et de mise en œuvre de cette réforme.
La question déterminante demeure celle du modèle économique de la formation tout au long de la vie et de l’apprentissage, que la réforme de 2018 a renvoyé à des temps meilleurs. Ce temps est désormais venu. Aux contorsions comptables autour d’une contribution fiscale, devra se substituer une réflexion stratégique qui seule permettra de déterminer ce qui relève de la solidarité nationale, de la solidarité professionnelle et interprofessionnelle, des entreprises, ainsi que de la responsabilité personnelle de chaque actif.
Pour en savoir plus
Voir la version longue de cet article sur le site de Jean-Marie Luttringer (Chronique 164)
[1]. « Opportunité et faisabilité d’un compte épargne formation » éditions DEMOS 2008. Sous la direction de Jean-Marie Luttringer. Compte rendu d’un colloque organisé au Sénat par le cabinet Circé consultant.








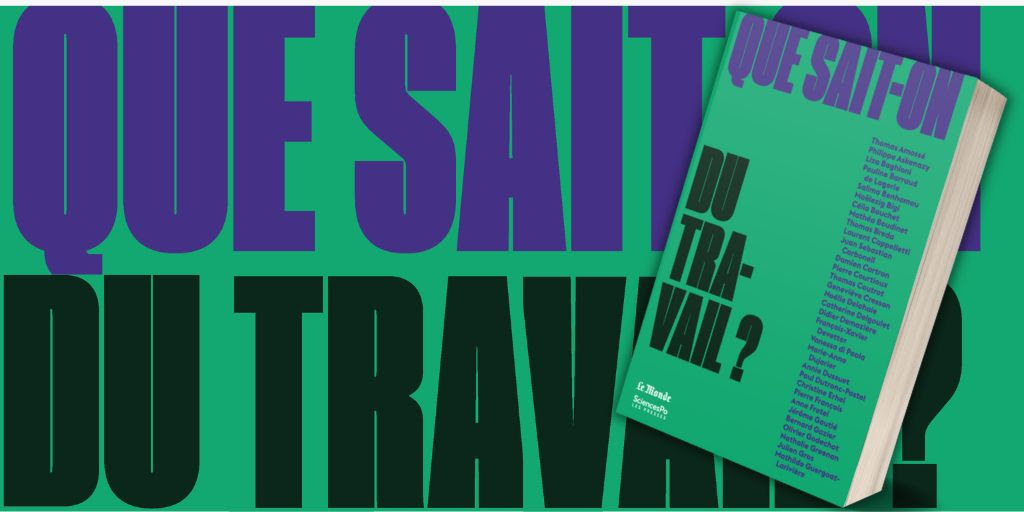
Laisser un commentaire