 par Robert Salais
par Robert Salais
Il est décidément difficile de vouloir occuper deux chaises à la fois, celle de l’homme politique, celle de l’universitaire. On remplit mal deux fonctions qui ne répondent pas aux mêmes objectifs, ce qui les réduit au plus petit dénominateur commun, le registre de la rhétorique. Mais qu’y a-t-il dessous ? Des faits, des propositions à la hauteur des enjeux, le vide ? Le lecteur ne peut que se poser la question face au livre de Yanis Varoufakis.

Le livre se lit bien, le style est haut en couleur et l’entrecroisement de la « grande histoire » et de l’histoire personnelle, familiale et politique, réussi. C’est un témoignage à retenir. Le problème est que la « grande histoire » est certes présente, mais n’est un peu trop souvent que de la « petite histoire », superficielle et de court terme ; du coup les propositions politiques ne convainquent pas, car elles méconnaissent les spécificités de la crise du projet européen. Nous ne sommes plus dans les années 1930. La crise est plus que financière et elle est de surcroît abordée du point de vue américain – ce qui est surprenant pour l’ancien ministre grec, moins peut-être pour le professeur d’une université américaine : à la fois trop optimiste et pas vraiment pertinent. A quel Européen peut-on faire croire en 2016 qu’il est possible de résoudre la crise de la zone euro (donc de l’Europe) sans changer la conception de l’euro et certaines des règles constitutives de l’Union européenne ? C’est pourtant l’ambition de la « modeste proposition » faite avec Holland et Galbraith. La situation terrible aujourd’hui du peuple grec est le produit direct des vices fondateurs de l’euro et du marché unique. Euro et marché unique ont plongé les peuples européens dans la globalisation et la libéralisation financière. Avec eux la démocratisation des institutions européennes demeure une chimère. Elle est impossible, car ce sont les marchés financiers, et non plus la pratique démocratique, qu’elle soit nationale ou européenne, qui évaluent les politiques suivies et, finalement, en décident.
Si c’est dans l’idée qu’il n’était pas nécessaire de se battre pour un changement des règles européennes que le premier gouvernement Tsipras avait conçu sa tâche, son échec était inévitable. Quel jeu joue donc Varoufakis en reprenant la même antienne dans son livre ?
Vu la brièveté de ce billet, je m’en tiendrai à trois problèmes parmi d’autres essentiels à la compréhension de la crise de l’Europe : les accords de Bretton Woods et leur chute en 1971 ; l’actualité des propositions de Keynes faites en 1944 au regard de la crise du projet européen ; la démocratisation du processus européen. Les références de ce qui suit se trouvent dans mon livre Le viol d’Europe. Enquête sur la disparition d’une idée, Presses Universitaires de France, 2013.
Le premier problème est la présentation faite de la chute des accords de Bretton Woods. Il est suffocant de prétendre que, sur le fond, la décision de Nixon en 1971 de laisser flotter le dollar en abandonnant sa parité fixe avec l’or a quelque chose à voir avec l’obstination des Européens, spécialement de l’Allemagne, à profiter du dollar sans contrepartie et à la volonté de punir ceux-ci. L’histoire que fait Varoufakis des tractations monétaires entre Américains, Allemands et Français dans cette période est très intéressante. Il la cible sur la stratégie politique allemande de profiter d’une couverture monétaire stable (le dollar, et ensuite l’Euro) pour pouvoir en toute tranquillité accumuler les excédents et affirmer sans risque sa puissance. C’est incontestable, on ne peut passer sous silence les responsabilités des dirigeants allemands (quoiqu’il y ait des contradictions internes entre ceux-ci et la Bundesbank).
Cependant, malgré qu’il s’en défende, Varoufakis dérape vers une obsession antiallemande. Car l’Allemagne ne joue pas dans la même division que les Etats-Unis et la Grande-Bretagne. Ces deux derniers ont une stratégie politique et financière mondiale et s’en disputent encore alors le leadership dans un jeu complexe du « je t’aime moi non plus » dans lequel dollar, livre sterling, Wall Street, City sont les poids lourds. L’Allemagne reste un petit bras dans l’histoire de la libéralisation financière qui s’opère des années 1940 aux années 1970. Déjà Wall Street et la City étaient opposées en 1944 aux accords de Bretton Woods, spécialement aux possibilités de contrôle des mouvements de capitaux. Les autorités américaines ont résisté. Le contournement a été rendu possible par la création dès 1957 par la City d’un marché dérégulé de l’Eurodollar. Pour sauver la place de Londres, il fallait y attirer les dollars et les gouvernements anglais ont joué, comme toujours, le double jeu, en être sans en être. La masse des dollars sortis des Etats-Unis et spéculant en toute liberté était telle dès la fin des années 1960 qu’elle contrecarrait la politique monétaire de la FED et les actions du FMI. Les partisans de la libéralisation financière avaient gagné. Autrement dit, Wall Street et la City. Ne dédouanons pas la finance de ses responsabilités autrement décisives. Nixon n’a fait qu’entériner. Les 3 tonnes d’or que de Gaulle avait exigées de Fort Knox n’ont pas pesé lourd dans sa décision !

Un second problème est l’insuffisance des enseignements que Varoufakis tire des propositions pour lesquelles Keynes s’est battu dans les négociations entre Américains et Britanniques. Les délégués européens n’ont eu en 1944 d’autre choix que d’entériner les résultats de ces négociations. Keynes savait en arrivant que ses propositions n’auraient pas gain de cause. Là où Keynes était révolutionnaire par rapport à ce que fut ensuite le projet européen, est qu’il proposait la coopération entre pays déficitaires et excédentaires pour maintenir leurs échanges commerciaux à l’équilibre. Mais Keynes, partisan du contrôle des mouvements de capitaux spéculatifs, allait au-delà d’une simple coopération monétaire articulée autour du Bancor, seul aspect que Varoufakis considère. Il envisageait une coopération économique, notamment par le biais d’investissements des pays excédentaires vers les pays déficitaires. Si l’Europe avait été bâtie sur ce principe de coopération économique entre pays – et non sur le principe de concurrence – il aurait été possible d’avoir un développement coordonné des pays européens, de surcroît équilibré entre eux.
Varoufakis se borne à insister sur ce qu’il appelle « le recyclage des excédents », c’est-à-dire le besoin de disposer, spécialement à l’échelle européenne, d’un mécanisme de redistribution qui évite l’accumulation des excédents commerciaux et financiers dans un même pays et assure leur recyclage vers les autres pays, surtout en cas de crise. Il vise la capacité de l’industrie allemande, avérée dès les années 1950, de créer pour l’Allemagne un excédent commercial, puis un afflux de capitaux qui, en se cumulant, mettent en péril les parités de change. Ce fut le cas lors de l’expérience de l’Union européenne des Paiements (UEP) dans les années 1950 (qui ressemblait à un petit Bancor à 6 pays), lors de l’Ecu comme monnaie commune, lors du serpent monétaire où il fallait périodiquement ajuster les taux de change, c’est-à-dire réévaluer le deutschemark et dévaluer plus ou moins les autres monnaies, ce dans un contexte de crise politique. Et c’est toujours le cas au sein de la zone euro, les excédents continuent d’affluer vers l’Allemagne, l’ajustement se faisant par l’austérité.
Néanmoins, en rester là est insuffisant. D’une part, l’exemple des Etats-Unis pris par Varoufakis n’est pas adéquat, car les « états » unis n’ont rien à voir avec les Etats-nations qui composent l’Europe. D’autre part, le plus important, c’est justement cette persistance structurelle de long terme qui démontre qu’un simple transfert au sein de la zone euro qu’il soit financier, lié à la fiscalité, voire encore plus invraisemblable à une politique budgétaire européenne ne traiterait pas le fond du problème. Il serait de plus politiquement inacceptable. Mettons-nous sans angélisme à la place des Allemands. Vous travaillez dur et mieux que les autres et on vous demande de leur verser ad vitam aeternam une rente financière sans contrepartie, car c’est comme cela qu’il faut appeler ce joli euphémisme de « transfert des excédents ». C’est la fable de La Fontaine (venue du poète grec Esope) de la cigale et de la fourmi. Ses enseignements sont connus, cela ne peut pas marcher. Et d’ailleurs est-ce si bon pour la cigale (c’est-à-dire la Grèce et d’autres) que de vivre en assisté et de devenir méprisable y compris à ses propres yeux ?
La seule bonne manière de traiter le problème est de lier les niveaux macro et micro en trouvant le moyen de diriger la création monétaire, non pas vers la spéculation financière, mais vers le financement de l’économie réelle, donc des investissements. De le faire par des canaux institutionnels explicitement dédiés à cet objectif, et non par les marchés financiers ou par la bonne volonté des banques. Et ce doit être fait de façon différenciée selon les pays, en donnant la priorité au financement des investissements des pays européens les plus en retard du point de vue de leur développement économique, de manière à leur permettre de rattraper leur retard par rapport aux autres. Couplée avec le besoin d’une gestion coopérative des balances des paiements, cela exige la création de fonds d’investissement communs entre pays excédentaires et déficitaires qui seraient abondés par les institutions européennes (BERD et pourquoi pas BCE). Le choix des investissements devrait s’appuyer sur une analyse concrète des nécessités nationales et locales de développement économique, social et écologique. Et comme des forces financières puissantes s’y opposeront, le contrôle des mouvements de capitaux spéculatifs, voire la prise de contrôle du système bancaire par la puissance publique pourra s’avérer nécessaire, nécessités que Varoufakis élude. Et là nous retrouverions vraiment, transposées et réajustées aux conditions d’aujourd’hui les propositions de Keynes. Pour les détails, je renvoie le lecteur à la proposition que nous avons faite en juillet 2015 avec Gabriel Colletis et Jean-Philippe Robé : « Comment sauver la Grèce : convertir la dette en investissements » Le Monde diplomatique, 15 juillet 2015, proposition que nous avions discutée à Athènes avec le cabinet du ministre grec de l’économie. Malgré sa large diffusion, Varoufakis n’en dit mot dans son livre.
Troisième problème, la démocratisation des institutions européennes. Voulant à juste titre contrer Schaüble et le projet d’un pseudo-fédéralisme, en pratique un régime autoritaire écrasant les peuples, Varoufakis propose de démocratiser l’Europe. On ne peut que souscrire avec enthousiasme à cette perspective et à ses attendus exposés dans le manifeste. Mais au-delà de la rhétorique flamboyante, qu’y a-t-il de concret et qui réponde à la crise dans ce qu’il nous propose ? A la lecture on ne peut se défaire du sentiment qu’après en avoir fait trop peu dans ses propositions économiques et financières, Varoufakis en fait trop dans la rhétorique politique. Comme si l’excès du discours démocratique pouvait à lui seul compenser l’acceptation de fait, vu l’absence de propositions alternatives, de la libéralisation financière. Cela fait penser irrésistiblement à la stratégie Delors des années 1980 ouvrant toutes grandes les vannes de la libéralisation tout en proposant l’Europe sociale comme contrepoids. On sait ce qu’il en est advenu.
Même les européistes les plus enthousiastes qui, en 1945, voyaient s’ouvrir devant eux une fenêtre d’opportunités ne sont pas allés jusqu’à l’Assemblée constituante à la Varoufakis. Les partisans du modèle républicain se limitaient à une Assemblée délibérative préparant le terrain. Ils se sont heurtés aux partisans d’un fédéralisme partant du bas et donnant des pouvoirs aux niveaux intermédiaires (régions, nations), donc opposé en pratique à un fédéralisme autoritaire. La recherche d’un compromis démocratique efficace entre modèle républicain et modèle fédéral est le véritable enjeu de la démocratisation de l’Europe. Varoufakis l’esquive par une vague articulation sans contenu entre parlement européen, parlements nationaux, conseils régionaux et conseils municipaux. Comme le jeu entre ces instances se ferait au sein des règles existantes, néolibérales, on n’aurait comme aujourd’hui qu’une parodie procédurale, pas une vraie prise des peuples sur leur destin.
La crise démontre avec clarté qu’à force de nier la diversité des peuples européens et leur enracinement sociohistorique de longue durée et de leur refuser toute expression démocratique, l’Europe a contribué à réactiver les pulsions nationalistes, pour ne pas dire fascisantes. Elle creuse elle-même sa tombe. Le modèle républicain reste centralisé. Il conduit à l’uniformisation, à la même négation de la diversité et aux mêmes pulsions, fussent-elles habillées de procédures d’apparence démocratique. L’évolution de la France l’illustre aujourd’hui. Ne la recommandons pas pour sortir l’Europe de sa crise ! D’ailleurs, autant que chez Schaüble, la centralisation des décisions bloquerait tout autant le transfert des excédents cher aux Grecs, faute d’une majorité. N’en déplaise, les pistes du fédéralisme et de la subsidiarité sont à explorer comme revitalisations possibles de la démocratie. Il faut pour cela des pouvoirs munis de ressources financières, d’une autonomie et de droits politiques (de veto par exemple) suffisants aux niveaux plus bas : des collectivités territoriales aux collectifs de travail, des régions aux branches et aux peuples. L’exemple fédéral allemand doit être étudié pour ce qu’il apporte et aussi interdit dans cette direction. Ne tombons pas dans les pièges de la novlangue européenne qui taxe de subsidiarité ce qui n’est qu’une décentralisation, autrement dit le déplacement du même modèle abstrait et standardisé du haut vers le bas.
Globalement donc un livre à lire, mais avec précaution et avec une vraie connaissance des réalités de long terme et actuelles du processus européen, celle dont malheureusement Varoufakis manque, confiné qu’il est à une vision politique due à sa fonction de ministre et, comment dire, à un curieux tropisme gréco-américain dans l’approche. La crainte qu’on peut avoir, hélas, est qu’une fois encore ce livre flatte le péché mortel d’une gauche désemparée et en manque de repères qui, à l’affrontement aux dures réalités, préfère les contes de fée dans lesquels Amérique et Allemagne (et occasionnellement Grande-Bretagne) tiennent tour à tour les rôles de bonne et mauvaise fée.
Pour en savoir plus :
– Yanis Varoufakis, Et Les faibles subissent ce qu’ils doivent ?, Paris, Les Liens qui Libèrent, 2016





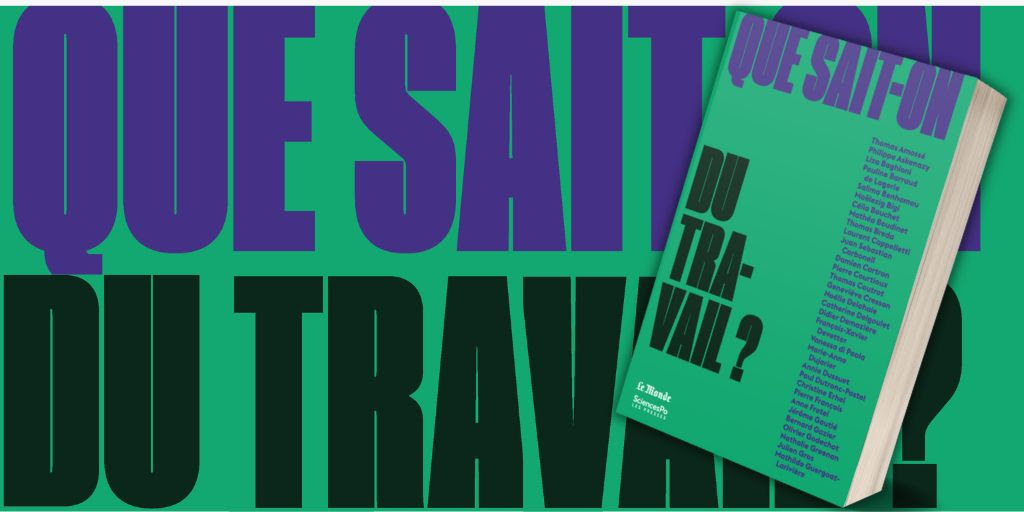


Laisser un commentaire