– Isabelle Berrebi Hoffmann et Quentin Chapus, propos recueillis par Jean-Marie Bergère –
Isabelle Berrebi-Hoffmann, directrice de recherche au CNRS (Lise-Cnam) et Quentin Chapus, maître de conférences en économie à Sciences Po Bordeaux, ont publié récemment un important article intitulé « Des luttes éthiques aux luttes sociales » (Revue Réseaux-La Découverte). Il porte sur les mouvements de contestation menés aux États-Unis par des salariés des GAFAM de 2015 à 2021. Ils répondent aux questions de Jean-Marie Bergère pour Metis.
Jean-Marie Bergère : Vous distinguez luttes « éthiques et identitaires » et revendications « économiques et sociales ». Quel contenu ces catégories recouvrent-elles ? Si je comprends bien, c’est très différent de l’opposition établie par Eve Chiapello et Luc Boltanski entre les critiques sociales et critique artiste du monde du travail (Le nouvel esprit du capitalisme – 1999). Qu’en est-il ?
La recherche que nous avons publiée dans l’article que vous mentionnez repose sur une analyse quantitative et qualitative de plus de 200 actions collectives qui ont pris place entre 2015 et 2021 au sein des GAFAM et d’un certain nombre d’entreprises de plateforme aux États-Unis. Nous sommes partis d’une énigme : entre novembre 2020, puis en janvier 2021, des sections syndicales sont apparues chez des sous-traitants puis dans le groupe Alphabet (Google) lui-même pour la première fois dans l’histoire de l’entreprise, mais aussi pour la première fois dans l’histoire de la Silicon Valley où, jusque-là, aucun syndicat n’avait réussi à s’implanter. De nombreuses autres ont suivi (Instacart, Amazon, Starbuck…). Quelles évolutions ont permis cette petite révolution ? Il nous a semblé que la conjonction de mouvements de protestation que les acteurs sociaux qualifiaient eux-mêmes de moraux ou éthiques (lutte contre le racisme et le sexisme, lutte pour l’environnement et le climat, lutte pour le droit à la vie privée face aux possibilités de surveillance algorithmique…) et celle de revendications liées aux conditions de travail, s’était opérée de façon particulière, avec des acteurs spécifiques (des travailleurs femmes et issus des minorités visibles pour l’essentiel), dans cette courte séquence aux États-Unis. Cette convergence et le mode opératoire de ces acteurs restaient à décrire et objectiver — c’est le but de l’article — et ouvraient par ailleurs des pistes de réflexion stimulantes pour les sciences sociales qui s’intéressent aux formes actuelles de contestation critique dans les mondes du travail.
Lutte « éthique » et lutte « sociale » sont donc des catégories directement utilisées par les activistes du monde de la Tech américain, les rendant d’autant plus opératoires que les mobilisations sont parfois pensées à travers elles. Plus précisément, cinq grandes sous- catégories d’actions et mobilisations répertoriées dans notre base de données relèvent des luttes éthiques et identitaires : les luttes antiracistes, les luttes anti sexistes et anti discrimination féministes et LGBTQ+, les luttes contre le réchauffement climatique, les luttes contre les politiques migratoires et enfin les luttes contre l’utilisation dite « illégitime » des technologies (intelligence artificielle, surveillance, etc.). Ce que nous nommons « luttes sociales » recouvre quant à elles les revendications liées au travail et aux relations employeur/employés, c’est-à-dire les actions concernant les conditions de travail, le contrat de travail, la rémunération, les pratiques illégitimes de l’employeur vis-à-vis des employés ou encore la sécurité de l’emploi.
Sur le plan théorique, cette catégorisation à la fois recoupe et diffère de celle que proposent Luc Boltanski et Eve Chiapello (1999). On retrouve dans la catégorie « luttes économiques et sociales » de fortes proximités avec la « critique sociale », dans la mesure où il s’agit de luttes visant à résister à une trop forte exploitation du travail (augmentation des cadences, baisse de la rémunération, etc.). La catégorie « luttes éthiques et identitaires » diffère par contre de la « critique artiste » : si elle met l’individu au cœur des enjeux de luttes, c’est moins dans une logique d’émancipation (au sens de désaliénation du travail par son renchérissement) que dans une volonté de reconnaître la différence et la singularité de chacun.
Parmi ceux qui travaillent dans ces entreprises, vous distinguez « cols bleus » et « cols blancs », tout en invalidant l’idée selon laquelle il serait possible d’attribuer à chaque catégorie un type de revendications, et éventuellement de mettre en concurrence « fin du monde et fin du mois », selon les termes du débat en France. Le titre même de votre article établit un lien, un continuum, entre luttes éthiques et luttes sociales. Est-ce le cas ?
Effectivement, nous concluons sur l’existence d’un continuum, mais qui s’est construit progressivement à travers les luttes et n’a rien d’évident a priori. Au début de la période étudiée (2015), les luttes de travailleurs étaient très fragmentées entre « cols bleus » d’un côté et « cols blancs » de l’autre. Cette segmentation s’explique par plusieurs raisons. On peut en citer deux principales : l’écart important tout d’abord qui existe entre cadres et ouvriers au sein des GAFAM en termes de salaires et de conditions de travail ; deuxièmement l’organisation spécifique de ces entreprises qui divisent fortement les collectifs et rendent quasi impossible la rencontre de ces deux catégories de travailleurs dans le travail.
On peut citer l’exemple d’Amazon, entreprise dans laquelle les cadres les plus diplômés travaillent pour l’essentiel dans les locaux de Seattle, alors que les ouvriers sont dans les entrepôts, disséminés aux quatre coins du pays. Pour Google, l’entreprise comprend essentiellement des cadres, et les fonctions support (entretien des locaux, restauration, etc.) sont largement externalisées vers des prestataires. La convergence s’est donc faite très progressivement, notamment par le fait que les cadres des GAFAM ont été, de par leur mobilisation sur des enjeux éthiques, confrontés à des problématiques de type « sociales », à savoir des licenciements abusifs. Les registres éthiques, plus spécifiques aux cadres, ont ainsi été partiellement relégués derrière des luttes sociales, plus spécifiques aux ouvriers, un peu par la force des choses.
Les mobilisations pour des raisons éthiques de salariés des GAFAM, du moins celles qui parviennent jusqu’à nous depuis les États-Unis, semblent liées spécifiquement à l’activité de ces entreprises nées avec le numérique. Dans votre article, vous donnez une place importante à des enjeux qui dépassent cette activité particulière, l’environnement, les discriminations, l’intégration de migrants, la défense de la démocratie… Est-il fondé de distinguer des raisons d’agir qui seraient « internes » versus des raisons « sociétales » ?
La question est difficile, mais ce que nous pouvons dire est que nous avons constaté une forme de chronologie des mobilisations qui tend à montrer sinon une imbrication forte des causes de contestation du moins une forme de synergie avec des acteurs communs (c’est ce que montre notre analyse de réseau). Pour les luttes éthiques les plus majoritaires sur la période étudiée (mouvements #MeToo et Black Lives Matter) ces luttes sont loin d’être spécifiques aux GAFAM, et elles ne sont d’ailleurs pas nées dans ces derniers. Mais on ne peut écarter le lien de causalité entre la mobilisation réussie — plus de 20 000 personnes — des femmes employées par Google le 1er novembre 2018, dans le contexte de #Metoo et suite à un départ dans des conditions jugées trop favorables d’un cadre dirigeant dont l’entreprise avait reconnu les faits de harcèlement sexuel — et les réunions d’organizing « syndical » qui ont suivi au sein du groupe.
Finalement, ce qui a donné une telle résonnance au sein des GAFAM aux mouvements cités plus haut est moins une spécificité de ces entreprises sur les enjeux en question que l’apparente contradiction entre les valeurs qu’elles mettent facilement en avant (entreprises supposément « égalitaires ») et les faits. On peut rajouter à ce point tous les mouvements écologistes qui ont été relayés activement au sein d’Amazon, là encore pour pointer toutes les limites écologiques du modèle de l’entreprise qui se veut pourtant vertueuse sur cet aspect. D’un autre côté, il y a aussi eu des luttes plus spécifiques à ces entreprises de la Tech, autour de mouvements nés dans ces dernières suite à des actions ou prises de position des dirigeants jugées problématiques. Toutes les interrogations autour de l’Intelligence artificielle et son utilisation, par exemple à des fins militaires ou de contrôle de la population, se posent singulièrement chez Google et Microsoft. Dans ces cas précis, c’est toute la raison d’être de l’engagement des cadres dans l’entreprise qui a été remise en question, cette dernière agissant supposément à l’encontre de leur engagement initial.
Il est toujours difficile de comparer et, souvent de comprendre, les formes d’action privilégiées aux États-Unis, dont certaines, comme vous le remarquez, sont un héritage des luttes pour les droits civiques. Peut-on néanmoins caractériser schématiquement les rôles respectifs des syndicats, des ONG, des coalitions, des collectifs structurés ou éphémères aux États-Unis ? Avez-vous constaté des évolutions dans le « répertoire d’action » ? Vous parlez d’un rôle de broker que les organisations syndicales joueraient. Comment ça se passe ?
L’analyse du rôle de broker relève surtout de l’approche en termes de réseau que nous avons mobilisée, à partir de données quantitatives. Pour comprendre comment s’organisaient les luttes, nous avons en effet entrepris de recenser toutes les mobilisations étant survenues au sein des GAFAM (grèves, manifestations, pétitions, etc.) durant la période étudiée et d’identifier, dans chacune de ces mobilisations, les principaux acteurs qui en étaient à l’origine. À chaque fois que deux acteurs (des individus, activistes, ou des organisations, associations, etc.) étaient présents dans un même évènement, nous avons considéré qu’il y avait un lien entre eux. L’analyse de réseau qui en a découlé a permis de montrer que c’était les syndicats qui jouaient le rôle le plus important. L’importance n’est pas ici définie d’un point de vue quantitatif, ou du nombre d’évènements organisés : les syndicats ne sont pas les acteurs qui sont le plus intervenus dans les mobilisations, d’autres ont en effet été beaucoup plus actifs. On peut penser par exemple au collectif Amazon Employees for Climate Justice ou à des individus comme Christian Smalls qui se sont démultipliés en organisant pétitions et manifestations, notamment au moment de l’apparition du Covid où les conditions de travail se sont détériorées chez Amazon.
Mais les syndicats sont les acteurs les plus importants par la position qu’ils occupent dans le réseau d’ensemble, à savoir une position d’intermédiarité (ou de broker), c’est-à-dire que nous les avons identifiés comme étant les acteurs le plus capables de fédérer et relier des luttes isolées et disparates. Une telle position s’explique de différentes manières, d’abord car ils disposent de ressources économiques et organisationnelles supérieures à ceux des mouvements grassroots, permettant d’étendre plus facilement le spectre des mobilisations (limitées souvent à une ville ou à un entrepôt pour les collectifs les moins organisés). Ensuite, car leur implantation dans le paysage économique américain, bien antérieure à ces mobilisations par le bas qui ont émergé dernièrement, et leur nature par définition transversale — le syndicat SEIU Service Employee International Union par exemple est présent dans de nombreux secteurs — s’adapte plus volontiers à un répertoire hétéroclite de luttes, touchant à différentes revendications.
Vous décrivez sous l’appellation de « busting » les luttes anti-syndicales des directions. Ces luttes sont surprenantes et choquantes pour nous du point de vue de notre droit du travail, mais aussi en référence à l’image répandue d’un management caractéristique de la Silicon Valley, bienveillant, consensuel, créatif, cool,… Qu’en est-il ?
Aux États-Unis, les formes historiques de lutte antisyndicale s’appuient à la fois sur un droit du travail peu implanté dans certains États et sur des idéologies antisyndicales fortement présentes dans l’histoire des luttes sociales. La formation d’une section syndicale locale obéit à un processus défini par la loi fédérale et contrôlé par le National Labor Board Relations (NLRB), agence fédérale chargée du respect du droit du travail fédéral dans l’ensemble des États. L’employeur peut alors développer une panoplie d’actions qui contrecarrent le bon déroulé de ce processus. Il peut intervenir à chaque étape par le repérage d’« agitateurs » potentiels et leur licenciement parfois avec une incitation financière au départ, la mise en place de contre-campagnes pour influer sur l’opinion des salariés qui doivent voter la création ou non d’une section, les obstacles à l’organisation du vote, à l’accès aux urnes de l’ensemble des salariés, l’intimidation durant le vote lui-même, le recours à des entreprises de conseil et de lobbying qui interviennent directement sur le terrain pour faire changer d’avis les salariés…
L’ensemble de ces contre-actions définissent ce qu’aux États-Unis on nomme une stratégie d’Union Busting. Les géants du numérique se sont engagés depuis 2018, dans des formes variées de lutte antisyndicale, ce qui peut effectivement surprendre. Entre novembre et décembre 2019, Google licencie pour la première fois cinq de ses salariés arguant du seul fait qu’ils aient utilisé leurs mails professionnels afin d’organiser des réunions de préparation à des élections syndicales dans l’entreprise. Uber embauche en 2019 des entreprises de lobbying pour essayer de faire passer une loi (Bill) en Californie annulant la possibilité de requalifier ses livreurs en salariés. Google obtient que soit passée en 2020 une loi fédérale qui interdit effectivement l’usage du mail professionnel pour des messages de mobilisation.
Depuis 2018, les actions collectives au sein des GAFAM bousculent ainsi le mythe consensuel du « modèle californien » et ce faisant contribuent à déconstruire ses croyances et promesses à l’aune des actes et les réponses concrètes qu’elles induisent de la part des directions d’entreprise. Ces pratiques, souvent à la limite de la légalité, mais difficiles à prouver, sont révélatrices d’un rapport de force qui s’est récemment modifié entre employés et employeurs de la Silicon Valley, annonciatrice, peut-être de la crise actuelle.
Les GAFAM sont présents aussi en France et en Europe et y emploient un nombre non négligeable de salariés. Sont-ils sensibles et mobilisés à propos des mêmes questions éthiques que sociales ? Ce cadre d’analyse « éthique » versus « social » est-il transposable en France ?
Il faudrait enquêter sur ce que le mouvement #Metoo, ou la mobilisation écologique des jeunes diplômés par exemple font à l’action syndicale en France et en Europe et certes on peut faire l’hypothèse que les formes d’articulation entre ces mouvements globaux et les luttes sociales prennent un chemin un peu différent. Néanmoins, il nous a semblé qu’émergeait également dans les mondes du numérique la revendication de nouveaux droits pour les travailleurs qui se diffusent globalement.
Au-delà de ce que nous avons nommé les luttes éthiques, émerge, nous semble-t-il, une revendication radicalement nouvelle : celle d’un droit de regard sur les usages de son travail et plus largement sur les conséquences de sa participation à une organisation productive. C’est ce que le cas du conflit autour de la collaboration de Google avec le Pentagone (affaire Maven) a montré. Les salariés des GAFAM, pour certains et certaines, revendiquent un droit de regard sur les usages de leur travail et ce que l’entreprise fait de leur travail, y compris au point de débrayer, contester ou créer des sections syndicales afin d’exercer une forme de contre-pouvoir sur des choix auxquels ils n’ont aujourd’hui pas accès.
Pour en savoir plus
Des luttes éthiques aux luttes sociales – Les mouvements de contestation critique des salariés des GAFAM aux États-Unis (2015-2021) Dans Réseaux 2022/1 (N° 231), pages 71 à 107









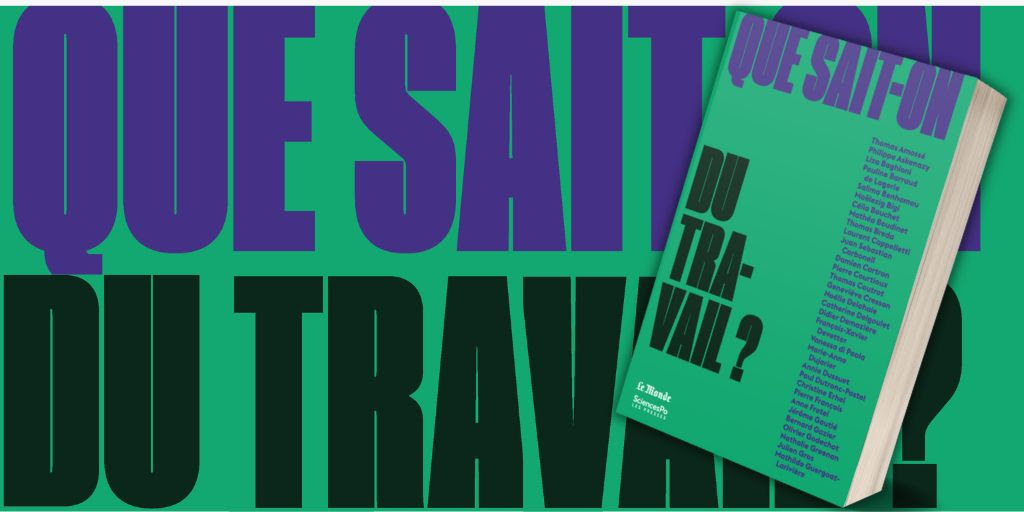
Laisser un commentaire