Le livre de Joëlle Zask, La Démocratie aux champs, surprend : le sous-titre, Du jardin d’Eden aux jardins partagés, dessine le long cheminement qui montre Comment l’agriculture cultive les valeurs démocratiques.

Le sort des paysans semblait définitivement scellé. Les poubelles de l’histoire les accueilleraient les uns après les autres. Le modèle industriel leur opposait la rationalité d’une spécialisation des cultures et son inventivité techno-scientifique, seules selon lui capables de produire suffisamment pour nourrir une population mondiale en croissance rapide. Les progressistes, urbains et démocrates – étymologiquement le citoyen est celui qui habite la cité -, s’en sont longtemps réjouis. Le paysan a beau être quelquefois ce personnage authentique, simple et qu’on aime présenter à ses enfants pendant les vacances, on s’en méfie. Il vote mal. Il ne voit pas au-delà des bornes de son champ et n’a que haine pour la ville. Il est arriéré et conservateur et quand les circonstances historiques se présentent, il s’allie avec des régimes fort peu démocratiques. Telle est l’image la plus répandue.
Mais The Times They Are Changing, et pas seulement pour Bob Dylan. La relégation des ouvriers a succédé à l’exode rural. C’est l’industrie qui se plaint dorénavant d’être mal-aimée et Monsanto est attaqué de toutes parts. L’agriculture bio, la permaculture, les fermes urbaines, les jardins partagés, les toits végétalisés, les ventes directes, se développent bien au-delà des cercles militants, écologistes ou citadins en mal de légumes frais, d’air pur et de convivialité. Le film Demain qui présente ces expériences a obtenu un succès inespéré (voir « Demain le DVD » dans Metis). En France, la promotion des circuits courts et de l’agro-écologie est assurée depuis quelques années déjà par le ministère de l’Agriculture. Certes l’agro-industrie et la grande distribution sont largement dominantes, mais pour combien de temps ?
Jefferson et les farmers
 Dans La Démocratie aux champs, Joëlle Zask, sans ignorer ces aspects écologiques et économiques, prend à revers nos représentations politiques : « ce qui est progressivement devenu notre idéal de liberté démocratique ne vient en priorité ni de l’usine, ni des Lumières, ni du commerce, de la ville ou du cosmopolitisme, mais de la ferme ». D’emblée, elle avertit qu’elle laisse de côté le « comportement électoral » des paysans pour se consacrer à leur travail en lien avec leur environnement aussi bien physique que social, et à ce qu’il nous dit de la politique.
Dans La Démocratie aux champs, Joëlle Zask, sans ignorer ces aspects écologiques et économiques, prend à revers nos représentations politiques : « ce qui est progressivement devenu notre idéal de liberté démocratique ne vient en priorité ni de l’usine, ni des Lumières, ni du commerce, de la ville ou du cosmopolitisme, mais de la ferme ». D’emblée, elle avertit qu’elle laisse de côté le « comportement électoral » des paysans pour se consacrer à leur travail en lien avec leur environnement aussi bien physique que social, et à ce qu’il nous dit de la politique.
Son argumentation est l’occasion d’une vaste fresque mythologique et historique. Adam n’est pas seulement le premier pécheur et le premier puni, il est jardinier. Dieu lui a confié une double mission : labourer la terre tout en en prenant soin : « leurs potentialités se développent au cours d’actions conjointes, par interaction : en cultivant, Adam apporte au jardin des éléments qui lui permettent de s’épanouir et, réciproquement, en produisant des plantes et en réagissant à ce qu’Adam lui apporte, le jardin transforme Adam ». Déméter, elle, est à la fois la déesse de l’agriculture et de la constitution des sociétés humaines. Plus près de nous, la naissance de la démocratie américaine est inséparable du rêve d’une ferme indépendante. Les positions de Thomas Jefferson – troisième président des Etats-Unis d’Amérique, rédacteur du préambule de la Constitution et de la déclaration d’indépendance – sont particulièrement tranchées. Il s’oppose aux partisans de l’élitisme ainsi qu’aux physiocrates, qu’il connaît bien. Ceux-ci ne considèrent l’agriculture que sous un angle économique, Jefferson la voit comme la source des « vertus et des caractéristiques humaines les plus en accord avec l’autogouvernement démocratique ». Les physiocrates se tournent vers les grands propriétaires terriens, en mesure de produire et de commercialiser les surplus agricoles grâce à la spécialisation et à l’intensification des cultures. Jefferson considère que la base sociale de la démocratie est formée par les paysans indépendants, les farmers. « Alors que les premiers se méfient du peuple qu’ils pensent incapable de discerner ses propres intérêts et lui préfèrent l’élite cultivée, Jefferson ne croit qu’à l’autogouvernement ».
La fresque historique se poursuit avec l’expérience des lopins de terre individuels en URSS et en Chine. Sous Staline, dès 1938, les lopins individuels produisent 21,5 % de la production agricole brute pour 3,9 % des surfaces cultivées ! En Chine, le lopin individuel est rétabli au début des années 60 pour sortir de la famine. Puis avec des expériences plus proches de nous, le mouvement des Sans terre au Brésil qui fédère plus de 350 000 familles, et enfin les écoles Montessori et leurs jardins éducatifs, les fermes urbaines, les jardins partagés, Incredible Edible, Green Guerilla, etc.
Joëlle Zask n’oublie pas le côté noir du recours-retour à la terre « qui ne ment pas ». En France, au début du 20e siècle, les jardins ouvriers sont loin d’être conçus comme un moyen d’émancipation. Leur raison d’être est plutôt d’imposer une vie saine et l’ordre moral, « une fois penché sur son sillon l’ouvrier oublie la politique, il se détourne des syndicats et des fauteurs de troubles ». Les statuts de la « Ligue française du coin de terre et du foyer » sont précis : un couple qui reste sans enfants après trois ans de mariage perd son droit au lopin. L’abbé Lemire, est clair : « La terre est le moyen, la famille est le but ». En Allemagne, les nazis, bientôt soutenus en cela par le philosophe Heidegger, opposent l’enracinement et l’authenticité du paysan « qui appartient à la terre », au cosmopolitisme et au nomadisme. Leur racisme et leur antisémitisme s’alimentent de leur haine des diasporas et de leur croyance en « la loi vitale de l’union du sol et du sang », basée sur une vision romantique totalement imaginaire de la condition paysanne. Joëlle Zask note que cette vision ne contient aucun élément d’interaction entre le paysan et la terre qu’il cultive : « là où nous avions situé l’expérience faillible du jardinage et le soin des cultures, Heidegger affirme le sacré ».
Le travail comme expérience partagée
Comme souvent l’histoire seule ne permet pas de trancher. Pour suivre la démonstration de Joëlle Zask, il faut dépasser les discours abstraits, refuser les utopies surplombantes et analyser le travail des cultivateurs comme une expérience, et même « le paradigme de l’expérience », celle qui « consiste dans une relation entre l’organisme et son milieu, d’une nature telle que l’un et l’autre se transforment mutuellement » (John Dewey). L’expérience d’un travail qui « n’est pas suer, arracher, rentabiliser, s’essouffler, souffrir, arraisonner. C’est dialoguer, écouter, proposer, prendre une initiative et écouter la réponse, mêler des rythmes et des logiques différents,… viser l’avenir, sachant qu’on ne peut calculer à coup sûr ». Sous cet angle, la culture de la terre est liée à la culture de soi. Il n’y a ni antagonisme ni fusion entre l’homme et la nature, mais interaction et solidarité. Le jardinier cultive le jardin et le transmet. Cette expérience transforme le jardinier. C’est ce travail comme expérience, producteur de savoir, de savoir-faire et de savoir-vivre que les experts de l’agro-industrie tentent de disqualifier au nom de la rationalité et de la science, dans un mouvement identique à celui qui prolétarise les professionnels et gens de métiers dans l’industrie (voir « Un revenu contributif à Plaine Commune » dans Metis).
Le travail des cultivateurs est aussi une expérience sociale. A la réputation d’individualisme des paysans, il est possible d’opposer les multiples expériences collectives. Celle des coopératives comme celle des jardins partagés. Il est nécessaire également de faire la différence entre indépendance et égoïsme. Pour Jefferson l’expérience du farmer développe un esprit individuel « aussi enclin à l’esprit public qu’il est occupé à se perfectionner ». Les vertus publiques et les vertus privées ne se renforcent nulle part mieux qu’à la ferme. Pour les Américains en général, la citoyenneté repose sur le goût de la liberté et sur l’habitude de se gouverner sans maître, à l’opposé d’une conception identitaire et spectatrice de la citoyenneté. La culture d’une parcelle individuelle et l’indépendance qu’elle donne s’apparentent politiquement à ce qui est visé par une partie des promoteurs d’un revenu d’existence universel. Joëlle Zask ne fait pas le lien, mais son analyse le suggère. Pas de citoyenneté sans indépendance, indépendance matérielle et indépendance d’esprit, indépendance comme trait de caractère.
L’art de s’associer
Un terrain partagé est un lieu communautaire. Il peut être divisé en parcelles que chacun cultive individuellement, mais chaque cultivateur doit adapter son activité à celle des autres ainsi qu’à l’écosystème. Le jardinier ne peut négliger sa parcelle dont les mauvaises herbes ou les maladies dégraderaient celle des autres. Il développe « l’art de s’associer » avec les autres dont Tocqueville a fait le cœur des modes de vie démocratiques : « La terre n’est commune que si elle est cultivée en commun ». Nous retrouvons là les analyses de l’auteur dans un précédent livre « Participer ». La conscience de chacun de nous se développe lorsqu’il « prend part » personnellement par ses activités à la vie des groupes auxquels il est lié. Elle s’atrophie lorsqu’il se contente d’en « faire partie ». En passant de la règle à son application, de la théorie à l’expérience, nous apprenons à discerner ce qui compte. Cette leçon vaut aussi bien pour les gouvernés que pour les gouvernants. Elle seule peut les rendre capables de dépasser la méfiance abyssale qui s’est installée entre eux.
La Démocratie aux champs n’est pas un traité faisant la promotion d’une « autre agriculture ». L’intérêt du livre est principalement de nous rappeler que la démocratie ne se réduit pas à une forme de gouvernement et au choix de ceux qui sont en charge du fonctionnement des institutions de la société. Thomas Jefferson et Alexis de Tocqueville l’affirmaient déjà : la démocratie repose davantage sur les mœurs que sur les lois. En démocratie, la fonction première des citoyens, celle dont les autres dépendent, « est de gouverner leurs affaires et de se conduire sans maître en toute occasion imaginable. Là se forgent, d’un côté, l’esprit social et l’esprit public, et, de l’autre, la personnalité individuelle que les auteurs cités exprimeront en termes de responsabilité, d’initiative, d’indépendance ou même de courage ». Le gouvernement de sa ferme par le fermier est le premier niveau de l’autogouvernement. La commune est le lieu « où réside la force des peuples libres ». A son niveau, chacun peut prendre part au gouvernement des affaires publiques, non pas une fois de temps en temps, mais chaque jour : « Prendre part n’est pas seulement compter pour un dans le jeu des relations sociales, c’est aussi s’exercer à bien juger et, de cette façon, s’entraîner à la citoyenneté » (Joëlle Zask, Participer, 2011).
Il faut prendre au sérieux ces « tentatives microscopiques » (1). Elles sont des expériences de liberté et de sociabilité au cours desquelles ceux qui y prennent part ne se contentent pas de débattre ou de décider ensemble, mais « font ensemble ». Ce faisant, ils « découvrent, éprouvent et développent leurs libertés » et leur confiance en eux et dans les autres. S’il faut « labourer et prendre soin » de notre jardin, ce n’est pas seulement pour manger des « cédrats confits et des pistaches » comme le dit Voltaire en conclusion de Candide, ni en raison des seuls motifs écologiques ou de convivialité, c’est aussi parce que les vertus démocratiques s’y cultivent.
Pour aller plus loin
(1) « Autant je pense qu’il est illusoire de miser sur une transformation de proche en proche de la société, autant je crois que les tentatives microscopiques, type communautés, comités de quartier, l’organisation d’une crèche dans une faculté, etc. peuvent jouer un rôle absolument fondamental. C’est en travaillant à de petites tentatives comme celles-là que l’on contribue au déclenchement de grandes déchirures… Mieux vaut dix échecs répétés ou des résultats insignifiants qu’une passivité abrutie… » F. Guattari, La Révolution moléculaire, Les prairies ordinaires, 2012.
Dans le même ordre d’idées, Michaël Foessel conclut sa chronique « Trump : comment être milliardaire et antisystème ? » (Libération du 4 novembre 2016) ainsi : « Plutôt que de dénoncer l’omnipotence du système, quitte à recourir à des théories du complot, il faut s’appuyer sur ce qui est d’ores et déjà antisystématique dans nos vies. Cette part est faite des paroles, des luttes et des amours qui suspendent les logiques de domination. Dès que l’imprévu surgit dans le monde, le système expose sa fragilité ».






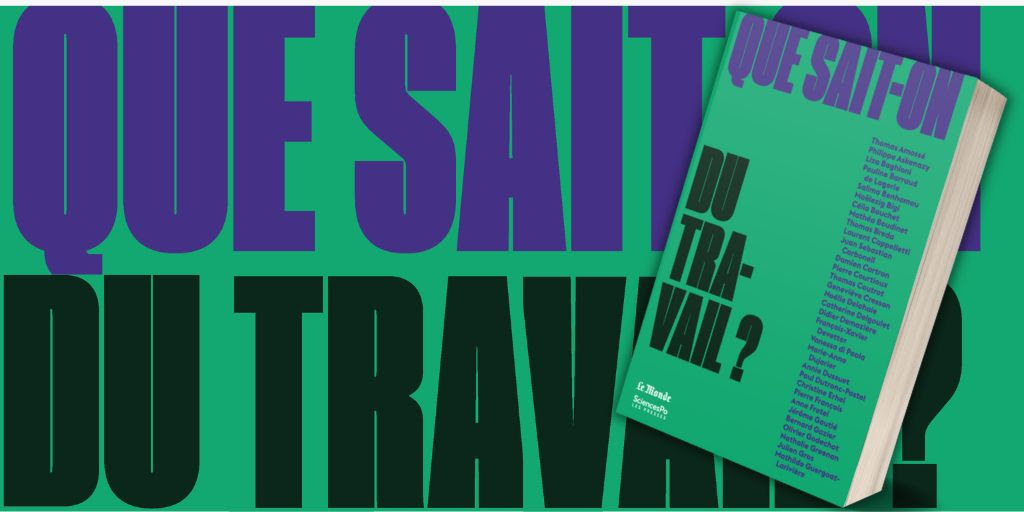


Laisser un commentaire