« Ça parlait – De la Picardie – Et des roses – Qu’on trouve là-bas… » Déjà empreinte de nostalgie lorsqu’Yves Montand l’interprétait en 1980, cette chanson – Dansons la rose – paraît d’autant plus vieillie que les roses politiques, celles que le parti socialiste portait au poing, semblent être définitivement fanées, qu’elles proviennent de Picardie, du Nord, de l’Est et même d’une partie du Sud de la France. Le « peuple de gauche », pour parler comme dans les années 1970, c’est-à-dire cette alliance politiquement féconde des ouvriers, des employés, des enseignants et des intellectuels est désormais plus difficile que jamais à rassembler.
Les votes Mélenchon puis NUPES en portent témoignage : en 2022, cette gauche rassemblée a surtout fédéré les diplômés urbains, pour certains déclassés, une partie des jeunes et des minorités – racisées et de genre – ainsi que les Français de culture musulmane, modestes ou moyens. En revanche, elle a échoué à mobiliser une large partie des catégories populaires réfugiées dans l’abstention et évidemment dans le vote d’extrême droite qui s’est métamorphosé au fil des ans en véritable vote de classe. Et ce, pour des raisons qui échappent à la gauche en dépit de la radicalité de son discours économique.
Ce constat, largement partagé par l’ensemble des observateurs et des acteurs politiques, est aussi celui qui ouvre le dernier livre de François Ruffin, Je vous écris du front de la Somme (François Ruffin, Je vous écris du front de la Somme, Les liens qui libèrent, 2022) dont le titre possède un double sens : ce « front de la Somme » dont parle l’auteur est évidemment celui du combat contre l’extrême droite, une rude bataille à l’image de celle que les armées françaises menèrent dans cette région durant le premier conflit mondial. Mais c’est aussi un véritable combat culturel que François Ruffin engage à gauche et contre une grande partie de la gauche. En effet, pour lui, les progrès du RN ne seraient dus qu’à l’abandon par la gauche des classes populaires, c’est-à-dire au mépris dans lequel celle-ci tient la question fondamentale du travail humain — encore lui faut-il convaincre son propre camp…
Du travail, la guerre des gauches est déclarée
Son propos ressemble à s’y méprendre à une polémique avec lui-même c’est-dire avec la France insoumise ou la NUPES. Citons, par exemple, pages 42-43, ce moment où il regarde dubitatif les gesticulations de ses collègues députés qui dénoncent « la châtelaine de Montretout » ou mettent en scène, lors de leurs premières journées à l’Assemblée, un mariage fictif entre Macron et Le Pen : « Sur ces gestes, je m’interroge toujours, écrit-il : quelle est l’efficacité de tout cela chez moi ? ». Aucune assurément. Toutefois, dans l’examen de conscience qu’il propose, un seul personnage est exempt de remise en cause : Jean-Luc Mélenchon dont le génie politique est loué durant trois pages, mais dont la stratégie politique est exécutée en une centaine. Car c’est de cela dont il s’agit au fond : critiquer à visage découvert la fameuse « stratégie Terra nova » (Olivier Ferrand, Romain Prudent, Bruno Jeanbart, Gauche : quelle majorité électorale pour 2012 ? Note de la fondation Terra Nova, 11 mai 2011) qui, explique-t-il, a été appliquée avec succès par le candidat Mélenchon et les candidats NUPES en 2022.
Ce texte de 2011, très commenté à l’époque, proposait de substituer à la vieille coalition ouvrière qui a porté la gauche au pouvoir en 1981, une autre fondée sur l’alliance des diplômés, des jeunes, des minorités des quartiers populaires et des femmes. « Progressiste » en matière économique et sociale, cette coalition l’est moins sur le plan culturel et moral, ce que montrera l’épisode du mariage pour tous quelques années plus tard. Mais surtout, elle a l’inconvénient de laisser de côté la question du travail à travers l’abandon « programmé » des classes populaires. C’est cela que lui reproche Ruffin : en 2022, la seule alliance des couches urbaines diplômées, sensibles aux causes environnementales et aux discriminations, avec les militants actifs au sein du triangle de mobilisation « genre-race-climat » et l’ensemble des minorités — Français de culture musulmane en tête —, ne peut être victorieuse car il lui manque l’immense cohorte des travailleurs de la France périurbaine. Cette stratégie, confie-t-il alors, l’avait déjà convaincu, il y a une douzaine d’années, de s’engager en politique pour justement la combattre…
A lire Ruffin, du travail, la guerre des gauches serait donc déclarée… Cette guerre s’est même récemment invitée dans un débat purement médiatique entre « gauche du travail », incarnée par le communiste Fabien Roussel, et « gauche de la paresse », défendue par l’inénarrable Sandrine Rousseau. Derrière cette passe d’armes un peu grotesque se tient en réalité un débat essentiel sur le sens et la place du travail dans une économie de services, produit de 40 ans de globalisation. Cette controverse s’insère elle-même dans un ensemble plus vaste traitant de la recomposition de ce que l’on peut appeler la « gauche de transformation sociale ».
Depuis les faux-semblants du quinquennat Hollande, celle-ci a compris qu’il lui faut faire son deuil définitif des instruments classiques auxquels elle s’en remettait pour « transformer » la société. De la socialisation des moyens de production chère au PCF jusqu’au keynésianisme redistributif propre à la social-démocratie, aucun ne fonctionne plus vraiment et surtout ne fait recette électoralement. Mais par-delà la politique économique, c’est aussi toute une vision du social et donc du travail qu’il s’agit de revisiter. Telle est la situation qui explique pour une bonne part les échecs et impasses actuels de la gauche et, parallèlement, les progrès de l’extrême droite.
C’est donc à cette aune qu’il faut lire le livre de François Ruffin et comprendre les débats qu’il suscite sur la question du travail. Faut-il laisser cette gauche de transformation se convertir en une seule gauche de protestation et de gesticulation ? A dire vrai, c’est à peu près l’unique proposition actuelle de la coalition NUPES : cette dernière est, par principe, rétive à toute participation au pouvoir et donc, à défaut de le renverser par une motion de censure impossible à faire voter, elle ne compte plus que sur une pression extérieure, éventuellement violente, pour arracher des concessions aux gouvernements en place — c’est également le dilemme qui traverse les Verts, membre de cette même coalition, aux prises avec une « écologie de combat », soutenue une nouvelle fois par Sandrine Rousseau contre les caciques du parti, installés et masculins… Depuis le tournant de la loi travail, en 2016, le retour de la violence ou de l’acceptation tacite de la violence à gauche ne s’explique pas autrement ; son objet est d’exprimer un refus moral radical de l’ordre l’existant en créant avec celui-ci un rapport de force, miroir de sa faiblesse électorale.
Cette mutation, dont le député de la Somme a pourtant été l’un des hérauts — ne demandait-il pas à « conflictualiser » toutes les situations possibles ? — est précisément ce qui ne lui convient plus aujourd’hui, avouant même récemment qu’il se « socedémisait » (Voir à ce sujet l’entretien donné par Fr. Ruffin au magazine L’Obs le 10 novembre 2022 et titré justement : « Je suis social-démocrate »). D’où sa réhabilitation de la question du travail lui permettant d’abandonner la morale pour recoller aux classes populaires et proposer une porte de sortie à gauche. C’est cette grille de lecture qui faut avoir en tête si l’on veut apprécier les apports comme les apories de ce court texte, à la fois convaincant pour une âme de gauche, mais en définitive, relativement léger pour un observateur des transformations du social, quand bien même l’auteur a-t-il l’immense mérite d’insister sur la centralité du travail et d’oser affronter le conflit à l’œuvre autour de cette question. Au moins ce livre constitue une base sur laquelle appuyer une réflexion à gauche. Car c’est finalement moins le propos (assez classique) qui importe que l’identité de ceux qui le tiennent aujourd’hui, et anime le débat, qu’il s’agisse de François Ruffin, de Fabien Roussel ou de Michaël Delafosse. Un débat lié à deux éléments actuellement structurants : d’un côté, la création de France Travail qui, dans un perspective de quasi plein emploi, vise à substituer la thématique du travail à celle de l’emploi, à la suite de la même « conversion » opérée par les grands syndicats il y a une dizaine d’années, tout en radicalisant une telle position par la subordination, par exemple, du versement du RSA à des heures de travail ; d’autre part, la crise Covid, marquée par un télétravail massif ainsi qu’une très haute visibilité sociale des travailleurs essentiels, qui a fortement ébranlé notre rapport au travail et à ses hiérarchies au point que la CFDT a proposé des Assises du travail dans lesquelles elle s’implique. Cette question étant en effet essentielle, car derrière la panique autour du vote populaire, du pouvoir d’achat ou des pénuries de main d’œuvre, se lit une très profonde remise en cause de la hiérarchie des valeurs sociales : qui vaut quoi ?… Personne n’est plus capable de le formuler, ni la pensée politique, ni la théorie économique. Le sujet se traduit évidemment en termes salariaux, mais le revenu n’est que l’aspect visible d’un problème bien plus profond : celui des hiérarchies sociales, explicites ou non. La société du compromis social-démocrate bâtie après-guerre était encore une société à statuts dans laquelle les hiérarchies étaient visibles, compréhensibles et acceptées ; la société de marché dans laquelle nous évoluons depuis quelques décennies est bien plus décloisonnée, fluide et chacun se retrouve à se comparer aux autres en permanence afin d’apprécier sa propre utilité et donc son classement dans l’échelle sociale. C’est le sens à la fois de la défiance des catégories populaires vis-à-vis du système socio-politique — les travailleurs socialement invisibles sont-ils si indispensables qu’on le dit puisqu’ils sont si mal payés ? — et du grand questionnement des autres secteurs de la population active sur le sens du travail — que vaut-il réellement ? C’est donc à un tel débat que nous voudrions participer en discutant quelques éléments mis en avant par François Ruffin dans son ouvrage.
Quand il y a du travail pour tous, personne ne regarde la religion ou la couleur de peau de son voisin
Souhaitant s’attaquer à la séduction qu’exerce le RN sur les catégories populaires, Ruffin affronte en premier lieu la question identitaire. Cette méfiance vis-à-vis de l’immigration, fonds de commerce frontiste, lui paraît faire diversion par rapport à la seule question valable, celle de l’emploi et du travail. S’il reconnaît la possibilité d’un malaise identitaire propre aux plus modestes, il le rabat tout entier — pour le dissoudre — sur la question sociale à travers le seul réarmement du travail : « quand il y a du travail pour tous, explique-t -il, personne ne regarde la religion ou la couleur de peau de son voisin ». « L’insécurité culturelle » ne serait en réalité qu’une manifestation un peu simpliste et dévoyée d’une question économique plus vaste : celle de la mondialisation, voire de l’européanisation, et de la désindustrialisation qu’elles ont entraînées l’une et l’autre. De fait, l’auteur est habité par la croyance que la fragmentation culturelle des classes populaires serait soluble dans une approche uniquement sociale : ce que l’on pourrait appeler l’unité de la question sociale, qu’il ne cesse de marteler. Ruffin ne dit pas, comme les socialistes du début des années 2000, qu’avec un peu de croissance on règlerait la question de l’extrême droite, mais il est certain que le travail reste le grand égalisateur des conditions et le grand intégrateur, comme cela fut le cas dans les décennies 50-70.
Comme j’ai essayé de le montrer dans mon livre Indispensables mais invisibles (Denis Maillard, Indispensables mais invisibles, reconnaître les travailleurs en première ligne, Ed. de l’Aube 2021), c’est précisément sur ce point que bute la pensée de gauche opposée à l’extrême droite : l’individualisation de la société ou du travail et l’insécurité culturelle qui touchent les classes populaires (quelle que soit leur culture d’ailleurs…) ne permettent pas d’être aussi affirmatif quant à la seule efficacité du combat de classe ; les conditions de l’autonomie (collective et individuelle) d’une part et celles d’un cadre commun dans lequel organiser les trajectoires sociales d’autre part, doivent être pensées en même temps que la question du travail ; cette dernière, aussi primordiale soit-elle, n’étant pas unique pour saisir le désarroi politique des catégories populaires.
Prenons un exemple qu’affectionne François Ruffin, celui de deux aides-soignantes, l’une d’un EHPAD en Charente et l’autre d’un hôpital en Seine–Saint-Denis : du point de vue de leurs conditions de travail, de leurs rémunérations, de leurs modes de vie et de la reconnaissance sociale qu’elles espèrent l’une et l’autre, l’aide-soignante de Charente partage réellement quelque chose avec celle de Seine–Saint-Denis — sur ce point le député a raison alors même que l’une a pu revêtir un gilet jaune en 2018 et l’autre rester silencieuse à la même période, l’une voter pour Marine Le Pen et l’autre pour Jean-Luc Mélenchon (si elle a la nationalité française)… C’est d’ailleurs l’une des principales révélations de la crise Covid-19 que de faire surgir l’expérience du travail et la place que celle-ci assigne dans le processus de production comme l’opérateur permettant de lier des millions de personnes entre elles. De fait, l’accentuation servicielle de la société a révélé, sous une pluralité de situations, une homogénéité sociale à partir d’une expérience commune issue de la relation de travail et de la place que celle-ci occupe dans la division des tâches : sous les milieux populaires, la classe de services… Évidemment, selon le métier ou la localisation de l’activité professionnelle, on retrouvera majoritairement des femmes ou au contraire uniquement des hommes, des populations principalement issues de l’immigration ou assimilés aux « petits blancs », mais aussi des situations sociales et des statuts hétérogènes : intérimaires, indépendants, salariés, petits fonctionnaires ou artisans… Au-delà de leurs identités multiples ou de la diversité des statuts, quelque chose concourt à les unir : leur expérience du travail dans la société de services, c’est-à-dire leur appartenance à ce que j’ai appelé le back-office de la société, longtemps passé inaperçu jusqu’à la révolte des Gilets jaunes.
Et pourtant…, derrière cette homogénéité sociale assez remarquable, les membres de cette « classe de services » vivent dans des représentations complètement éclatées par le triomphe du libéralisme culturel qui accompagne la société de services et émiette les références communes. C’est là que le raisonnement de Ruffin trouve sa limite. Et cette fragmentation est la principale raison de l’incapacité politique à penser la question sociale… Et une part des problèmes actuels de la gauche : la fragmentation culturelle est due en partie à la diversité de modes de vie ainsi qu’à une pluralité d’identités, propre aux sociétés multiculturelles, mais survalorisée par « l’âge identitaire » dans lequel nous baignons définitivement — et dont la gauche se repaît tout en se refusant à le penser. Toutes ces petites différences (ethniques, sexuelles, religieuses, voire statutaires), qui passaient pour être des identités « secondaires » au sein de la classe ouvrière, sont devenues des caractéristiques aussi importantes que la situation sociale. Et elles ne sont malheureusement pas solubles dans le seul travail. Là aussi l’archipélisation de la société a des conséquences.
La réalité, à laquelle se refuse Ruffin, tient dans le fait que l’insécurité identitaire et culturelle n’est pas unique dans l’univers des contraintes et des angoisses qui pèsent sur les catégories populaires ; s’y additionnent en effet, outre l’insécurité économique et sociale qui est au cœur de son propos, une insécurité matérielle et physique qu’il aborde à peine alors qu’elle pèse plus lourdement sur les plus modestes, mais aussi une nouvelle forme d’insécurité que l’on pourrait appeler « civique et territoriale » que l’on a vu s’exprimer pleinement lors de la dernière élection présidentielle, notamment au second tour : l’opposition des centres et de leurs périphéries.
Ainsi, le vote Le Pen n’apparaît pas seulement fondé sur des critères socio-économiques, mais aussi sur une relation particulière aux centres politiques, administratifs, économiques et culturels et au sentiment de déclin relatif que l’on ressent d’habiter à leur périphérie tout en devant s’y rendre pour travailler. À cet égard, il est notable qu’aucune préfecture sauf une (Laon) — et une minorité de sous-préfectures — ne vote pour Marine Le Pen ; tout l’ouest également se refuse à elle et tout le littoral à l’exception de la Côte d’Azur. Autrement dit, l’extrême droite prospère dans une France qui n’est pas seulement économiquement déclassée, mais se vit « à l’écart » des centres urbains et des grandes voies de communication, comme les lignes TGV par exemple, incapable d’éviter le conflit social et la panique identitaire dans lesquels sa géographie les plonge… Comme le notait le Préfet Gilles Clavreul, « De fait, cette élection apparait comme une illustration presque chimiquement pure d’un clivage : non pas celui du centre et de la périphérie, mais “des centres” et de leurs propres périphéries. En somme, La République en Marche face à La République des marches ». Ainsi aux trois insécurités bien repérées depuis 2012 — insécurité physique et matérielle, insécurité économique et sociale et insécurité identitaire et culturelle —, on peut ajouter cette fois-ci une nouvelle « insécurité civique et territoriale » qui permet de se représenter géographiquement la situation des classes populaires. Et qui dépasse largement la seule question du travail, mais touche, en réalité, très largement à la question de l’autonomie individuelle, professionnelle et civique de ces populations.
Ce qui amène une autre réflexion par rapport au travail lui-même : donner comme seule réponse à l’ensemble de ces questions, celle d’un réarmement du travail — sur le modèle de l’illustre classe ouvrière et de sa fierté du travail accompli, en somme une conscience de classe — c’est faire courir au travail lui-même un autre risque, un risque identitaire là aussi.
Comme nous venons de le signaler, la société de marché qui s’est mise en place depuis une trentaine d’années est doublée d’une société identitaire à laquelle le discours sur le travail n’échappe pas plus que le reste. Si bien que la crise du travail à gauche, dénoncée par Ruffin, ne produit pas, pour le moment, d’autres idées et solutions qu’identitaires elles aussi. En effet, si le travail réel, celui que nous fournissons nonobstant la place occupée dans la division du travail, ne correspond pas à ce que nous voudrions qu’il soit — en philosophie, on dirait « ne correspond pas à son concept » — alors il n’y a que deux solutions : soit son abolition, c’est la voie suivie par une partie de la gauche depuis les années 1970 jusqu’à aujourd’hui, chez les tenants de la réduction du temps de travail puis du revenu universel (nous allons y revenir) ; soit son « réarmement » comme nous venons de le voir. Toutefois, ce dernier n’est malheureusement toujours envisagé que d’un point de vue individuel, donc identitaire. En effet, le travail-passion, le travail « expressif » dont parlent les sociologues, ne peut se réaliser comme tel que si l’identité externe du travailleur (celle qui n’est pas directement liée aux règles et savoir-faire de métier) est particulièrement mobilisée : c’est précisément cette « identité » (qu’il s’agisse de motivation intrinsèque, de personnalité et de créativité), que ledit travailleur va devoir investir dans son métier afin de réduire l’écart entre l’idéal auquel il aspire et la réalité prosaïque qu’il exerce ; ou entre le prescrit et le réalisé ou encore entre la vie pro et la vie perso. ; ce qui tend alors à transformer l’expérience de travail en une « expérience exceptionnelle », comme le sont les situations de spectacle et désormais de consommation — le travail étant alors ramené à une consommation comme une autre. Or, le travail correspond rarement à cette réalité. Surtout dans les métiers du back-office dont on connaît l’ensemble des contraintes et pénibilités qui pèsent sur eux. Ce qui induit d’ailleurs une séparation de plus en plus nette entre ceux qui voient dans leur travail une source de félicité et les plus modestes qui vivent encore le travail comme la source de leur dignité, soit le travail comme consommation immatérielle ou le travail permettant la consommation matérielle.
Mais allons un cran plus loin sur le sens du travail pour les catégories populaires. Ce sens est généralement défini par quatre variables : la capacité à utiliser pleinement ses compétences, l’autonomie dans le travail, l’utilité sociale et la sociabilité au travail. Or, il s’avère que la division sexuelle des métiers au sein du « back office de la société » induit deux conséquences majeures, d’une part une territorialisation du travail des femmes dans des métiers du soin ou du lien sur ou à proximité de leurs lieux de vie, comme le montre très bien le beau livre de Vincent Jarousseau, Les femmes du lien (Vincent Jarousseau, Les femmes du lien, la vraie vie des travailleuses essentielles, Les Arènes 2022), imposant de facto aux hommes une mobilité liée aux métiers de chauffeurs routiers, de transporteurs, de livreurs ou de caristes sur des plateformes logistiques donc loin de leurs domiciles ; d’autre part, une plus forte perte de sens au travail chez les hommes au cours des dernières décennies puisque ce mouvement de territorialisation-déterritorialisation affecte les quatre variables évoquées ci-dessus s’agissant d’hommes qui occupent des métiers où les compétences ne sont pas ou peu reconnues et dans lesquels le logiciel impose souvent la cadence au détriment de l’autonomie et de la sociabilité. Par conséquent, ce sont les hommes peu diplômés et occupant des métiers peu valorisés qui subissent de plein fouet cette perte de sens. Et les mêmes aussi qui votent plus largement pour l’extrême droite. Le lien entre classes populaires et vote RN apparaît donc moins lié à un simple oubli du travail qu’à un entremêlement de diverses dimensions de l’existence périurbaine ou rurale.
S’il n’aborde pas la question en tant que telle, notre député plaide cependant pour des droits sociaux collectifs pour tous afin de ne pas individualiser la pauvreté. Ce qui ouvre sur un autre débat que Ruffin ne déserte pas : celui de l’assistanat, rebaptisé débat entre « gauche du travail » contre « gauche des allocs » ou « gauche de la paresse ».
Allocataires de tous les régimes, reposez-vous !
De fait, il y a bien un débat à gauche à propos des classes populaires sur la question du soutien social à leur apporter qui a pour noms « allocations », « assistanat », « cas soc’ ». Si Ruffin pointe le problème de ce traitement social des classes populaires — De « parti des salariés », nous voilà, dans l’esprit commun, le « parti des assistés » », écrit-il — il se contente habilement de faire parler les intéressés sans donner son avis, tout en souhaitant quand même casser la dynamique de la critique de « l’assistanat » par l’affirmation de la dimension essentiellement collective — c’est-à-dire universelle — des droits sociaux.
Toutefois, cette pensée peine à définir ce que devraient être ces nouveaux droits. Aucune mention par exemple, ni a fortiori critique, de ce qu’on peut appeler « la vie à points », c’est-à-dire cette multiplication de « comptes personnels » (de formation, de pénibilité, d’activité, de temps, etc.). En théorie, tous paraissent répondre à la question de la variété des trajectoires individuelles en personnalisant les droits acquis. On peut pourtant se demander si, en réalité, ils n’insécurisent pas plus les catégories populaires, installant, de fait, les mécanismes de la société de marché au cœur du social sans répondre réellement à la question essentielle de l’autonomie laquelle n’est malheureusement pas immédiatement accessible aux plus modestes ; si bien que tous ces comptes ne sont adaptés, compréhensibles et effectifs que pour les plus autonomes des travailleurs.
Quels droits collectifs seraient aujourd’hui assez puissants face à la séduction qu’exerce sur la gauche la pensée de la personnalisation des parcours, de la « consommation de travail » et du « droit à l’allocation », quelle que soit la forme que celles-ci prennent ? On peine à répondre à cette question. Car, depuis les années 90 et l’acceptation du marché par la gauche, on note une réelle préférence pour l’allocation sur le salaire. Ce faisant, c’est toute la société qui s’est ralliée à un point de vue que l’on pourrait dire « de droite », faisant du travail une « valeur » pour en relativiser sa rémunération puisqu’étant un bien en soi, travailler est d’ores et déjà une rémunération autre que matérielle… Face à ce renversement total du front idéologique, la pensée de gauche ne pouvait ensuite que relativiser cette nouvelle « valeur travail », selon deux options : en expliquant, d’une part, que cette « valeur » était en voie de disparition — alors que c’est en réalité le sens du travail, tel que nous l’avons défini plus haut, qui est concerné — ou en la faisant quasiment disparaître, d’autre part, par une plus grande porosité avec l’allocation. Comme l’a bien montré le sociologue Nicolas Duvoux dans une tribune récente parue dans Le Monde (« Contrairement à ce qu’affirme Fabien Roussel, il n’y a plus de séparation claire entre le monde du travail et celui des prestations sociales », Le Monde, 14 septembre 2022), la frontière est devenue entièrement poreuse entre « assistés » et « salariés pauvres » (qui touchent par exemple la prime d’activité).
Alors que le RMI existait déjà depuis plus d’une dizaine d’années, c’est à partir du tout début des années 2000 que la gauche au pouvoir s’aperçoit que les travailleurs les plus modestes ne peuvent pas compter sur leur seul salaire pour faire face à ce que l’on appelle aujourd’hui les « dépenses contraintes », comme le logement, le chauffage ou le transport dont on a vu pourtant qu’ils étaient devenus des variables largement explicatives du rapport à l’ensemble social. Plutôt que d’augmenter les salaires, ce qui aurait impliqué d’entrer dans un rapport de force avec les entreprises au risque de détériorer la fameuse compétitivité-coût, toute la politique sociale a constitué en un soutien aux revenus des travailleurs pauvres ou modestes en interpénétrant le monde du travail et celui des allocations : prime pour l’emploi (2001), RSA (2008) ou prime d’activité (2016). « Depuis le début des années 2000, écrit Nicolas Duvoux, la dichotomie entre ce qui relève de l’assistance et ce qui relève du soutien au travail — notamment au travail précaire et mal rémunéré — ne tient plus. (…) Une partie significative des allocataires de cette prestation emblématique qu’est le RSA circule en effet constamment entre l’assistance et le travail salarié, souvent dans des conditions précaires et dégradées. Pour certains, ces prestations constituent un soutien ponctuel, un ancrage pour une reconversion professionnelle ou une manière de pallier une séparation. Pour d’autres, elles sont un ultime recours, souvent de longue durée, contre la misère… »
Les prestations sociales sont donc devenues un véritable complément de salaire pour les salariés rémunérés jusqu’à un SMIC et demi, effaçant de fait la frontière entre le salariat et l’assistance. D’où cette défiance permanente vis-à-vis de ceux qui ne vivent plus que des allocations et la lutte pour s’en démarquer afin de ne pas tomber dans l’assistance et devenir à son tour un « cassos », comme cela est parfaitement décrit dans l’ouvrage majeur de Bruno Coquard, Ceux qui restent (Bruno Coquard, Ceux qui restent, faire sa vie dans les campagnes en déclin, La Découverte 2019), véritable ethnologie des jeunes ouvriers de milieux ruraux.
La valorisation du travail et de l’effort et la critique de l’assistanat « est en fait une demande de respectabilité — et elle s’exprime d’autant plus violemment que la proximité sociale encourage la distance symbolique et morale », conclut Nicolas Duvoux ; une manière d’être acteur de sa propre histoire, c’est-à-dire autonome. Si bien que ce n’est pas tant l’utilité de l’allocation qui est contestée que l’image qu’elle renvoie de soi-même. Par ailleurs, la décroissance de la production matérielle qui nous attend posera sans doute, à l’avenir, la question des revenus de transition et des revenus hors travail ; toutefois cette réalité est tout à fait envisageable si elle apparaît comme éminemment transitoire et non pas comme une fin en soi : l’objet du revenu de substitution n’est donc pas la paresse, mais la négociation de transitions ou, comme on dit aujourd’hui de « bifurcation » pour ne pas parler de repositionnement. En effet, aux yeux des classes populaires l’idée qu’il existerait un « droit à la paresse » permettant le repos et l’émancipation vis-à-vis du travail et donc sa critique grâce à la réduction du temps de travail ou à un revenu universel, manque l’objet même de ce qu’elle vise. « Allocataires de tous les régimes, reposez-vous ! » n’est pas vraiment le mot d’ordre des nouveaux prolétaires. Car ce n’est pas le travail qui pose problème en tant que tel, mais l’ensemble des contraintes qu’impose la place occupée dans la division du travail et, partant, la difficulté à se sentir autonome. C’est l’une des grandes leçons de la crise des Gilets jaunes : on ne critique plus la répartition de la valeur au sein de l’entreprise, mais les institutions qui organisent l’ensemble de la vie autour du travail et la rendent plus ou moins supportable.
On le comprend dorénavant, le problème de la gauche dépasse la seule question du réarmement du travail comme le dit François Ruffin. Il concerne en réalité ce que l’on pourrait appeler « la politique de la vie quotidienne » visant l’autonomie des individus sans demander à ce qu’ils changent radicalement qui ils sont, mais en souhaitant amoindrir les contraintes qui pèsent sur eux. Aujourd’hui, l’absence d’une telle perspective émancipatrice ne permet plus de dépasser les divisions internes de la société. Il s’agirait alors de privilégier la tâche politique permettant de faire tenir ensemble l’ensemble de ces destins individuels, objectivement homogènes, mais subjectivement enfermés dans des visions radicalement individualisées de leur destin et dans un rapport hétérogène au travail.








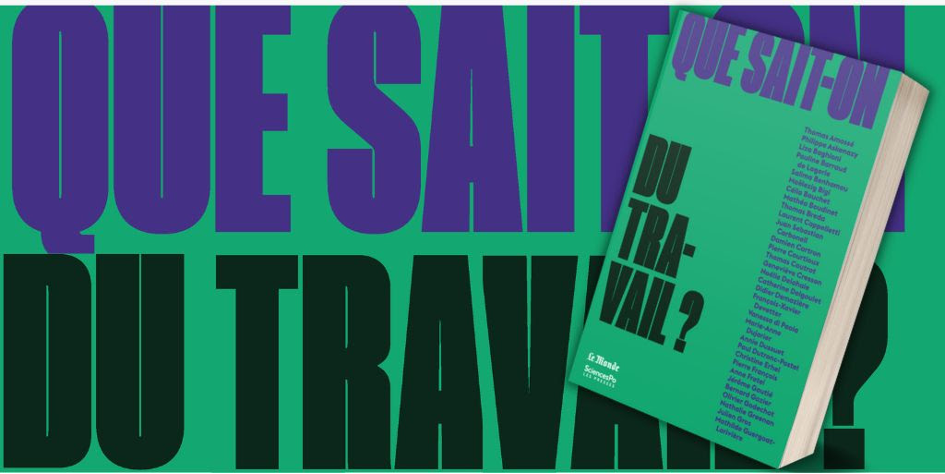
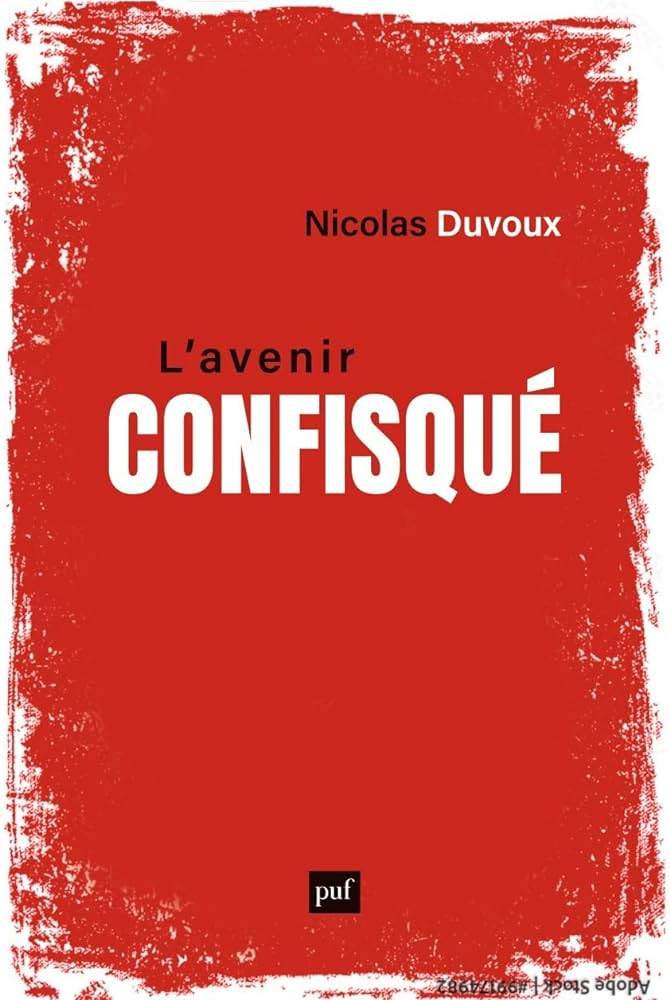
Bonjour, j’ai lu d’un trait ce très long et très nécessaire article qui nourrit activement nos méninges…
Bravo, sur le coup, je n’arrive pas à réagir à toutes les réflexions solidement argumentées.
Juste mon accord spontané pour la référence donnée, en dernière partie, à l’article de Nicolas Duvoux : je l’avais découpé et mis de côté pour y réfléchir dans la mesure où, écrivain public bénévole dans un centre social (urbain), je rencontre et accompagne majoritairement des travailleurs (très) modestes et des allocataires en dérive, des casoss…
Bonne journée réflexive à tous.
Jean-Jacques Guéant