Xavier Baron dans son article « Le travail de maintenance : entre danse et éthique de l’entretien » a livré sa lecture du livre de Jérôme Denis et David Pontille, Le Soin des choses, Politiques de la maintenance. Denis Maillard le lit à son tour, en s’appuyant sur les philosophes convoqués.
 À mon avis, les apports de cet ouvrage — sans doute le meilleur de sa catégorie en 2022 — sont de trois ordres : d’un point de vue socio-politique, le livre sort les activités de maintenance du désintérêt que nous affichons généralement à leur égard, fascinés que nous sommes par la question, peut-être plus urgente mais surtout plus héroïque, de la réparation. Cette réévaluation installe la maintenance comme un monde en soi et permet que surgisse alors au sein des travailleurs indispensables, mais socialement invisibles, un nouveau continent, celui des travailleurs de la maintenance des choses, jusqu’ici totalement invisibles. D’un point de vue philosophique, si le nom d’Hannah Arendt est absent de l’ouvrage, c’est bien avec sa conception du travail comme activité cyclique et rébarbative, donc dévalorisée par rapport à l’œuvre et à l’action, que les auteurs rompent quelques lances en remettant à l’honneur le « maintien en l’état » ; avec en contrepoint la construction d’un nouveau droit : le droit à la réparation. Enfin, d’un point de vue social, on découvre, derrière la pensée de la maintenance, une extension de la notion de « Care » qui en renouvelle l’approche.
À mon avis, les apports de cet ouvrage — sans doute le meilleur de sa catégorie en 2022 — sont de trois ordres : d’un point de vue socio-politique, le livre sort les activités de maintenance du désintérêt que nous affichons généralement à leur égard, fascinés que nous sommes par la question, peut-être plus urgente mais surtout plus héroïque, de la réparation. Cette réévaluation installe la maintenance comme un monde en soi et permet que surgisse alors au sein des travailleurs indispensables, mais socialement invisibles, un nouveau continent, celui des travailleurs de la maintenance des choses, jusqu’ici totalement invisibles. D’un point de vue philosophique, si le nom d’Hannah Arendt est absent de l’ouvrage, c’est bien avec sa conception du travail comme activité cyclique et rébarbative, donc dévalorisée par rapport à l’œuvre et à l’action, que les auteurs rompent quelques lances en remettant à l’honneur le « maintien en l’état » ; avec en contrepoint la construction d’un nouveau droit : le droit à la réparation. Enfin, d’un point de vue social, on découvre, derrière la pensée de la maintenance, une extension de la notion de « Care » qui en renouvelle l’approche.
Contre l’héroïsme de la réparation, la routine de la maintenance
Notre époque est largement dominée par une urgence tant humanitaire qu’écologique, celle de « réparer les vivants » selon la belle formule-titre de Maylis de Kerangal et, partant, de réparer le monde. C’est avec cette omniprésence de la pensée de la réparation que le livre de Jérôme Denis et David Pontille prend ses distances ; non pour la critiquer en tant que telle, mais pour réclamer à ses côtés une place à la maintenance comme une autre appréhension du monde et des choses : « faire durer plutôt que remettre en ordre », tel serait le programme que nos auteurs assignent à leurs Politiques de la maintenance.
Leur critique se développe en deux temps : ils partent, en premier lieu, d’une pensée de la routine, comme forme d’une présence au monde réelle et précieuse, contre l’héroïsme de la réparation. « La leçon est limpide, expliquent les auteurs : le travail de maintenance est sans fin. Il ne fait jamais événement, il ne s’organise pas autour d’une disjonction entre deux états du monde, il se déploie dans les interstices des jours et des nuits, où rien ne semble se passer. Il n’est pas l’exception à la routine, l’écart à la trajectoire linéaire du monde, mais ce qui est continuellement effectué afin que la routine et la linéarité soient possibles. Il génère la continuité, il la cultive. Quand la réparation fonctionne par à-coups exceptionnels, la maintenance est une pulsation quotidienne ». En effet, « la panne et la réparation des infrastructures partagent avec la conception et la fabrication la même capacité d’excitation. La maintenance, au contraire, n’a rien d’excitant ». L’élément clé qui sépare maintenance et réparation est précisément celui-ci : si le travail de maintenance est fait correctement, il ne se passe rien…
Cette insistance sur la routine et l’ordinaire rencontre nécessairement un auteur qui, a contrario, a fait de la réparation une manière d’être au monde plus profonde et plus authentique que tout le reste : Matthew Crawford et L’éloge du carburateur (voir la note dans Metis), c’est le second élément de la critique. L’idée centrale du livre de Crawford est que, dans la modernité, le « vrai travail » tend à disparaître parce que le lien matériel privilégié, et entretenu séculairement, entre l’homme et sa machine s’est progressivement distendu au point de faire du travail intellectuel un travail inauthentique. Face à cela, le travail de réparation, c’est-à-dire l’activité de contact avec la matière, que représentent les actes de fabriquer et de réparer, serait la plus authentique qui soit, rejetant tout le reste dans un ordre subalterne. Pour les auteurs du Soin des choses, « l’hypothèse est séduisante. Mais elle ne résiste pas à l’observation attentive des pratiques de maintenance. Nous avons vu qu’il n’y avait aucune raison de distinguer a priori les nombreuses modalités d’appréhender la matière, qu’elles passent par le toucher, l’odorat… ou des instruments qui prolongent et équipent la sensibilité et touchent et sentent à leur manière ».
Cette mise à distance de ce qui apparaît en réalité comme une restauration de la philosophie aristotélicienne, permet aux auteurs de nuancer également l’héroïsation de la geste réparatrice. Pour eux, « les rares héros et héroïnes s’occupent des situations extraordinaires. Les nombreux travailleurs et travailleuses de la maintenance se chargent de la normalité. Et c’est un sacré boulot ». Cette remarque est importante, car elle met l’accent sur la réalité des « gens ordinaires » véritables, bien loin des idéalisations qui en sont faites actuellement — on pense par exemple à Christophe Guilluy qui fait des « gens ordinaires » le moteur d’une nouvelle dynamique de l’histoire des sociétés occidentales. Rien de tel ici où les « gens ordinaires » sont d’une autre nature. En effet, par rapport à la dynamique de la casse et de la restauration, « la maintenance oblige d’une part à se préoccuper de ce qui ne fait pas événement et d’autre part à prendre en considération toutes celles et tous ceux qui y participent, qui ne sont ni héroïnes ni héros ». Ce faisant, le propos des auteurs du Soin des choses oblige à ouvrir les yeux sur une dimension du « back office de la société de services » régulièrement passée sous silence, celle de ces hommes et de ces femmes dont le métier est tout simplement de prendre soin des choses : ils ne charrient pas, ils ne transportent pas, ils ne livrent pas, ils ne vendent pas, ils ne gardent pas, ils maintiennent…
Si l’on peut regretter que les deux auteurs n’insistent pas assez à notre goût sur l’identité sociale et professionnelle de ces travailleurs pour se concentrer sur les choses elles-mêmes, ils prennent justement soin de ne pas « dessiner un portrait misérabiliste du travail de maintenance. La dureté de l’activité physique et la masculinité s’articulent dans la maintenance mécanique, la souffrance même est parfois le moteur du sens du travail, notamment parce qu’elle donne la mesure de ce qui est beau et utile dans l’expérience d’un métier souvent dévalorisé par les autres ». Et plus loin, ils ajoutent : « Si les hommes et les femmes qui prennent soin des choses comptent, et si nous voulons participer à leur reconnaissance, c’est aussi parce qu’ils engagent leur corps dans le processus de la maintenance, qu’ils associent intimement leur devenir corporel à celui des choses, qu’ils agissent dans un cadre professionnel ou pas. Et tandis qu’ils nous apprennent à devenir attentifs aux transformations incessantes de la matière à travers l’attention propre qu’ils y consacrent, nous devons aussi garder un œil sur les signes de leur propre usure ». Propos importants, mais malheureusement trop lapidaires pour construire une véritable compréhension du travail de maintenance, au profit de l’action de maintenir et des choses elles-mêmes, véritables objets du livre.
Contre Heidegger et Arendt, le droit à la réparation
La beauté du livre réside aussi dans l’exercice de philosophie qu’il propose à propos d’un sujet — la maintenance — qui n’apparaît pas si riche à première vue. Les auteurs justifient d’abord leur choix de vocabulaire — Le soin des choses — en se référant à Heidegger pour mieux s’en démarquer : comme le philosophe allemand, ils distinguent les « objets » des « choses », mais pour accueillir au sein de cette seconde catégorie un grand nombre d’objets rejetés à priori : « Comme l’explique Latour, Heidegger sépare a priori les objets, issus de la technologie moderne (forcément pauvres), des choses, dont le caractère artisanal, voire poétique, assure des formes de connexion riches vers lesquelles il faudrait pouvoir revenir. Tout comme Latour, nous refusons de décider à l’avance et voulons laisser la possibilité à des objets apparemment banals et standardisés d’être traités comme des choses. C’est même la grande force de la maintenance que de nous faire littéralement redécouvrir des artefacts souvent dévalorisés ».
Ce pas de côté vis-à-vis de la philosophie heideggérienne a deux conséquences, l’une explicitée, l’autre moins perceptible : sensibles aux activités de maintenance et donc au monde industriel, nos deux auteurs ne sont pas dans une perspective de rupture avec la modernité ; ils expliquent mettre de côté Heidegger pour aller chercher leur référence du côté de la philosophie pragmatiste « la distinction (souple, rappelons-le) que nous proposons d’établir entre les objets et les choses, en particulier dans ce que William James appelle les “pragmata” : ces “choses en tant qu’elles ne sont pas données”. Les choses sont inachevées. Elles sont en permanence en train de se faire. Elles restent même “à faire”, pour emprunter cette fois au précieux registre d’Étienne Souriau. Les femmes et les hommes qui en prennent soin le savent bien, puisqu’ils s’en inquiètent et qu’ils participent directement à ce “faire”, fragile et incertain ».
Contre les objets, les deux auteurs vont donc privilégier les choses afin de souligner leur dimension à la fois altérable et imprévisible justifiant ainsi la maintenance comme activité noble. En effet, dans la maintenance, ce qu’ils appellent le « devenir préoccupant des choses » revêt une épaisseur qui démarque celles-ci de la transparence et de l’apparente platitude des objets. Avec les choses, les matériaux se mettent à compter, l’entretien et la durée deviennent des activités sensées, un professionnalisme est alors possible.
C’est ici qu’apparaît une critique de la pensée de Hannah Arendt sur le travail, même si celle-ci n’est jamais citée dans tout l’ouvrage. On connaît la distinction et, partant, la hiérarchisation qu’Arendt opère dans les activités humaines entre les plus hautes, l’action et l’œuvre, et la plus basse, le travail qui nécessite de lutter cycliquement contre le travail de sape de la nature. Chez elle, le travail de maintenance — puisqu’il n’y a, en quelque sorte, de travail que de maintenance — ne procure rien d’intéressant à l’humanité, ni dans sa construction ni dans sa compréhension ni, encore moins, dans son fonctionnement : rébarbatif, monotone, cyclique, attaché à la transformation de la nature, mais toujours soumis à la corrosion que celle-ci lui impose, le travail n’exprime que très peu le proprement humain et cette capacité de s’arracher au naturel pour créer du neuf et du durable. On voit donc bien ce que l’ouvrage de Jérôme Denis et David Pontille oppose à cette vision. En centrant leur réflexion sur ce qu’ils nomment « la danse de la maintenance », comme expression de l’humanité, ils assument, comme le faisait déjà Francis Ponge, un véritable « parti-pris des choses » et des humains qui leur permettent de durer, exprimant de la sorte la stabilité du monde. C’est ce qu’ils affirment sans ambages dès le départ du livre : « Le premier geste politique que nous souhaitons défendre dans cet ouvrage : assumer un retour à ce que Bruno Latour a appelé la “masse manquante du social”, cette multitude d’objets avec lesquels, grâce auxquels, les femmes et les hommes font société ».
Comme l’indique le sous-titre du livre, le propos des auteurs est politique. De fait, à côté de cette prise en compte de la « masse manquante du social », se profile la question des droits pouvant être associés à cette Politique de la maintenance. Si les auteurs mettent en garde contre l’illusion de maintenir absolument tout dans une vision conservatrice du monde à l’égard de choses, de matériaux ou de procédés insoutenables, ils avancent néanmoins l’idée d’un droit à la maintenance à travers ce qu’ils nomment le droit de réparation dans la lignée des activistes de iFixit. Ceux-ci distinguent en effet la propriété des objets selon que le consommateur dispose d’une possibilité — d’un droit — de les faire réparer : « Si vous ne pouvez pas le réparer, cela ne vous appartient pas ». En effet, disent Jérôme Denis et David Pontille, « Lorsque l’on se place du point de vue de la personne qui achète quelque chose (un smartphone, un grille-pain, un tracteur), la question du droit, ou non, à réparer l’objet en question a des ramifications assez importantes. Elle a, en particulier, des répercussions sur son propre statut d’utilisatrice, puisque le droit à la réparation pose le problème générique du périmètre des actions possibles qu’une personne est en mesure d’effectuer sur un bien qui lui appartient. Discuter les limites de ce droit revient dans cette perspective à mettre en débat certains aspects d’une interrogation assez abyssale : “Qu’est-ce qu’utiliser ?”. » Ainsi, le droit à la réparation, inscrite dans les objets eux-mêmes dès leur fabrication et leur consommation, permet de réconcilier l’usage et la maintenance, celle-ci devenant ainsi un élément de la transition écologique.
Une nouvelle vision du Care : des humains aux choses, la continuité du soin
Dernier élément sur lequel je voudrais insister, l’extension de la notion de Care aux choses elles-mêmes dans une perspective « pongienne », comme on vient de le signaler, celle d’un « parti-pris des choses » (comme dit le poète).
« Je maintiendrai », disait Guillaume d’Orange, faisant de sa devise celle de la couronne britannique après 1689. On voit mieux à la lecture du livre de Jérôme Denis et David Pontille ce que cette si simple expression recèle d’épaisseur sociale et de densité humaine. De fait, loin que proposer une nouvelle théorie du Care, les auteurs assument une continuité entre le soin des humains et celui des choses. S’appuyant sur l’historien américain David Lowenthal, ils reprennent sa conviction : « les vieux édifices, comme les êtres vivants, ont besoin de soins quotidiens, et non d’un processus de rajeunissement artificiel ».
Certes, ils assument l’aspect provocateur du rapprochement entre le soin des choses et celui des humains. Toutefois, ils s’appuient pour cela sur l’équivocité existante dans l’idée de sollicitude — propre au Care — entre la notion de « souci » et celle de « soin ». En effet, leur Soin des choses est d’abord un souci de celles-ci et du monde dans lequel elles s’insèrent. Mais de l’un à l’autre se crée une continuité qui n’est pas sans intérêt, ni dans la réévaluation des activités de maintenance, ni dans celle du travail de ceux qui les accomplissent.







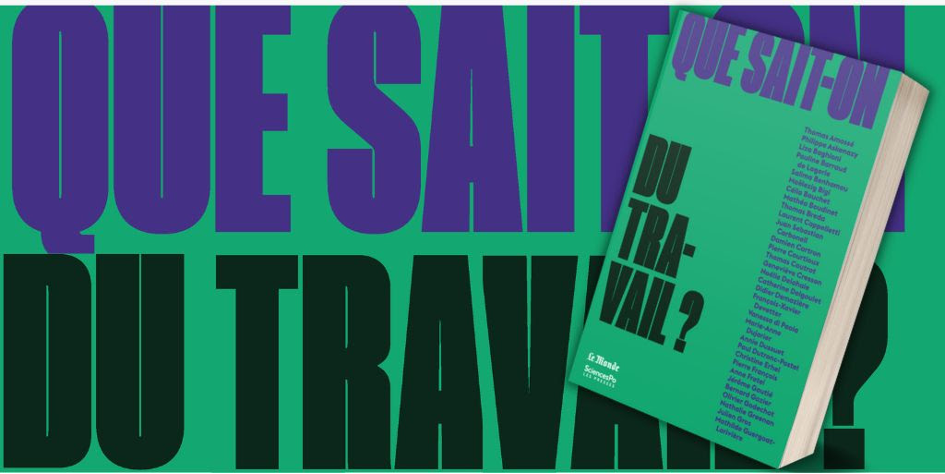
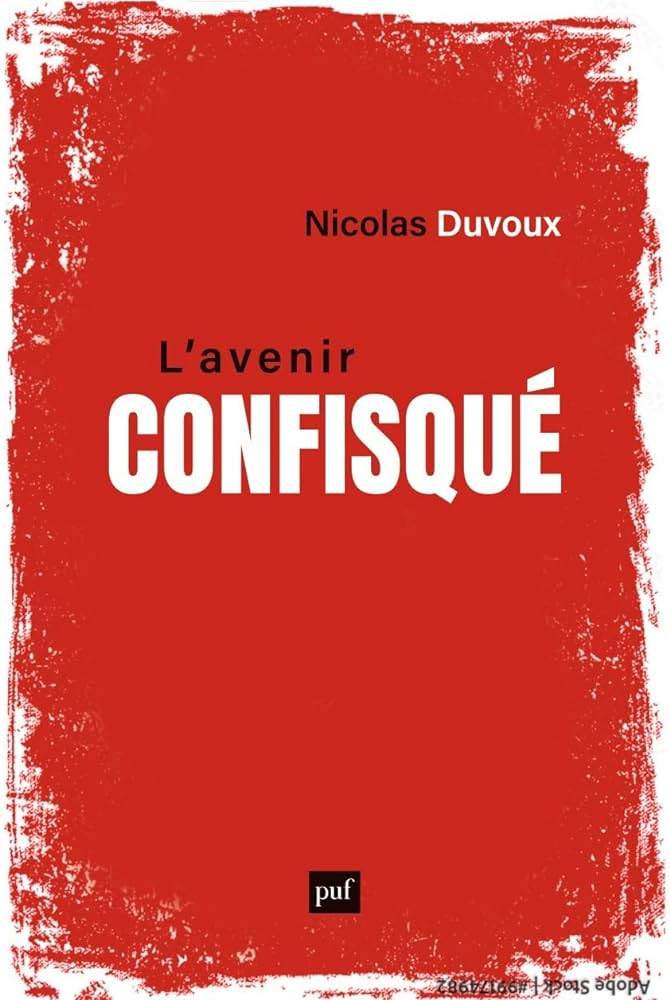
Laisser un commentaire