
La transformation de la France en une société de services a redistribué les rôles sociaux entre ceux dont le travail se fait dans la lumière et une classe de serviteurs, dont le travail est invisible. Ce clivage est primordial pour comprendre comment se structure la vision qu’ont les citoyens de leur place dans la société et le choix du candidat qui les représentera le mieux. Cet article a été publié sur le site Slate.fr.

Un salarié d’une entreprise d’Emmaüs, le 21 janvier 2013 à Ploufragan. DAMIEN MEYER / AFP
Verra-t-on s’affronter, aux deux tours de l’élection présidentielle, la France du back office contre celle du front office, observées par celle du… post office c’est-à-dire les retraités ? Le clivage fondé sur l’expérience vécue du travail est en effet primordial pour comprendre comment se structure la vision qu’ont les citoyens de leur place dans la société, leurs aspirations sociales et, partant, le choix du candidat qui les représentera le mieux. D’ordre plus phénoménologique que statistique, cette distinction complète les oppositions en termes d’inclusion ou d’exclusion, de niveau de diplôme, d’intégration à la mondialisation, de dispersion géographique ou de sédentarisation. Elle renouvelle l’analyse en termes de classes sociales en réinstallant le travail au centre de la compréhension politique.
En une quarantaine d’années, l’individualisation, la globalisation puis la numérisation ont largement transformé la France en une société « orientée client ». Impulsif, capricieux, versatile, parfois tyrannique, le client n’est pas seulement roi, il impose son empire à la France. Et cette mutation silencieuse n’est pas sans conséquence sur la redistribution des rôles sociaux et la manière de vivre son travail, selon que l’on se sente appartenir au back office de la société de service ou à son front office ; selon que l’on se tienne dans l’invisibilité du travail contraint au service des autres ou dans la lumière du travail visible et reconnu comme tel.
Eu égard aux mutations qu’il connaît, le travail aurait dû occuper une autre place dans cette présidentielle. Et si Benoît Hamon a eu le mérite d’en faire un thème de campagne, c’était paradoxalement pour insister sur sa disparition programmée ; ce qui revient in fine à le disqualifier d’emblée, lui, le messager d’une nouvelle à l’opposée des aspirations de tous. Car à bas bruit, le travail continue d’obséder les consciences. Non pas tant sous les traits d’une peur du chômage ou de la robotisation que sous la forme d’une inquiétude quant à la place qu’on occupe réellement ou symboliquement dans la chaîne de production et de valeurs.
La France du back office
Livreurs de 5 heures du matin dans les grandes villes ou magasiniers qui mettent en rayon ou « en ligne » des milliers de produits ; ouvriers du bâtiment ou supplétifs de la restauration ; manutentionnaires d’abattoirs ou soutiers de la distribution qui préparent et conditionnent tout ce que nous achèterons sur le pouce durant la journée, aides-soignantes, infirmières, policiers ou fantômes qui, tôt le matin ou tard le soir, passent l’aspirateur dans les bureaux, vident les corbeilles à papier et nettoient les toilettes… Tous ces citoyens en back office vivent leur travail de manière contrainte. Souvent moins diplômés, plus liés aux lieux et aux infrastructures dont ils dépendent pour travailler, ils ont pour la plupart d’entre eux le sentiment d’être invisibles et, pourtant, d’être ceux qui font « tenir » la société, qui font qu’elle se poursuit malgré tout. Ils savent le besoin qu’on a d’eux et le peu de reconnaissance qu’ils en obtiennent.
Le front office, au contraire, vit le travail sous l’angle de l’épanouissement et de la libération. Vivre de sa passion est son leitmotiv au point qu’il en oublie qu’il s’agit avant tout de travail. Un travail lumineux où la stabilité du monde et la qualité de vie sont premières, notamment dans les grands groupes. Ici, l’épuisement professionnel et le stress sont surtout la rançon d’une tension entre la pression du marché, l’obsolescence d’une organisation du travail héritée de l’ère industrielle et l’aspiration à l’épanouissement propre aux individus contemporains.
Souvent moins diplômés, les citoyens en back office ont pour la plupart d’entre eux le sentiment d’être invisibles et, pourtant, d’être ceux qui font « tenir » la société.
Par ailleurs, la transition numérique et son lot de créations ou de transformations d’entreprises génèrent un ensemble de métiers qui accompagnent le développement de cette économie : graphistes, spécialistes du marketing, développeurs, consultants, etc. On a pu penser un temps que l’attirance pour les métiers du spectacle, de l’information ou de la communication était une manière pour les enfants de la bourgeoisie d’affaires ou intellectuelle d’échapper au salariat ; elle manifeste plutôt, là encore, le souci d’échapper au back office afin de retrouver la possibilité de vivre son travail dans des lieux et des temps que personne ne vous ordonne. Échapper à la contrainte de l’ici et du maintenant qu’impose le travail classique est d’ailleurs le marqueur de la différence entre les privilégiés du front office et ceux qui subissent le back office.
Deux France modernes séparées par l’expérience du travail
Selon l’expérience concrète du travail, on constate une « distance sociale » entre des individus liés par un rapport de service. On est donc en présence de deux France modernes qui vivent une réalité identique, mais sous des angles différents. Elles apparaissent inextricablement liées puisque l’une travaille secrètement à l’épanouissement de l’autre : la France du ressentiment contre celle de l’assentiment à la société de service. Question : recouvrent-elles l’opposition politique entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron ? Rien n’est moins sûr. Pour le comprendre, une autre variable essentielle doit être prise en compte : le degré de souplesse et donc d’autonomie dont chacun dispose pour faire son travail.
Si on peut dire schématiquement qu’Emmanuel Macron parle au front office de la société de service, il capte aussi l’attention des travailleurs du back office qui font l’expérience d’une certaine autonomie dans l’exécution de leurs tâches. C’est précisément ce qu’omettait son contradicteur, syndicaliste et chauffeur de VTC, lors de la dernière Emission Politique sur France 2. En effet, le cas emblématique dans ce domaine est celui d’Uber, ou des livreurs de repas à vélo : malgré les contraintes qui pèsent sur eux, ils tendent à s’organiser comme ils le souhaitent.
A l’inverse, ceux qui ne choisissent ni leurs horaires, ni leurs lieux ou leurs conditions de travail ressentent de ce fait une intensification et une rigidification de leur travail. Il y a 20 ans, seuls 14 % des salariés interrogés par la Dares estimaient ne pas avoir d’autonomie et qu’il revenait à leur supérieur de leur indiquer comment réaliser leur travail. En 2013, ils étaient près de 20 % à faire le même constat : entre temps, la société de service est passée par là. Ces salariés risquent d’être plus perméables aux charmes du discours de Marine Le Pen.
Deux France modernes vivent une réalité identique, mais sous des angles différents. Elles apparaissent inextricablement liées puisque l’une travaille secrètement à l’épanouissement de l’autre : la France du ressentiment contre celle de l’assentiment à la société de service.
Le retour de la société des serviteurs
La société de services, notamment grâce à l’explosion numérique, signe le retour d’une société de serviteurs comme on pouvait la connaître avant 1914. Une nouvelle domestication tempérée par des mécanismes de sécurité sociale ou d’assurance chômage qui permettent aux privilégiés de ne pas se sentir comptables des contraintes qu’ils font peser sur leurs « serviteurs » et entretiennent paradoxalement ce travail servile dans une véritable invisibilité.
Si l’on fait l’hypothèse que le choix politique fluctue selon l’expérience concrète du travail, pondérée par le degré d’autonomie des travailleurs et le regard subjectif qu’ils portent sur leur situation, alors on sort des antiennes sur la captation du seul vote ouvrier par Marine Le Pen. Mais cette grille de lecture nous éclaire sur un autre point : le déchirement de certains actifs, en particulier des fonctionnaires, entre un vote Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon.
Il y a, en effet, des professions dont le métier change de sens et qui perdent quelque chose avec le basculement de la France vers cette société de services. C’est le cas des fonctionnaires. La mutation de leurs métiers ne relève pas d’une insécurité économique ou sociale, comme dans l’industrie, mais plutôt d’une véritable insécurité culturelle. Prenons les enseignants par exemple. Comme le montre très bien le sociologue François Dupuy, il s’agit d’une profession qui s’est organisée depuis l’origine pour échapper à ses « clients » (si l’on me permet l’expression). En effet, plus on est sélectionné au moyen de concours difficiles, moins on passe de temps avec les élèves et plus on est rémunéré ; l’agrégé fournira moins d’heures que le titulaire d’un Capès qui lui-même sera moins au contact des élèves que le professeur des écoles.
Avec l’entrée dans la société de services, la vision que l’on avait des enseignants a totalement muté. Alors qu’il s’agissait d’une profession de prestige, de front office pourrait-on dire (ce qui reste vrai pour les universitaires), le triomphe du client a tout bouleversé : il ne s’agit plus pour eux, avant tout, de transmettre un savoir, mais de donner accès à un diplôme. S’insère alors ici la notion redoutable de « satisfaction client » qui prend la figure du parent d’élève ; cet être paradoxal mêlant dans la même personne un cœur attendri et un actionnaire soucieux de la performance de son « investissement ».
Il faut insister sur la grande misère des services publics et des entreprises à vocation publique comme Pôle emploi ou la Poste. C’est à eux que parle Jean-Luc Mélenchon, souvent talonné par Marine Le Pen : ces gens rejetés, sans qu’on leur en explique le sens, du prestige du statut à la merci du service.
Et il n’y a pas que les enseignants à passer ainsi en quelques décennies du front office au back office et à contempler la réduction de leur autonomie que protègent moins la liberté pédagogique ou la sécurité de l’emploi. Il faut insister ici sur la grande misère des services publics et des entreprises à vocation publique comme Pôle emploi ou la Poste. C’est à eux que parle Jean-Luc Mélenchon, suivi par Marine Le Pen : ces gens rejetés, sans qu’on leur en explique le sens, du prestige du statut à la merci du service ; ces rejetons du front office que le manque d’autonomie ou la précarité libre et diplômée ne satisfont pas.
Reste enfin les retraités, le post-office, qui observent ces transformations et pour une part en tirent profit. Ce qu’on appelle la silver économie est une adaptation de la société de service à cette catégorie de population et ses besoins spécifiques, notamment en termes de soins. Mais qui induit tout autant que l’économie productive un back office rebaptisé « services de proximité ou services à la personne ». Au niveau politique, l’enjeu des retraités est relativement simple : qui garantira le maintien de leur mode de vie ?
Apprivoiser la société de service, s’en accommoder, s’en plaindre ou la refuser, telles sont les options que proposent les différents candidats le 23 avril et le 7 mai. Mais sans offrir pour autant un récit commun à toutes ces expériences de travail. On ne peut que le regretter, car un tel effort de narration donnerait enfin un sens aux transformations que connaît la France depuis le milieu des années 1970. C’est aussi cela l’enjeu d’une élection.







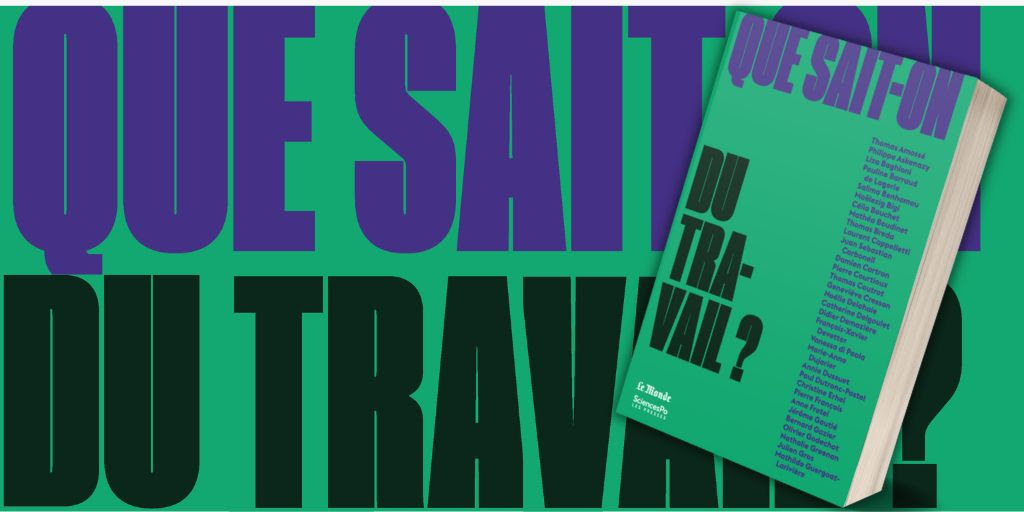
Laisser un commentaire