 par Fortunato Mallimaci, interviewé par Claude Emmanuel Triomphe
par Fortunato Mallimaci, interviewé par Claude Emmanuel Triomphe
Alors qu’il est beaucoup question de laïcité dans la période récente en France, et que par ailleurs l’on assiste sous de multiples aspects à un « réveil » du religieux dans un pays par ailleurs très sécularisé, Metis s’est entretenu avec Fortunato Mallimaci, ex-doyen de la Faculté des sciences sociales de l`Université de Buenos Aires et chercheur au CONICET. Celui-ci revient dans un première partie sur les diverses conceptions de la laïcité dans le monde, ainsi que sur les relations entre politiques et religions.
Comment analysez-vous le débat actuel français sur la laïcité ?

Il faut poser un double regard, historique et sociologique. Sur le plan religieux, on dit souvent que c’est un « retour ». Mais en fait, le religieux n’est jamais parti ! Il y a quatre notions structurantes quand on parle de laïcité. La première, c’est celle de « sécularisation ». Pour les chercheurs et les politiciens, il y a un problème puisque la religion est là aujourd’hui, en Europe, en Asie, partout. Alors que beaucoup disaient qu’il n’y a plus de religion en Europe, que la tendance lourde est celle de la sécularisation comprise comme la disparition du religieux. Beaucoup pensent que c’est le fondamentalisme, le Moyen Age qui revient.
Or, le fondamentalisme est quelque chose de complexe. Personne ne dira qu’il y a du fondamentalisme aux Etats-Unis : pourtant la religion de la majorité des Américains est une sorte de fondamentalisme chrétien où il faut retourner à la Bible, sans médiation. En sciences des religions, les Etats-Unis font d’ailleurs la différence : c’est un pays moderne, sécularisé, mais où tout le monde dit qu’il est religieux. On commence les séances au Sénat avec une prière, ici en France ce serait impensable. Aujourd’hui, un philosophe comme Habermas parle de « dé-sécularisation ». Il dit qu’en habitant dans les grands pays de l’Europe occidentale, le Japon, ou l’Australie, on est dans des sociétés post-sécularisées, où la religion est une réalité sociale et politique que nous devons accepter dans la société civile.
Dans le monde entier, les gens se retirent et prennent de la distance par rapport aux institutions religieuses, sans quitter la dimension religieuse pour autant. Regardez le mariage pour tous : il y a eu beaucoup de manifestants catholiques en France. Or, si l’Eglise catholique n’est plus rien dans ce pays – comme on le lit dans beaucoup de textes de sociologues français- comment a-t-elle réussi à avoir des milliers de personnes dans la rue ?
Mais on ne peut pas assimiler laïcité et sécularisation…
Non, car il faut aussi parler du rôle de l’Etat. Si on pense que la laïcité c’est seulement la séparation de l’Etat et des croyances religieuses, c’est une façon de vivre la laïcité, celle dont l’Europe et surtout la France ont fait l’expérience. Ainsi, l’évêque de Norvège est au présent au Parlement parce qu’il est l’évêque, ici en France une situation similaire serait impossible. En Amérique Latine aussi c’est impossible. Bien sur, la présence institutionnelle continue, mais ce sont des sociétés sécularisées où les individus font leurs propres démarches religieuses et sont en négociation permanente avec les institutions. Par ailleurs, dans chaque pays, les organisations religieuses ont un pouvoir qui est le résultat d’histoires différentes.
En France, il y a bien la loi de 1905 avec une laïcité de séparation. Mais on voit que même chez vous la laïcité est à géométrie variable. Prenez le cas de l’Alsace- Lorraine avec l´ancienne législation de l´Allemagne où il y a une laïcité de coopération, ou encore des DOM-TOM dans lesquels la séparation se réduite à peu de choses. Ailleurs, en Italie, en Russie, en Pologne, en Espagne ou au Portugal, les Etats ont différents regards sur les institutions religieuses. Chez vous, on vous laisse faire ce que vous voulez, mais si vous voulez un bâtiment pour l’exercice du culte, je vous le donne (l’Etat). Mais le maire peut dire « non je ne vous donne pas l’autorisation de faire une mosquée ».
Et ailleurs ?
Ça c’est impossible aux Etats-Unis ou en Amérique Latine : les individus eux-mêmes doivent trouver l’argent pour construire leurs bâtiments religieux. Evidemment, l’argent peut venir de l’Iran ou de l’Arabie Saoudite ou des USA, mais c’est une autre question. En France, en dépit de la séparation, l’Etat paie les bâtiments et les travaux d’entretien. Il finance ainsi les institutions religieuses. Ailleurs, comme en Argentine, ce sont les fidèles qui les financent. Parlons maintenant des impôts. En Italie, en Espagne, en Belgique et en Allemagne, il y a un pourcentage qui part pour les groupes religieux, ce qui est impossible en France. En Amérique latine, c’est une autre façon de voir, la laïcité ce n’est pas tellement la séparation de la religion et la politique, mais plutôt quelle relation l’Etat va avoir avec la religion ? S’agit-il de subordination totale ou de coopération ? On a vu qu’il y avait des différences selon que l’on était dans un régime militaire ou dans une démocratie.
En Argentine, ni l’Eglise ni les gens ne sont sortis manifester contre le divorce en 1985 ou contre le mariage pour tous en 2010. L’Eglise n’a pas réussi à faire sortir les gens dans la rue. Elle n’a pas vraiment ce rôle. Elle a préféré faire intervenir les lobbies et des groupes de pression au niveau politique plutôt que la société, qui est très sécularisée et qui s’en fout. Sa façon d’exercer le pouvoir c’est par la politique, c’est la tête de l’Eglise avec la tête du pouvoir politique et le gouvernement. C’est plus facile d’intervenir de cette manière dans des dictatures militaires que dans les démocraties.
Et la liberté religieuse dans tout ça ?
Elle est fondamentale car la laïcité c’est aussi la liberté religieuse et la liberté de conscience. Mais là encore, c’est une notion relative. La liberté dans l´espace privé ou familial et la liberté dans l´espace public, ce n’est pas la même chose. En France, on n’a pas la même liberté quand on est juif ou chrétien d’une part, ou musulman de l’autre. Dans la culture française, si l’on porte une croix ou une kippa, pas de problème, personne ne dira « ostentation de la religion ». Mais si l’on porte un foulard, oui. C’est de plus en plus les groupes d’extrême droite qui demandent la laïcité. Puisque selon eux, les musulmans ne respectent pas la loi, il faut une laïcité qui permette de mettre la religion, surtout la leur, en dehors de la sphère publique.
Vous parliez de quatre termes structurants …
Oui, car outre la sécularisation, la séparation, la liberté religieuse il y a aussi le droit à la conscience individuelle. En Europe, en Amérique du Sud ou du Nord, cela a pu se négocier du fait d’une longue hégémonie, par consensus ou coercition – tant de la culture judéo-chrétienne que de la rationalité ainsi que de l’autonomie du capitalisme, comme l’ont relevé Max Weber ou Pierre Bourdieu, et ce dans ses sphères culturelles, politiques, religieuses, économiques, militaires ou symboliques.Par contre, en Asie et en Afrique, c’est une autre expérience parce que pour une très large partie de ces sociétés, citoyen, nationalité, ethnicité et religion, c’est la même culture. Or en Europe, et en France en particulier, il a fallu des guerres de religions et plusieurs siècles pour arriver à ce niveau de différenciation au sein de l´Etat et de la société. Et encore, celle-ci n’est pas la même dans les pays catholiques et protestants, au Nord et au Sud. Par conséquent, plutôt que de parler d’exceptions ou de laïcités, de sécularisations et de religions (fausses et vraies), nous devrions les saisir comme des expériences différentes provenant de plusieurs modernités qui sont en train de se vivre sur la planète.
Le modèle français de laïcité a influencé une partie du monde. Qu’en est-il aujourd’hui ?
La France a eu la bonne idée de séparer et d’autonomiser l’Etat de l’Eglise, ce qui est très important. La révolution française a inspiré la planète entière. Mais cela ne signifie pas que le catholicisme, le protestantisme, l’islamisme et le judaïsme ont disparu. Ils sont actifs et en recomposition interne constante ; ils cherchent à donner des réponses aux demandes de salut et de bonheur dans une société où l’Etat est incapable de les procurer dans leur totalité. La religion et le religieux dans sa dimension symbolique, sociale, culturelle et politique, avec ou sans institution, ce n’est pas fini. Ça, c’est ce que disent les missionnaires de la laïcité, qui laissent penser à l’extérieur qu’il n’y a plus de religions en France, alors que c’est complètement faux. Aujourd’hui, il y a différents modèles de laïcité et non plus un seul.
Prenons l’exemple de la laïcité en Allemagne, qui se base beaucoup sur les impôts. Le budget des églises allemandes vient d’un pourcentage des impôts sur les revenus, prélevés sur l’ensemble de la société. Par décision de chacun, l’argent va être orienté et redistribué soit vers le catholicisme, soit vers le protestantisme, soit vers des institutions laïques, mais pas vers des institutions islamiques. On décide à quelle institution religieuse l’argent devra être affecté. On n’a pas le droit de refuser de contribuer, mais on peut décider que l’argent n’aille pas à l’Eglise.
En Italie, peuple très intelligent, on a le droit de dire « non, on ne veut pas verser de l’argent pour cela ». Mais ensuite on ne les décompte pas des impôts prélevés au titre des religions et l’on redistribue tous les impôts prélevés au titre des religions vers les Eglises. Certes, l’individu a une certaine liberté de conscience dans ce système mais, quelle que soit sa décision, tout l’argent va à l’Eglise. Est-ce un bon compromis ? L’avis est partagé : certains avancent que l’argent des personnes qui ont refusé pourrait par exemple aller aux activités liées aux affaires sociales…
Fortunato Mallimaci est un sociologue argentin, professeur d’université à la faculté de sciences sociales de l’Université de Buenos Aires, et spécialiste de l’histoire sociale argentine. Il est l’auteur de l’ouvrage « La diversité religieuse dans la cité globale : hétérogénéité institutionnelle et individualisation du croire », paru dans la Revue Internationale de Sociologie de la Religion, en mars 1998, l´article « Laïcité de subsidiarité en Argentine « dans le libre Laïcité, laïcités sous la direction de Bauberot-Milot-Portier, Paris :EMSH, 2014 et « What do Argentine people believe in ? Religion and social structure in Argentina , Social Compass, June 2015.






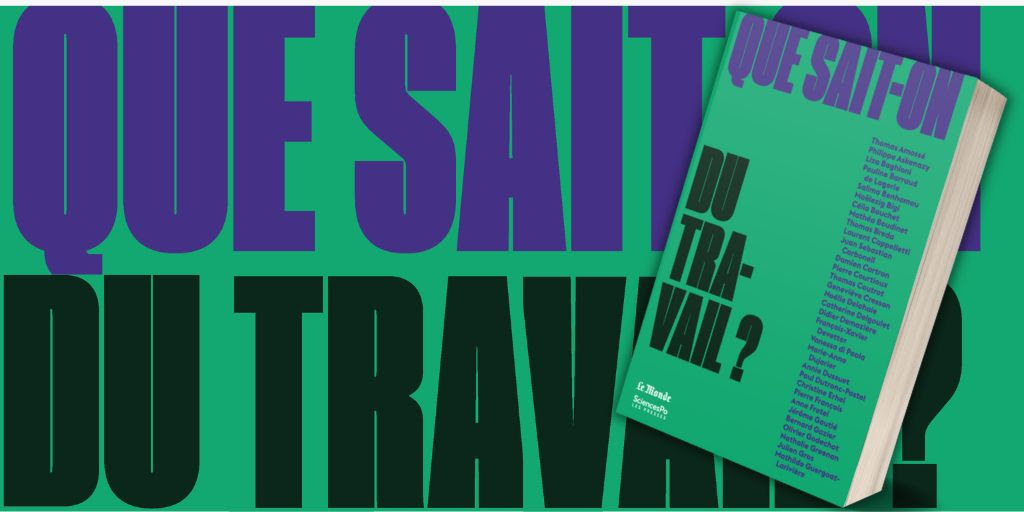

Laisser un commentaire