Michèle Tallard et Catherine Vincent, propos recueillis par Jean-Louis Dayan
Face au retour de l’inflation, l’exécutif s’est gardé en France d’appeler à la hausse générale des salaires, préférant s’en remettre aux négociations d’entreprise et au « partage de la valeur » tout en laissant jouer a minima — c’est-à-dire sans « coup de pouce » — les règles d’indexation du SMIC. Brûlante, la question du pouvoir d’achat ne s’en est pas moins invitée en septembre dernier aux « rencontres de Saint-Denis » entre le Président de la République et les responsables des principaux partis. D’où la conférence sociale réunie par Élisabeth Borne en octobre « avec la volonté que le travail paie mieux, et de relancer la promotion sociale ». Vaste programme où resurgit entre autres la question des minima de branche inférieurs au SMIC. Chercheures travaillant de longue date sur la négociation collective de branche, Michèle Tallard et Catherine Vincent ont accepté de revenir pour Metis sur ce « serpent de mer » du dialogue social français.
Jean-Louis Dayan « C’est la négociation qui amènera la révision des grilles de classification, c’est la négociation qui fera évoluer les salaires minimums des branches qui sont encore en dessous du SMIC », déclarait la Première ministre en ouverture de la conférence sociale d’octobre. Vos travaux montrent que ce n’est pas, loin s’en faut, la première fois que les pouvoirs publics lancent un tel appel.
Catherine Vincent. C’est en vue du récent colloque sur « L’État et les salaires depuis 1945 » que nous nous sommes repenchées sur « l’opération bas et moyens salaires » lancée en 1990 à l’initiative de François Mitterrand et de son Premier ministre d’alors, Michel Rocard. Aujourd’hui quelque peu oubliée, elle s’attaquait à un problème qui n’a depuis jamais quitté l’actualité. L’anomalie persistante de nombreux minima conventionnels inférieurs au SMIC est un véritable serpent de mer du dialogue social français. Elle mérite d’autant plus l’attention qu’elle interroge plus largement les modalités de la négociation collective dans notre pays et le « tripartisme à la française » qui a été et reste le fil directeur de nos recherches.
Revenons aux origines. Lancée en juin 1990, la première opération « bas et moyens salaires » (BMS) s’inscrit dans le contexte bien particulier du moment, qui conjugue désinflation et embellie économique. Après une décennie de modération salariale, il s’agit de faire profiter les salariés les moins qualifiés de la reprise sans pour autant — conformément à la doxa nouvellement en vigueur dans la sphère publique — augmenter le SMIC au-delà des dispositions légales, sous peine de détruire des emplois. Mais l’opération répond à des objectifs plus ambitieux qu’un simple ajustement des minima conventionnels : elle vise au-delà à restaurer les déroulements de carrière et rénover les grilles de classification. À l’approche de l’ouverture, au 1er janvier 1993, du marché unique, l’heure est à l’adaptation de l’appareil industriel aux mutations technologiques et organisationnelles, afin de réussir le passage à la mondialisation d’une économie française qui accuse un retard compétitif sur ses voisins. En ce sens elle est très congruente avec le projet de « modernisation négociée » dessiné quelques années plus tôt par le rapport Riboud (« Modernisation mode d’emploi ») et repris à leur compte par Michel Rocard et son ministre du travail, Jean-Pierre Soisson. En même temps que les équipements, c’est l’organisation du travail qu’il s’agit de moderniser, notamment en redessinant dans les branches les profils de carrière et les échelles de classification.
Le mouvement prend dans de très grandes entreprises industrielles (Sidérurgie, Renault, BSN, Péchiney…), où sont signés des accords-phares. Mais il ne s’étend pas au-delà ; l’opération BMS offre alors un bon moyen de toucher aussi les PME en impliquant les branches dans cette modernisation négociée ; pour la première fois, ces dernières se trouvent mobilisées dans le rôle de médiateurs d’une politique publique.
La conjoncture politique pèse dans le même sens. Le gouvernement Rocard arrive aux affaires avec une majorité relative qui l’amène à s’adjoindre des ministres « d’ouverture » et à s’appuyer sur des députés de centre droit. Il écarte toute revalorisation substantielle du SMIC, mais doit composer avec de sérieuses tensions sur les salaires. La désindexation enclenchée avec le « tournant de la rigueur » a été couronnée de succès sur le front de l’inflation, mais s’est traduite par un recul de la part des salaires dans la valeur ajoutée ; avec la reprise de la croissance et le recul du chômage, revendications salariales et grèves se multiplient en 1987-88 et débouchent ici et là sur des hausses substantielles. La pression monte aussi au sein du Parti socialiste, dont une proposition de loi entend rendre obligatoire l’alignement des minima de branche sur le SMIC. Un acte politique et social marquant s’impose au gouvernement, à la recherche d’une thérapie qui soit efficace sans pour autant remettre en cause la création d’emploi. Ce sera la relance des négociations salariales de branche.
Mais comment s’y prendre pour susciter un vaste mouvement de négociation de la part d’acteurs syndicaux et patronaux peu enclins à s’accorder sur ces sujets ?
Michèle Tallard. Le contexte de 1990 est particulier, la méthode choisie, à la fois volontariste et fermement incitative, l’est aussi. Venue du sommet de l’État, l’initiative bénéficie d’emblée d’une forte légitimité politique, le Président de la République et son Premier ministre affichant tour à tour devant les partenaires sociaux leur volonté d’aboutir. Michel Rocard s’y investit personnellement en présidant lui-même début juin 1990 la Commission nationale de la négociation collective (CNNC), exceptionnellement réunie pour l’occasion, afin d’y présenter les grandes lignes du dispositif qu’il entend soumettre à validation. Des engagements réciproques sont attendus : aux organisations syndicales et patronales de réactiver la négociation salariale dans les branches ; à l’État de garantir en contrepartie la poursuite de la modération salariale, avec une progression du SMIC qui ne dépasse pas celle du taux de salaire ouvrier. L’accord prendra la forme d’un relevé de conclusion circonstancié, que seule la CGT, jugeant la revalorisation du SMIC insuffisante, refusera de signer.
Il s’agit d’une véritable feuille de route, qui assigne aux négociateurs de branche trois objectifs :
- « assurer à tous les salariés une garantie de rémunération supérieure au SMIC,
- offrir à tout salarié une perspective de déroulement de carrière valorisant expérience et formation,
- assurer l’adaptation des classifications aux mutations technologiques et organisationnelles ».
Elle est assortie d’un calendrier serré — début des négociations en octobre, point d’étape fin 90, bilan final fin 92 — et fait l’objet d’un suivi régulier par la CNNC et sa sous-commission des salaires. En appui, l’État s’engage à fournir un ensemble de ressources aux négociateurs : études prévisionnelles de branche, expertises techniques sur les classifications ou l’organisation du travail, formation des négociateurs, base statistique des conventions collectives. Il offre également d’installer et d’outiller (formations, guides de négociation) des commissions mixtes paritaires (CMP : commissions de négociation présidées par un inspecteur ou directeur du travail) dans les branches où la négociation est au point mort. Le tout coordonné par une « task force » réunissant les principales directions du ministère du Travail. Une démarche volontariste et incitative à la fois.
Une volonté politique et des moyens, mais pour quels résultats ?
On peut dire qu’ils auront été « contrastés ». Ou, pour reprendre l’expression d’un acteur syndical de l’époque, qu’ils autorisent « une satisfaction raisonnée ». Côté méthode, l’ensemble des organisations syndicales salue l’implication de l’administration du travail dans le suivi et l’outillage des négociations. Sur le fond, il faut distinguer selon l’objectif. En matière de salaire, le bilan est mitigé, car les minima de branche ont beau être réajustés, ils vont être régulièrement rattrapés par les revalorisations du SMIC, dans une sorte de course-poursuite sans fin. L’opération BMS a tout de même eu le mérite de redonner vie à la négociation dans des branches inactives, le textile par exemple, débouchant au total en deux ans sur 316 accords salariaux conclus dans 164 branches. Les résultats sont en revanche franchement positifs pour ce qui est des classifications, où les négociations se traduisent par une forte amélioration pour les 3 millions de salariés qu’elles vont couvrir.
Impossible cependant de ne pas rapporter ce bilan à son contexte macro-économique. La forte reprise des années 1987-89 avait beaucoup fait, tensions salariales obligent, pour le lancement de l’opération. À peine amorcée, celle-ci va se heurter au retournement de conjoncture qui survient dès l’été 1990 et s’aggrave avec la guerre du Golfe ; avec la remontée massive du chômage en 1992-93 c’est l’emploi qui revient en force et pour longtemps sur le devant de la scène, et le temps de travail devient le premier sujet de revendication des organisations syndicales, avec les suites que l’on sait. Pour autant, les pouvoirs publics tiendront l’engagement pris en 1990 en continuant d’augmenter le SMIC au même rythme que le salaire ouvrier (soit deux fois plus que ce qu’exige la loi) jusqu’à la fin de 1992.
Revenons à l’actualité. Voici près de 35 ans que les opérations Bas et Moyens Salaire se succèdent, même si elles n’ont plus la vigueur de la première. Comment expliquer qu’elles soient devenues le « serpent de mer » des politiques salariales que vous évoquez ?
CV. On s’imagine facilement en France que l’État peut tout en matière de salaires. La réalité est en fait beaucoup plus complexe tant l’évolution des salaires dépend de déterminants nombreux, et au surplus décentralisés : tout dépend de l’état des rapports de force partout où l’on négocie. La question demeure la même depuis la première opération BMS : comment revitaliser la négociation salariale pour que les salaires conventionnels sortent du champ gravitationnel du SMIC ? Elle va pourtant perdre de son acuité dès 1993, quand pour répondre aux destructions d’emploi les allégements de cotisations patronales sur les salaires voisins du SMIC commencent à se mettre en place. On sait qu’ils n’ont pas cessé de s’étendre depuis, jusqu’à plus de deux fois le SMIC aujourd’hui, élargissant d’autant l’effet de « trappe à bas salaires » qui leur est inhérent. Difficile dans ces conditions, pour ne pas dire impossible, de dynamiser la négociation salariale dans le bas de l’échelle.
Pourtant, le sujet des minima de branche inférieurs au SMIC n’a cessé de revenir à l’ordre du jour des CNNC annuelles, et de donner lieu chaque fois au constat d’un écart persistant dans les bilans annuels de la négociation collective publiés par le ministère du Travail. Mais sans les moyens qui avaient été associés à la politique incitative forte des années 1990-92. Si bien qu’aujourd’hui, si politique salariale de l’État il y a, elle s’appuie principalement sur les allégements de cotisations patronales sur les bas salaires et les mesures fiscales qui les accompagnent (défiscalisation des heures supplémentaires, prime d’activité). Tout se passe comme si l’État prenait désormais durablement à sa charge une partie du revenu des salariés les moins rémunérés.
Cela n’empêche pas que les minima de branche inférieurs au SMIC fassent régulièrement l’objet de dénonciations officielles, la dernière en date lors de la Conférence sociale d’octobre dernier. Ni que la loi n’introduise de nouvelles contraintes à l’encontre des branches retardataires : obligation, introduite par les ordonnances travail de 2017, d’ouvrir (mais pas de conclure) une négociation dès qu’un minimum conventionnel passe en dessous du SMIC ; menace de fusionner d’office les branches réfractaires inscrites dans la loi pouvoir d’achat de 2022. Ce qui frappe cependant, c’est le caractère déclaratif de ces dispositions : l’appareil législatif se durcit, mais les pratiques ne suivent toujours pas.
Tout cela n’est-il pas au fond le signe d’un dialogue social structurellement déficient en France ?
CV. Un retour à la préhistoire du SMIC peut être éclairant à cet égard. Introduit en 1950, le SMIG avait été conçu comme le minimum vital garanti aux ménages ouvriers, une sorte de « voiture-balai » destinée à ne pas laisser les travailleurs sans pouvoir de marché s’appauvrir. Il a tenu son rôle, mais n’a pas empêché les bas salaires d’accuser un retard croissant sur les gains substantiels de pouvoir d’achat associés aux Trente glorieuses ; cette faille n’a pas été pour rien dans les grandes grèves de mai 68. Son remplacement par le SMIC (salaire minimum de croissance) en 1970 change le sens du dispositif, désormais conçu comme le socle de la hiérarchie salariale, à charge pour la négociation collective d’ajuster sur cette base l’échelle des rémunérations à l’évolution des qualifications et des perspectives de carrière dans les branches. De fait, il aura eu surtout la vertu de faire évoluer les bas salaires au même rythme que la productivité moyenne du travail ; mais avec son revers : la progression du SMIC va désormais donner le ton aux négociateurs de branche, qui se contenteront de répercuter ses relèvements successifs sans guère corriger l’écrasement des hiérarchies salariales qui s’ensuit.
N’oublions pas cependant que bon nombre d’États membres de l’UE ont instauré un salaire minimum dans la période récente ; s’ils l’ont fait, c’est avant tout pour pallier, comme en France, la dégradation du rapport de forces sur le marché du travail en garantissant le pouvoir d’achat des salariés les moins qualifiés ou les plus précaires. Si bien qu’aujourd’hui le SMIC français est inférieur à ceux du Luxembourg, du Royaume-Uni, de l’Allemagne ou de la Belgique…
Annoncée par Élisabeth Borne lors de la Conférence Sociale d’octobre, la dernière opération BMS s’insère dans un ensemble varié de mesures : création d’un Haut conseil des rémunérations, réforme de l’index d’égalité professionnelle, lutte contre le temps partiel subi…. Cela en fera-t-il une édition différente des précédentes ?
MT. L’opération BMS des années 1990 s’était largement appuyée, on l’a vu, sur la Commission nationale de la négociation collective (CNNC), organe consultatif chargé depuis 1946 de recueillir l’avis des partenaires sociaux sur les textes législatifs, réglementaires et conventionnels relatifs à la négociation salariale, ainsi que sur les augmentations gouvernementales du SMIC. Tel qu’annoncé par la Première ministre en octobre, c’est le futur Haut conseil des rémunérations qui sera dorénavant chargé du suivi et de la mise à jour des conventions collectives et des classifications ; mais avec une composition qui fait cette fois la part belle à la statistique publique (INSEE, DARES, DREES) et à des experts de profil varié ; en outre ses compétences s’étendront à plusieurs autres thèmes comme l’égalité hommes/femmes, le temps partiel subi, les contrats courts ou le partage de la valeur. Difficile de ne pas voir dans ce nouveau « machin » la confirmation du moindre cas que fait l’exécutif actuel des organisations syndicales et patronales, préférant s’en remettre à l’expertise plutôt qu’à la consultation paritaire dans la conduite de l’action publique. Une orientation qui dénote à mon sens l’absence de pensée de ce que devrait être le rôle propre des partenaires sociaux, désormais regardés comme une ressource consultative parmi d’autres. En outre, la question des salaires conventionnels ne sera plus l’objet central de la consultation, mais l’un de ses nombreux thèmes, au risque de s’y trouver noyée ; le même glissement est au demeurant à l’œuvre à la CNNC (rebaptisée CNNCEFP) depuis qu’avec la loi « avenir professionnel » elle a vu en 2018 ses compétences étendues à l’emploi et la formation professionnelle.
Il faut tout de même souligner pour être juste que la question des minima conventionnels inférieurs au SMIC n’est pas oubliée, Élisabeth Borne ayant donné en octobre rendez-vous aux branches retardataires pour un bilan à fin juin 2024, en laissant planer la menace de les sanctionner, en cas de retard persistant, en calculant leurs allégements de cotisations sociales non plus en référence au SMIC, mais aux minima conventionnels qui lui demeureraient inférieurs.
Votre mise en perspective donne le sentiment que la course-poursuite entre minima et SMIC risque d’être sans fin. N’y a-t-il pas là matière à repenser, soit le mécanisme d’indexation du SMIC, soit le processus de négociation des minima de branche, soit les deux ?
CV. Toucher aux règles du SMIC nous paraît contre-indiqué dans la période actuelle. On a vu qu’il a ses vertus, reconnues un peu partout en Europe. Ouvrir le dossier de sa réforme comporterait en outre, à s’en tenir aux préconisations répétées du Groupe des experts sur le SMIC, qui s’oppose avec constance à tout « coup de pouce » gouvernemental au nom de la défense de l’emploi, un réel danger de démantèlement. Mieux vaut à notre sens conforter le regain de la négociation collective lié au contexte de reprise de l’inflation et de difficultés croissantes de recrutement dans de nombreux secteurs. À preuve, les augmentations substantielles de salaires qui s’observent d’ores et déjà dans nombre de grandes entreprises.
Ce qui risque à l’inverse de marginaliser la négociation salariale, c’est le développement des primes de pouvoir d’achat (ou de partage de la valeur), aujourd’hui largement encouragé par un régime fiscal et social favorable, mais qui, concentrées dans les grandes entreprises et les secteurs à forte valeur ajoutée, présentent l’inconvénient majeur de creuser les inégalités salariales au détriment des salariés du bas de l’échelle, qui en bénéficient le moins. On entend souvent dire que les conventions collectives de branche auraient aujourd’hui beaucoup perdu de leur effectivité et ne pèseraient plus guère sur les pratiques salariales à l’œuvre dans les entreprises. De fait, le lien entre salaires conventionnels et salaires réels paraît s’être distendu dans un certain nombre de branches, comme la métallurgie. Pour autant, les recherches récentes s’accordent sur un double constat : même dans les branches où la dynamique salariale semble s’être affranchie des niveaux conventionnels, les conventions collectives continuent de servir de cadre directeur à la négociation ; elles restent par ailleurs le déterminant principal des niveaux effectifs et de l’échelle des rémunérations dans les branches à bas salaires ; lesquelles recouvrent largement le périmètre des travailleurs de la « seconde ligne » dont les désavantages ont été mis en lumière par la crise sanitaire : agriculture, BTP, grande distribution, services à la personne, propreté…
Pour en savoir plus
Tallard M., Vincent C. (à paraître en 2024), « La politique “bas et moyens salaires” de 1990-1992, moment privilégié des rapports de l’État à la régulation conventionnelle des salaires », in Gautié J., Machu L., Pelisse J. (dir) L’État et les salaires depuis 1945, Cahiers du CHATEFP.
Delahaie N., Fretel A., Petit H., Farvaque N., Guillas-Cavan K., Messaoudi D., Tallard M., Vincent C. (2023), « Le rôle de la branche après les ordonnances Macron : entre permanence et renouvellement », La Revue de l’Ires, n° 107-108.
Delahaie N., Vincent C. (2021), « The SMIC as a driver for collective bargaining. The Interplay between collective bargaining and minimum wage in France”, in Dingeldey I., Grimshaw D. & Schulten T., Minimum Wage Regimes Statutory Regulation, Collective Bargaining and Adequate Levels, Routledge Editions.
Bruno Palier (dir.) (2023), Que sait-on du travail, Presses de SciencesPo (Voir la note dans Metis)
Céreq/CNEFP (2019), Parcours professionnel et formation : des liens renouvelés, Céreq Echanges n°9, mars








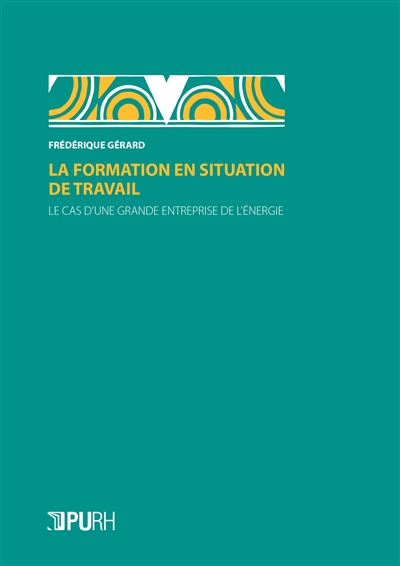

Laisser un commentaire