
Entretien avec Philippe Zarifian, professeur de sociologie à l’Université de Paris-Est Marne-la-Vallée, dont le dernier ouvrage « Sociologie du devenir, éléments de sociologie générale » dégage les fondements d’une véritable révolution de l’approche sociologique. Son constat est radical, la sociologie classique est devenue obsolète.

Dans votre ouvrage, vous vous appuyez sur des concepts philosophiques et vous défendez la pertinence d’une sociologie du devenir. D’où vient cette démarche ?
Le concept de devenir est familier des philosophes. Mon besoin de l’importer en sociologie m’est venu en réaction à la profonde insatisfaction où j’étais quant à la façon dont la plupart des spécialistes du travail traitaient des questions du temps au début des années 80. En particulier, avait fleuri une inflation de l’usage des mots « projets », « prévisions », « avenir », alors même qu’on commençait déjà à présenter l’avenir comme « incertain ».
On demandait aux individus d’avoir spontanément ou de construire un « projet personnel pour leur avenir », alors que l’organisation au sein de laquelle ils travaillaient était incapable de définir son propre avenir à plus de trois ans, voire souvent bien moins. On installait des premiers dispositifs de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, tout en sachant bien que les « cibles » avaient toutes les chances de se révéler fausses. Bref : on installait socialement une double fiction : celle selon laquelle le temps possédait un déroulement linéaire, autonome, se prolongeant sans problème dans l’avenir ; celle, plus surprenante encore, selon laquelle les acteurs humains pouvaient plier ce qui se passerait dans cet avenir à leur volonté, réaliser, sans problème, « leur projet ».
Demander à des individus salariés de définir un projet professionnel à moyen/long terme, comme le font de bonne foi nombre de professionnels de l’orientation et de dispositifs de GRH, serait donc illégitime ?
Oui, et ce n’est un paradoxe qu’en apparence. C’est exercer sur eux une oppression bien concrète, les déstabiliser. De mon point de vue, cette nouvelle prescription (formuler un projet personnel) participe dès cette période d’une modification dans le mode de contrôle du travail : du contrôle disciplinaire vers ce que j’ai proposé d’appeler : le contrôle d’engagement. On demande aux salariés de s’engager sur un résultat ou un projet, alors qu’ils n’en ont pas les moyens.
Mais pourquoi devenir et non futur ou avenir ?
Le devenir est un concept très précieux car il met en rapport dynamique les trois dimensions de la temporalité, le présent, le passé, le futur, tout en marquant que ce qui s’associe au temps n’est pas une ligne droite, mais un flux de mutations, ce qui change tout. Et d’abord, des mutations de l’individu lui-même. « Je deviens vieux », mais il y a plusieurs manières de vieillir et dans ce vieillissement, le « je » ne reste pas identique. Il se transforme. Chaque individu est lui-même un devenir permanent.
On devient toujours au présent. Le devenir s’exprime par des verbes. C’est une sorte de mouvement, un enjeu ouvert. Mais ce présent est un point de tension entre le passé et le futur. Le passé pousse à travers notre mémoire. Dans le devenir de chaque individu, la mémoire nous pousse en permanence à penser et à nous comporter d’une manière déterminée. Elle nous oriente, mais en retour, au présent de notre vivre, nous sollicitons cette mémoire, nous sélectionnons des souvenirs, nous la modifions. Le futur, quant à lui, est une réalité virtuelle qui s’actualise en permanence. Il est rempli de surprises et de possibles qui déstabilisent en permanence les rapports et tendances qui ne feraient de lui que le simple prolongement du passé-présent. Il se préfigure dans les émergences du nouveau et les occasions qui peuplent le présent pour autant qu’on y prête attention.
Tout sociologue ne dira-t-il pas pourtant que le devenir de chaque personne se place dans des conditions sociales de réalisation ?
Oui. Mais à force de le souligner, on oublie qu’il est essentiel que les individualités s’engagent elles-mêmes de manière active dans ce qui est à leur portée. Sinon, les fameuses conditions sociales restent de pures contraintes institutionnelles. Un sujet humain peut parfaitement subir le devenir dans lequel il est engagé. Des forces sociales puissantes poussent dans ce sens. Mais il peut aussi, en prenant appui sur un travail relatif à sa mémoire, sur son intelligence vive du présent et sur ce qu’il voit émerger des futurs en gestation, réfléchir les possibles qui s’offrent à lui. Ici, la notion de « projet » reprend signification. Il peut opérer un choix. S’émanciper, c’est réveiller les devenirs possibles. C’est tenter un choix et l’éprouver, toujours en relation avec les autres. Et, si nécessaire, modifier ses options en expérimentant différents devenirs possibles. La vie sociale n’est pas un carcan d’institutions socialisatrices. Si l’on admet de façon sérieuse qu’elle est une vraie vie, elle est faite de devenirs qui se croisent, se rencontrent, s’épaulent, s’esquivent, s’opposent. C’est toute sa richesse. Simmel l’a très bien montré dans sa sociologie.
Comment se joue alors la fameuse articulation entre l’individu et la société ? Quelle est alors la place de l’individu dans la sociologie du devenir ?
Je n’ai jamais été satisfait par l’emploi de la notion d’ « individu ». Elle a servi à « monter » l’opposition, largement stérile, entre « individu » et « société ». Quand on parle d’individu, il s’agit en réalité d’un isolat fictif ; quelque chose ou quelqu’un qui pourrait être détaché du tout, cerné, identifié, pris comme temporairement achevé. Cette fiction ne correspond à aucune réalité. Aucun individu humain, quel que soit son âge, n’est achevé. Sa prétendue identité n’est souvent qu’une façade, un masque qui lui est socialement imposé. Un individu est toujours en développement, mais avec deux hypothèses qui restent ouvertes tout au long de sa vie ; le renforcement de sa puissance de pensée et d’action, ou, au contraire, son affaiblissement. Favoriser le renforcement ou provoquer un affaiblissement restent en permanence des enjeux personnels, mais aussi sociaux.
Mais il faut encore aller plus loin. L’être humain est à la fois un être social et un être de nature. Ce second aspect est largement ignoré par les sociologues, mais il est bien présent en philosophie. L’être humain est un être de nature : il est physico-biologique. L’être humain est en même temps un être social, au sens du socius comme le dit Deleuze. Pour définir l’individualité, le « social » n’est pas cette fiction ou ce but que l’on nomme une « société ». Le social précède et accompagne chacun d’entre nous comme faisceau d’affections qui naissent de la multitude des rapports entretenus avec les autres, depuis notre naissance. C’est par singularisation que l’individualité propre à chacun se forge progressivement et se transforme. On va de ce qui nous est commun vers ce qui nous est singulier. La question du devenir s’enrichit au passage d’un nouvel aspect : c’est dans le devenir et le flux de mutations dont il est constitué que l’individualité de chacun se potentialise et se transforme.
Si personne ni rien ne change, si tout mute sans cesse, que doit analyser la sociologie du devenir des individus au travail pour appréhender ces émergences ?
Il faut, surtout dans le contexte actuel d’incertitude, s’attacher à comprendre ce qui arrive de manière non-prévue dans une situation ou dans une vie. Il faut être attentif à ce qui provoque une mutation de la réalité et qui rend donc nécessaire une modification de l’action individuelle et collective. C’est ce que j’appelle évènement, ce qui provoque une mutation sous l’impératif d’une nouvelle temporalité : celle du « faire face à cet événement », un stimulant à l’inventivité et à la prise d’initiative…
J’ai introduit le concept d’événement en sociologie du travail avec un livre, Le travail et l’événement, éditions L’Harmattan en mai 1995. Je menais des recherches sur la maintenance industrielle. Je me suis aperçu que la réduction des pannes et des dysfonctionnements pouvait être l’occasion d’un apprentissage de compétences nouvelles par des salariés fragilisés par l’automatisation. Une panne par exemple introduit un nouveau cours du temps sur la ligne de production concernée : le flux s’arrête. Une temporalité qualitativement différente prend place. C’est le temps, dont la durée est inprogrammable, nécessaire pour diagnostiquer et réparer la panne, sous pression de l’urgence. Mais la panne introduit aussi un temps différé (le lendemain par exemple) pour réaliser un diagnostic approfondi et lancer les actions nécessaires à la fiabilisation durable du système technique (et social) concerné. Le couplage entre ces deux temps et ces deux activités s’est révélé être une formidable occasion d’apprentissage. Aujourd’hui, à la SNCF, je suis frappé de voir que les « situations de crise » agissent de la même façon. Elles ouvrent les mêmes possibilités de remise en cause de l’organisation et d’apprentissage. Tout devient beaucoup plus vivant, rapide, fluide, plein d’initiatives. Une situation de crise n’attend pas : les salariés concernés doivent l’affronter, souvent au milieu des voyageurs ! Et ensuite, on fait un retour d’expérience.
L’évènement comme occasion d’apprentissage, d’inventivité, de prise d’initiative, ce sont autant de manières de projeter quelque chose de soi sur le monde, de s’y reconnaitre…. La sociologie du devenir des individus au travail intègre la subjectivité ?
En effet, et j’ai modifié mon approche de l’événement pour mieux tenir compte de la façon dont les subjectivités sont sollicitées, pour voir comment les individualités s’engagent d’elles-mêmes dans leur travail.
Je me suis tourné vers Deleuze et son magnifique ouvrage Logique du sens, pour enrichir mon approche sur trois points ; le rapport au langage, à l’action et à l’anticipation. Un événement est toujours, voire d’abord, ce dont on parle spontanément. Avant de chercher intellectuellement à le comprendre et à l’expliquer, nous donnons immédiatement valeur à cet événement. Ensuite, la confrontation à un événement engage un lien explicite avec l’action. Que faire, face à lui ? C’est ce que j’appelle, après Deleuze, la contre-effectuation de l’événement. Dans mon dernier livre, j’ai pris l’exemple d’une personne qui reçoit une lettre de licenciement. Cet événement, que j’ai vécu, nous laisse d’abord incertain. Mais si on réagit de manière active, si l’on s’engage dans une contre-effectuation, nous allons déborder d’initiatives. L’événement nous stimule. Nous nous engageons dans la lutte contre ce licenciement, sans même, au départ, calculer nos chances de réussite. Enfin, dire qu’un événement surgit de manière imprévue n’est en général que partiellement vrai. Il existe souvent de nombreux indices qui auront ou auraient permis de l’anticiper. N’oublions pas le passé. Comme le devenir qu’il condense, l’évènement est en tension entre le passé et le futur. Seul est ponctuel son surgissement « au grand jour », son émergence visible. La machine a fait une longue marche vers sa panne et même bien réparée, ne sera plus la même. La personne licenciée sortira de cette épreuve transformée. On peut voir ainsi le lien interne entre les deux concepts de « devenir » et d’ « événement ». Les événements relèvent de l’avancée du devenir. Les contre-effectuations explorent les possibles dans une situation modifiée, partiellement nouvelle. Mais il est toujours possible que la contre-effectuation n’ait pas lieu, que les personnes ne fassent que subir.
On vous connaît proche des thèses d’Yves Clot. Vous revendiquez votre héritage marxiste. Comment la sociologie du devenir intègre-t-elle la vieille question de la domination et les enjeux plus récents d’une instrumentalisation de la subjectivité au travail au profit exclusif des apporteurs de capital ?
L’individualité n’enlève rien à la réalité conflictuelle des rapports sociaux. Mais un point important est qu’un rapport social ne concerne pas directement des individus, ni même des individualités. Il concerne des protagonistes. Une même individualité peut, de manière évidente, participer de plusieurs rapports sociaux : rapport entre capital et travail, rapports sociaux de genre, rapports politiques, etc. Mais on ne peut pas dire, rigoureusement parlant, qu’elle s’y engage. L’individualité est saisie et constituée par les rapports sociaux. Ce sont eux qui l’engagent en la transformant en protagoniste. Il n’existe aucune autre façon de participer à la vie sociale. Ma définition est que le rapport social est ce en quoi les protagonistes du rapport se produisent et se développent, de par leurs affrontements autour d’enjeux sociaux.
En même temps qu’ils sont produits dans le rapport, les protagonistes le transforment par leurs actions. Dans le rapport capital-travail par exemple, l’enjeu se définit pour le capital comme appropriation des forces productives. Au sein de ces « forces productives », l’enjeu central pour le capital est d’y associer l’appropriation de la plus-value engendrée par la force de travail des salariés. Pour le second protagoniste, le salarié, l’enjeu n’est pas celui-là. Il se définit dans l’expression et la libération de sa compétence professionnelle. Les autres ressources productives, telles que la technologie, le collectif de travail, peuvent y apparaître comme des associés, des alliés qu’il faut connaitre et respecter, et qui donc conditionnent et orientent l’expression de cette compétence (que Yves Clot qualifie de « pouvoir d’agir »).
La sociologie du devenir est ainsi une sociologie des émergences née tout aussi bien des évènements que des conflits et des affrontements ?
Oui, mais en précisant que l’affrontement est double. Il est affrontement entre les protagonistes, ce qui conduit à parler de lutte (lutte entre le capital et le travail par exemple), sachant que nombre d’affrontement entre capital et travail restent « silencieux », sans lutte ouverte. Il est aussi affrontement à un enjeu autour duquel se constitue et se structure le rapport. Les protagonistes s’affrontent à cet enjeu de manière souvent divergente, parfois convergente, mais non pas symétriquement opposée. Affrontement signifie ici : aller au-devant de, se saisir de l’enjeu, lui donner sens et valeur.
Cela veut dire que chaque protagoniste va s’en emparer à sa manière, en le redéfinissant.
Pour en savoir plus
Philippe Zarifian : Sociologie du devenir, éléments d’une sociologie générale, éditions L’Harmattan, février 2012








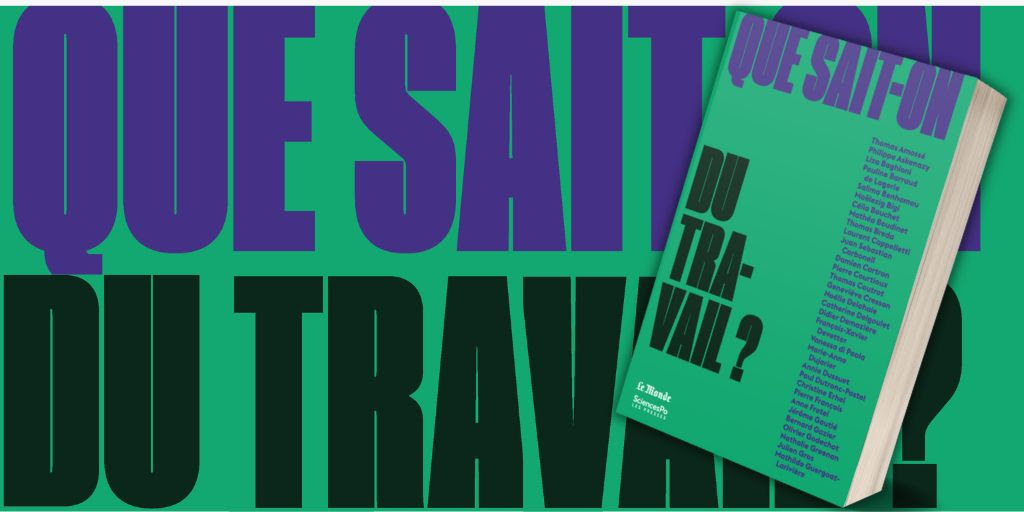
Laisser un commentaire