
Pour partie enseignant, un moment de mon travail consiste à aider les étudiants à percevoir les enjeux de la montée en intellectualisation de l’activité productive. Là réside selon moi un fil conducteur de compréhension des mutations des organisations et du travail. Elles sont liées à la part croissante en servicialisation de l’économie et en dématérialisation de la production, avec comme cause et conséquence à la fois, la montée en information du travail[1]. Il leur faut donc qualifier ce qu’est économiquement, techniquement, socialement…, la production de valeurs et d’actifs immatériels du travail intellectuel et des services. Une manière consiste à utiliser la situation de travail éducatif. Après tout, l’enseignement est un service parmi d’autres.
C’est un processus de production à base de travail intellectuel. Le travail de l’enseignant et des élèves (ou apprenants) débouche sur une prestation intellectuelle de production de valeur immatérielle. Il est intéressant d’utiliser ce vécu pour éclairer ce que la valeur des services veut dire, ce qu’est une grandeur sans dimension[2] et s’interroger sur les processus d’évaluation de cette production.
Le travail éducatif relève d’une production de valeur sans prix
D’un point de vue de gestion, comment qualifier ce que produit le travail éducatif ? La production industrielle de biens tangibles trouve principalement le support de sa valorisation dans une opération de transferts des droits de propriétés[3]. Quand un constructeur automobile vend une de ses productions, il monétise (transforme en valeur monétaire) l’essentiel de la valeur produite tout au long de la chaine de production (conception, fabrication, logistique et commercialisation), en transférant la propriété de l’objet à un client. Qu’importe ensuite pour le fabriquant l’usage qu’en fera l’acheteur/consommateur. L’objet tangible porte la valeur, matérielle et immatérielle. Il est à la fois matière transformée et nouvelle réalité informée. Au-delà des ressources transformées (détruites), l’objet « cristallise » le travail physique, automatique et intellectuel, ainsi que la part des moyens de production immobilisés (capitaux, équipements). Outre la réponse adéquate à une demande solvable, les leviers de performance privilégient la densité du travail, l’intégration technologique et les volumes. Toujours plus de la même chose favorise les effets d’échelle et d’apprentissage. Les résultats économiques et financiers de chaque acteur dépendent ensuite de leur capacité à capter le maximum de la valeur produite (et de marge) par soi-même et tout au long de la chaine fournisseurs/sous-traitants/distributeurs… Celui qui est au contact du client et qui fixe le prix sur un marché est souvent le mieux placé. C’est donc dans l’échange marchand que la valeur produite prend une forme monétaire.
S’agissant d’une prestation intellectuelle, on peut l’illustrer par la réalisation d’un cours, la valeur de la production (la performance) n’apparaît pas sous une forme tangible et mesurable. Le plus souvent (même dans l’enseignement privé) cette valeur n’est pas monétisée unitairement pour l’utilisateur/ bénéficiaire. Les droits d’inscription et autres frais de scolarité sont loin de traduire la valeur (réelle et monétaire) des enseignements auxquels ils donnent accès, surtout dans l’enseignement public. De même, si une dotation budgétaire dit le consentement politique à investir dans un service public éducatif, elle ne dit pas grand-chose de la valeur créée. Cela vaut pour tout travail intellectuel et pour les activités de services. Le résultat n’est pas proportionnel à l’effort, et la valeur n’est pas aisément ou simplement réalisée dans une opération de transfert d’un droit de propriété. L’on voit bien enfin les limites de la notion de marché pour garantir une quelconque représentativité des prix.
C’est que les leviers de la performance ne sont pas tous les mêmes. On peut bien sûr faire faire plus d’heures et moins rémunérer les enseignants. Le potentiel de productivité directe du travail est évidemment limité. Il y a bien des tentatives intéressantes pour automatiser les cours (mooc’s[4], captation vidéo). Les conditions de la production ne se prêtent cependant pas à un accroissement du rendement simplement par le volume, que cela soit par une multiplication des étudiants dans la salle ou par la répétition par l’enseignant. Il y a bien des tentatives de mesures des « résultats », par ranking ou notations des institutions comme des étudiants. Comme on souhaite leur donner la forme la plus « objective » possible (donc chiffrée) nous donnons des notes. Chacun sait que ce sont là de très pauvres adjuvants métaphoriques de ce qui fait défaut, un prix. Du coup, comme gestionnaire, les processus d’évaluation qui doivent nous renseigner sur la qualité tout à la fois de l’enseigné, de l’enseignant et de son institution, tous également juges et partis, sont particulièrement délicats.
Un travail intellectuel dans une économie servicielle
Appréhender la valeur d’un travail intellectuel et serviciel, y compris le travail éducatif, suppose un effort de dé-formation des schémas mentaux acquis. L’idée que seule l’industrie (et l’agriculture) crée de la valeur est encore très répandue notamment parmi les ingénieurs. Les courbes se sont pourtant croisées il y a 50 ans déjà. La part de la production industrielle ne cesse de décroître dans les pays développés occidentaux depuis le milieu des années 60. Elle est inférieure désormais à 20% du PIB comme de la population active. Cette décroissance est compensée plus que proportionnellement par la part des services même si cela reste insuffisant pour créer autant d’emplois que nécessaires pour absorber la croissance démographique, l’emploi des femmes …, dans un contexte de croissance ralentie. Avec moins de 5% dans l’agriculture (stable), 10 % dans la construction (variable), un maximum de 20% dans l’industrie (en décroissance tendancielle), plus de 60% de la production est servicielle. La part du travail intellectuel est évidemment très importante dans tous les secteurs. Elle ne cesse de croître du fait de la servicialisation de l’économie et de l’automatisation/numérisation de toutes les activités de production. Si l’on garde en mémoire qu’une bonne part des travailleurs de l’industrie, de l’agriculture et de la construction ne rencontre jamais directement les produits physiques, sans doute plus de 80% des travailleurs sont des producteurs de valeur immatérielle.
Il y a services et services bien sûr. Il y a les banques et assurances. Il y a les services de transports. Il y a les services publics d’Etat, des hôpitaux et des collectivités territoriales. Il y a aussi des services de sécurité et de défense publics (et privés), la police et l’armée. Il y a des services de santé et sociaux. Il y a les services aux entreprises (le facility management, l’informatique) et il y a des services à la personne. On peut résister à l’idée que les salariés des services, même peu qualifiés, sont majoritairement des travailleurs intellectuels. On sait par ailleurs que la production servicielle exige (presque toujours) des supports physiques importants, des rails aux satellites en passant par les immeubles des lycées. Toute la production servicielle n’est pas seulement immatérielle, mais pour l’essentiel, elle ne produit pas ou peu d’objet tangible. Alors comment la qualifier quand on ne peut pas mesurer ni même toujours dénombrer cette production.
Un travail dont le coût ne dit pas la valeur
L’environnement, l’éducation, la sécurité, le bien être, la citoyenneté, la démocratie, la santé …, ont évidemment de la valeur. Au-delà même, ce sont des actifs mais le prix échappe. Oui mais, objecte alors l’étudiant attentif, les produits des services ont un coût. C’est vrai du billet de train au contrat d’assurance en passant par celui d’un porte avion. C’est évidemment le cas de l’ensemble des services éducatifs. Le travail éducatif commence par un investissement bien réel, en général non rémunéré, celui de la famille et de l’entourage social. Cela continue de longues années par une mobilisation de services publics ou privés employant de très nombreux salariés : l’école, les collèges, les lycées et les universités, puis la formation professionnelle continue. C’est un secteur d’activité économique énorme dont personne ne doute de la nécessité mais dont l’appréciation de la valeur produite n’a rien d’évident, elle est sujette à débats. Si on connaît à peu près leurs coûts (pour la police ou l’éducation en comparant les dotations budgétaires annuelles par exemple), on est bien en peine de comparer des valeurs. Ces services sont déployés ou s’échangent largement en dehors d’un « vrai marché ». Pour le travail éducatif, le principal de la responsabilité de la décision qui en détermine le niveau de « coût/valeur » est politique. Elle est prise au nom d’une légitimité non scientifique ou économique. Ceci explique peut-être les raisons d’un sentiment récurrent de sous-valorisation (par l’étalon des rémunérations par exemple) de nombre d’activité de services, dont l’éducation. Non que leur valeur soit mystérieuse ou faible, mais parce que le système de monétisation masque leur utilité sociale (un construit), derrière la grossière mesure d’un coût ramené pour l’essentiel aux salaires, lui-même forgé dans un rapport de force peu favorable.
Evaluer un travail dont la production dépend également du bénéficiaire
C’est un problème social, politique, mais c’est un casse tête pour le gestionnaire s’agissant de penser les conditions de la performance d’un travail, déjà « invisible » (largement intellectuel) et dont la production (immatérielle) n’est pas mesurable. Sa valeur, pourtant centrale, ne peut être que co appréciée, c’est-à-dire, subjectivement. En effet, la valeur d’un travail éducatif n’est pas d’abord dans le travail de l’enseignant. Il peut travailler beaucoup, sans produire de valeur. Il y a une relation que l’on peut espérer positive, mais il n’y a pas de proportionnalité entre les efforts de l’un et les résultats, sur et avec, les autres. Il y a valeur à condition qu’il y ait coproduction. Ce que raconte un professeur, quels que soient ses qualités scientifiques, ses titres, son autorité, son charisme… n’a aucune valeur intrinsèque ou économique, si l’étudiant s’en fout, si les auditeurs ne sont pas ceux qui veulent (appétence) et qui peuvent (sélection) profiter de l’enseignement. Ce n’est pas l’activité du professeur en tant que telle qui fait la valeur de la prestation intellectuelle. De même, la satisfaction du bénéficiaire est un indicateur, mais très insuffisant. Dans le travail éducatif, l’objectif n’est pas d’abord de répondre à un désir, le marqueur de la valeur n’est pas le plaisir de l’auditeur/enseigné. La valeur est dans ce que (usage, utilité sociale), les formés, enfants, élèves ou étudiants, professionnels en formation, en font ou en feront, le plus souvent de manière indirecte et différée dans la durée. La valeur du travail éducatif est coproduite et médiate.
Pour autant on l’a dit, il y a des bâtiments, des salaires versés, des frais de scolarité…, bref, des coûts. Cette activité ne relève pas principalement d’un échange marchand, soit, mais il y a un processus de dépense par dotation budgétaire. Aucun ne représente efficacement la valeur économique de la production d’un point de vue gestionnaire. Comment qualifier la valeur de la production de la SNCF, d’un hôpital, de la police, d’une école maternelle ou d’une université ? Contre le prix d’un billet de train, on est transporté, mais on ne garde pas un objet en propriété. De situé dans un lieu géographique, un service de transport nous situe ailleurs. De malade ou blessé en entrant, nous sortons en principe bien portant (ou moins malade) d’un système de santé. A la sortie d’un hôpital, on est différent qu’à l’entrée, mais on reste le même et l’on n’emporte rien. La police et l’armée sécurisent mais ne « donnent rien » de tangible pour des actions qui supposent parfois des engagements importants. D’une insécurité vécue, potentielle ou avérée, la police ou les compagnies d’assurances contribuent à nous sécuriser.
Trans-former l’état d’un sujet ignorant en sachant !
Cela vaut pour les « apprenants ». D’ignorants qu’ils étaient avant un cours, sachants ils sont après, à conditions toutefois qu’ils le veuillent aussi. Par les services, nous n’acquérons rien de tangible, mais s’ils sont efficaces, notre état est modifié dans le sens souhaité. Nous reprenons ici la définition des économistes du travail et des services (Christian du Tertre, Jean Gadrey[5]) pour qualifier la valeur de la production des services ; une transformation de l’état du bénéficiaire, ou d’un élément d’environnement de l’état du bénéficiaire. La valeur de la production industrielle (« destruction créatrice ») est portée par un tangible de l’ordre de l’avoir et du consommable (consumable ?). La valeur servicielle résulte d’une modification pertinente par l’action[6] de l’état du bénéficiaire. Elle de l’ordre de l’être et du sujet (auto poïétique ?).
Dans notre illustration, elle ne se résume pas à la satisfaction, la réponse à un désir. Elle n’est pas limitée à ce qui peut être « évalué/mesuré » par des tests de connaissances ou même de mises en situation (compétences attributs). L’enseignant et ses méthodes pédagogiques sont importants relativement au process de trans-format de l’état des bénéficiaires, mais ils ne prédisent pas l’essentiel du « résultat ». Pour le gestionnaire, au-delà de la non mesurabilité de la production, cette difficulté particulière résiste. Le bénéficiaire est toujours et nécessairement producteur lui-même de la modification de son propre état, quand bien même ce ne serait que passivement. Cela reste vrai même quand il n’en a cure ou une faible conscience, se rêvant lui-même « consommateur d’un produit », même quand l’exercice lui pèse et quand l’enseignant l’agace ou l’ennuie sur le moment. Evaluer cette production exige d’autres processus, au-delà de la fameuse comparaison de l’offre et de la demande modulo la rareté… La valeur produite à apprécier relève d’une coproduction. S’agissant de l’état d’un sujet, elle ne peut être que subjective et co-évaluée par le sujet lui-même.
Enfin, sur l’activité éducative elle-même, à l’heure de la réalisation du mythe de Saint Denis, chacun porte sa tête dans sa main (un smartphone). Avec l’accès d’un pouce à la connaissance du monde par le Net (Michel Serres), la mutation des institutions et du travail éducatif est à faire. Il faut pour cela dépasser la pensée « industrialiste » et financiarisée qui reste dominante dans ce service comme dans beaucoup d’autres. La révolution était achevée lorsqu’elle éclata (Chateaubriand) ! Le travail éducatif reste, la mutation des métiers d’enseignant ne fait que commencer.
[1] BARON X., 2012, La performance collective, Editions Liaisons.
[2] SCHWARTZ Y., 2009, Travail et Ergologie – entretiens sur l’activité humaine – tome II, Chapitre 5/11 du Manifeste pour un Ergo-engagement, sous la direction d’Yves Schwartz et Louis Durrive Editions Octarès, Toulouse, p. 286
[3] On ne revient pas ici sur les process amonts d’accumulations (dites) primitives de la valeur, notamment par la prédation directe de la planète comme des humains (pillages, guerres, esclavage, servage…).
[4] Formations en ligne ouvertes à tous, gratuites ou non, certifiantes ou non (Massive Open On ligne Course).
[5] Jean Gadrey, Services, la productivité en question, Desclée de Brouwer, 1996.
[6] Il serait plus juste de parler de la mise en œuvre d’un processus. Si résultats et qualité il y a, ils sont d’abord dans la pertinence d’un processus de modification de l’état du bénéficiaire, y compris largement par lui-même et sur la durée. Sur ces notions d’action, de résultat, de qualité et d’efficacité, voir François Jullien, Traité de l’efficacité, Le Livre de Poche, 1996.







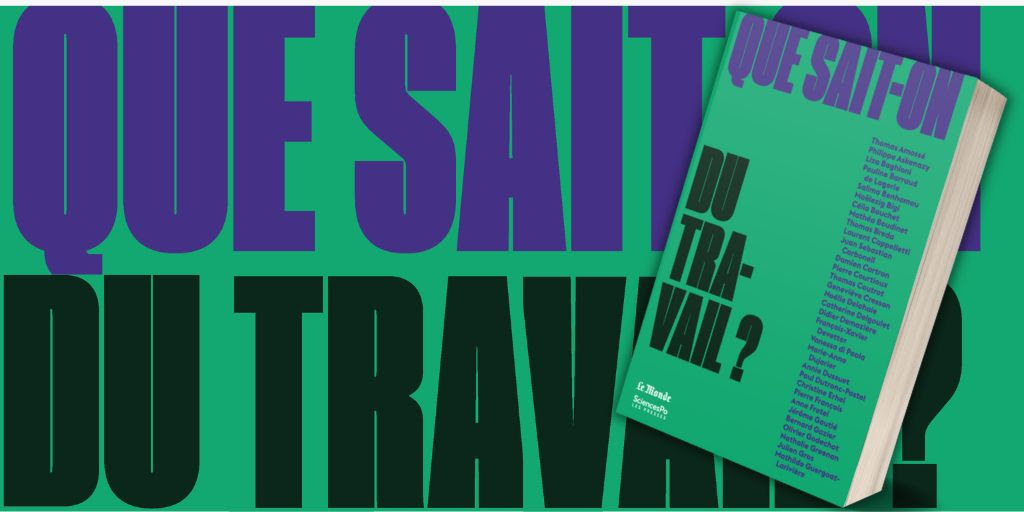

Laisser un commentaire