 par Hugo Boris, propos recueillis par Denis Maillard
par Hugo Boris, propos recueillis par Denis Maillard
Dans son dernier roman, Police (Grasset), l’écrivain Hugo Boris met en scène Virginie, Aristide et Érik, trois gardiens de la paix du commissariat du 12ème arrondissement de Paris que l’on suit un soir d’été sur 25 kms, entre le centre de rétention de Vincennes et l’Aéroport Charles-de-Gaulle. Leur mission ? Mettre dans un avion pour la Turquie un clandestin tadjik dont la justice a ordonné l’expulsion. Unité de lieu, de temps et d’action pour cette tragédie digne de l’antique. Mais pour une fois le chœur reste muet. Embarqué dans la voiture de patrouille, il ne peut qu’observer les tiraillements du cœur et de la raison que vont connaître tour à tour ces trois flics de terrain. Ce roman est aussi une description minutieuse du travail de ceux qu’Hugo Boris appelle « les couteaux suisses de l’ordre républicain », ces gardiens de la paix qui n’ont jamais très bonne presse chez les citoyens et chez les écrivains. Et pourtant ils existent. Pour mieux les connaître, nous avons demandé à Hugo Boris de nous dire ce qu’il avait appris d’eux.

Comment l’idée d’écrire un roman sur la police vous est-elle venue ? Pourquoi avoir choisi ce sujet ?
L’idée m’est venue une nuit de janvier 2010. Donc bien avant le regain d’affection (certes passager) qu’ont connu les forces de l’ordre en 2015 à la suite des attentats et aussi avant la crise des migrants. Cette nuit-là, j’écoutais sur Europe 1 la rediffusion d’une émission consacrée à la « police en tenue » c’est-à-dire les gardiens de la paix. Quand on y réfléchit bien, dans la littérature, la police n’existe qu’à travers les enquêteurs, les gradés, les policiers de la Criminelle ; pas à travers ses petites mains et les couteaux suisses de l’ordre républicain. Quand la littérature s’intéresse à la police, elle parle toujours du 36 (quai des Orfèvres) et jamais du 17 !…Or, en explorant leur univers je me suis rendu compte que sur le plan dramaturgique, il n’y avait qu’à se baisser pour ramasser des histoires.
Au moment où vous commencez votre roman, l’univers des policiers vous était-il familier ?
Non. Et c’est pour cette raison que je dois enquêter, rencontrer des policiers… Ce point est important parce que lorsque j’ai commencé à écrire des romans au début des années 2000, le bruit de fond était que les écrivains n’avaient plus d’imagination, la littérature française célébrait l’autofiction et la qualité d’un livre était indexée sur le vécu de son auteur. Je ne me reconnais pas dans cette vision de la littérature, même si j’apprécie aussi de lire de l’autofiction. C’est à partir du réel que mon imagination prend forme. Il y a une phrase d’Hervé Guibert qui l’explique très bien. Guibert écrit : « J’aime dans le travail le moment où il décolle imperceptiblement vers la fiction après avoir pris son élan sur la piste de la véracité. » C’est exactement ce que je ressens. J’ai besoin de ce tarmac réel avant l’apesanteur de l’imagination. L’immersion et l’enquête sont donc des « pré-textes » pour dire le réel ; elles arrivent avant le texte, avant l’écriture.
Précisément, comment avez-vous procédé ?
Cela s’est fait progressivement et a pris un an en tout : j’ai commencé à rencontrer des policiers, maladroitement d’abord. J’ai abordé des policiers en service, dans la rue. Mais ce n’était pas une bonne idée. Ils sont sur leurs gardes, se demandent ce que vous leur voulez. Par connaissances communes, j’ai réussi à rencontrer des policiers en dehors de leur travail ; là on peut mieux parler. J’ai pu aussi rencontrer des gradés. C’est cela qui a tout déverrouillé : ils ont compris ce que je voulais faire, ma sincérité. Je suis romancier, pas journaliste ; je n’enregistre rien. Je cherche à me mettre à la place de ceux que j’observe. Ainsi j’ai demandé à ce qu’on me mette des menottes, à porter un gilet pare-balles, à subir une palpation de sécurité contre une voiture : la palpation réglementaire, celle qu’on apprend à l’école de police, mais aussi celle qui est moins amène lorsqu’il s’agit d’écarter les jambes du suspect d’une balayette du pied et de lui faire baisser le regard quand il est un peu virulent. Cela reste légal ; ce sont des trucs du métier. Mais j’en avais besoin pour comprendre les gestes. Petit à petit, j’ai été accepté au commissariat, puis au service de nuit et enfin en véhicule. J’ai pu aussi me rendre à l’école de police de Nîmes, l’une des plus grandes en France où l’on forme les gardiens de la paix.
Comment pourriez-vous décrire le travail de ces gardiens de la paix ?
C’est un métier qui demande une très bonne intelligence des situations et une grande souplesse psychologique. C’est cela qui domine. Du matin au soir, ils passent du banal au tragique, du vol d’enjoliveur à la femme battue, de la divagation d’un animal sur la voie publique à l’arrestation d’un forcené retranché dans son appartement. Tout cela c’est la police nationale. Mais qui est prêt à cela dans son travail ? D’une opération à l’autre, ils ne savent jamais sur quoi ils vont tomber. Ils déploient des trésors d’adaptation : ne jamais laisser s’enliser des discussions tout en étant à l’écoute et ferme si besoin… Ce métier les marque, il les habite et les poursuit jusque dans leur vie privée. Je suis impressionné par tout ce qu’ils voient et ce qu’ils ramènent avec eux à la maison. J’ai rencontré à Lyon un jeune policier qui venait de la même ville que moi. On avait grandi au même endroit, à Palaiseau, et on se rappelait les lieux qu’on avait fréquentés l’un et l’autre. Il me disait : « quand je retrouve mes copains de lycée, je les envie car ils sont encore légers ; moi, je n’ai plus d’innocence. J’ai vu l’envers du décor ». C’est cela être policier. On dit que l’État a le monopole de la violence légitime, mais ceux qui sont en position d’exercer cette violence sont les mêmes qui se prennent la violence du monde en pleine face. Et ils ne sont pas sûrs d’en revenir… J’ai rencontré une fois, un policier qui me disait que le matin, en s’habillant, il faisait attention au caleçon qu’il choisissait pour être présentable en cas d’autopsie. Il y a des choses que seul le réel peut vous souffler à l’oreille, que l’imagination ne peut pas inventer. Par exemple, certains policiers inscrivent leur groupe sanguin au feutre sur leur gilet pare-balles. Voilà ce que j’ai compris de leur travail.
Qu’avez-vous cherché à dire sur la police à travers cette fiction ?

C’est d’abord un roman, pas une enquête sociologique. Je n’ai pas de théorie ou de thèse, mais plutôt un thème que j’explore à travers la fiction. Celui du conflit entre légalité et légitimité. C’est celui de ces policiers chargés de reconduire un clandestin à l’aéroport. C’est le vieux conflit entre Créon et Antigone qui court de Sophocle à Jean Anouilh. Érik, le chef d’équipe serait Créon et Virginie serait Antigone. Mais dans l’histoire de la littérature, c’est la version d’Anouilh qui m’intéresse le plus : il réhabilite Créon, il comprend ses raisons, alors que Sophocle laisse toute la place à Antigone. Bien sûr, comme Virginie, j’aimerais ouvrir la porte de la voiture et permettre au clandestin de s’enfuir. Mais je comprends Érik aussi. Ce qu’il dit a du sens. Il est le dernier maillon de l’autorité de l’État… il y a une anecdote que je n’ai pas mise dans mon roman et qui se passe à l’école de police de Nîmes. Je discutais avec des gradés et l’un d’entre eux m’a fait part d’un phénomène nouveau : les gardiens de la paix sont de plus en plus diplômés. Certains ont des masters de philo, d’autres ont fait des études de droit. Pourtant, ce sont des métiers d’exécutants. Cela pose alors des problèmes de management : ces jeunes diplômés sont moins malléables et vont au-devant de déconvenues. Ils discutent davantage les ordres, posent des questions. Ce qui est bien, mais difficile à vivre pour le management. Cela est vrai dans toute la fonction publique : les agents sont de plus en plus diplômés.
Des policiers ont-ils lu votre travail ? Qu’en ont-ils dit ?
Oui et ils ont trouvé que c’était fidèle. Pas forcément tendre pour eux, mais fidèle. Une jeune policière fâchée avec la lecture m’a dit que cela l’avait réconciliée avec les livres.
Peu après la sortie de votre livre, des collectifs de policiers ont manifesté durant plusieurs nuits pour dénoncer leurs conditions de travail : cette colère vous a-t-elle surpris ? Êtes-vous allé les rencontrer ?
Je ne suis pas allé les rencontrer. Une fois que le livre est écrit, je l’accompagne pour le promouvoir, mais j’ai une forme de rejet du sujet qui m’a accompagné lui aussi durant trois ans. Je ne suis plus en recherche. Par ailleurs, je ne me sens pas porte-parole des policiers et mon livre n’est pas un état des lieux de la police aujourd’hui. Moi, je suis un artisan qui écrit des histoires. Mais j’ai de l’empathie pour ce qu’ils vivent et je comprends leur démarche. Mais mon travail reste neutre, si possible universel. Ce n’est pas un reportage d’actualité. C’est pour cela que je ne fais pas référence aux attentats par exemple. Mis à part la saison, les lieux et le trajet entre Vincennes et Roissy, on ne peut pas savoir quand cette histoire se déroule. Il y a dix ans ? Dans dix ans ? Le choix de la nationalité d’Asomidin Tohirov n’est pas anodin non plus ; il est tadjjik. Il incarne l’immigré universel. Les policiers ne sont pas stupides, ils savent ce qui se passe en Syrie et ont un avis sur la question. Le Tadjikistan, c’est plus loin, plus inconnu. On laisse donc la question morale à nue. C’est celle-ci qui m’intéresse.
A relire
« Quand l’institution fait oublier le travail », par Danielle Kaisergruber – 28 Novembre 2016







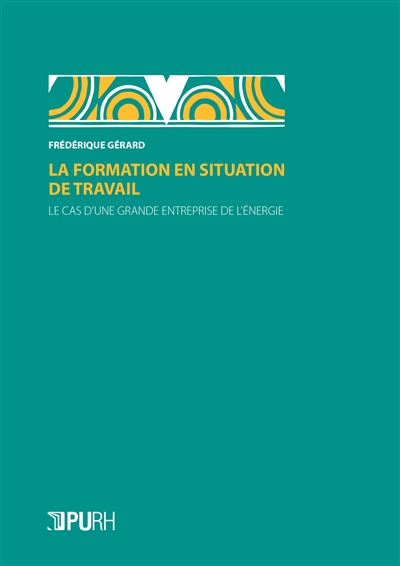

Laisser un commentaire