50 ans, c’est par excellence l’âge du bilan. Qu’en est-il du système de formation professionnelle continue (FPC) issu de la loi fondatrice de 1971, dite « loi Delors » ? A-t-il répondu aux ambitions de ses pères fondateurs ? S’en est-il éloigné au fil des réformes récurrentes dont il a fait l’objet ? Et pour quels résultats ? Croisant les deux regards de l’expert et du syndicaliste, Didier Gélot et Djamal Teskouk dressent dans le livre qu’ils publient un constat sévère, entre échec et trahison. Mais pas désespéré : pour eux, il est toujours possible de repenser un système de formation au service de l’intérêt commun.
Metis : Votre ouvrage dresse de ces 50 années de FPC en France une fresque instructive et documentée, en évitant le double écueil du jargon et de la technicité. Mais le bilan que vous en tirez est franchement négatif. Pourquoi un jugement aussi sévère ?
Didier Gélot et Djamal Teskouk. Soulignons en préalable qu’aborder la formation continue comme un objet en soi n’aurait pour nous guère de sens : nous avons voulu l’analyser comme un élément de la totalité économique et sociale dans laquelle elle s’insère. La bonne question était donc de se demander, dans une démarche compréhensive, dans quelle mesure les décisions prises en matière de FPC se sont intégrées dans les choix économiques et politiques globaux opérés au fil du temps.
Nous avons pour ce faire confronté nos expériences respectives : pour l’un, celle d’un expert de l’évaluation publique de la formation professionnelle ; pour l’autre, celle d’un syndicaliste CGT impliqué dans les nombreuses négociations interprofessionnelles sur la FPC. Un point de vue global d’un côté, plus opérationnel de l’autre, entre lesquels nous avons cherché un équilibre de façon à proposer une analyse utile aux praticiens de la formation — notamment aux acteurs syndicaux. Le tout sans entrer dans un trop grand détail, afin de rester accessibles aux non-initiés.
Ce faisant notre but n’était pas tant d’établir un constat d’échec — même si nous assumons ce terme sans réserve — que de mettre en lumière les tensions qui n’ont cessé depuis 1971 de traverser le champ de la formation continue, constamment tiraillée entre des objectifs que nous jugeons pour certains positifs et pour d’autres néfastes aux intérêts de l’économie et des salariés. Notre intention n’était pas d’écrire un pamphlet, mais de livrer des évolutions du système une analyse mesurée, entre avancées et reculs.
D’un bout à l’autre, c’est la loi fondatrice de 1971 que nous avons pris pour référence. Son apport essentiel a été de poser la formation professionnelle continue comme une « obligation nationale ». Une formule certes ambigüe en ce qu’elle ne disait pas clairement à qui incombait cette obligation, mais qui avait le mérite de poser le rôle essentiel de l’État, non seulement pour le contrôle du système, mais aussi comme acteur. Là où les choses se compliquent, c’est que la loi Delors assignait également à la FPC deux missions essentielles, complémentaires, mais rendues antinomiques par les employeurs : assurer l’adaptation des travailleurs aux besoins de l’économie d’une part, s’inscrire dans le cadre de l’Éducation permanente et de l’émancipation des personnes de l’autre. Et cette ambiguïté va persister dans les choix qui seront faits au fil des années, confrontant chaque fois les acteurs au même dilemme : adapter les travailleurs aux changements de l’économie, ou bien leur permettre de s’accomplir comme citoyens ? Pour nous, tous les changements qu’a connus la FPC depuis 1971 peuvent se lire à la lumière de cette tension permanente entre ces deux missions.
À ce propos, quelles en ont été pour vous les étapes marquantes ?
 Elles sont a priori nombreuses, puisqu’une quinzaine de textes (souvent des accords nationaux interprofessionnels [ANI] suivis d’une loi) se sont succédé en cinquante ans. La première s’ouvre avec la loi de 1978 ; elle vise à outiller et mettre en œuvre les principes de 1971, tout en dessinant déjà des tendances nouvelles avec le passage de la notion de stage à celle d’action de formation, qui aboutira plus tard à mettre celle de parcours au centre du système. Puis vient la loi de 1984, qui rend effectif le droit au CIF et ouvre la FPC à l’alternance pour les jeunes, mais renonce à porter la contribution financière des employeurs à 2 % de la masse salariale, comme le prévoyait la loi de 1971. On renonce donc à cette ambition initiale.
Elles sont a priori nombreuses, puisqu’une quinzaine de textes (souvent des accords nationaux interprofessionnels [ANI] suivis d’une loi) se sont succédé en cinquante ans. La première s’ouvre avec la loi de 1978 ; elle vise à outiller et mettre en œuvre les principes de 1971, tout en dessinant déjà des tendances nouvelles avec le passage de la notion de stage à celle d’action de formation, qui aboutira plus tard à mettre celle de parcours au centre du système. Puis vient la loi de 1984, qui rend effectif le droit au CIF et ouvre la FPC à l’alternance pour les jeunes, mais renonce à porter la contribution financière des employeurs à 2 % de la masse salariale, comme le prévoyait la loi de 1971. On renonce donc à cette ambition initiale.
L’ANI et la loi de 1991 reflètent les mêmes tensions. D’un côté, une contribution obligatoire de 0,15 % est introduite pour les petites entreprises (moins de 10 salariés) ; de l’autre, et c’est un moment fort, car très structurant pour la suite, la notion de compétence commence à s’installer au détriment de celle de qualification ; ces deux textes sont aussi les premiers à dissocier, avec l’idée du « co-investissement », temps de formation et temps de travail.
À son tour, la loi de 2004 donne à voir la recherche d’un équilibre entre changements positifs et négatifs. D’un côté l’obligation légale est portée à 1,6 % de la masse salariale et augmente fortement (de 0,25 à 0,55 %) pour les TPE ; de l’autre, l’introduction d’un droit individuel à la formation (DIF) réalisé à priori hors temps de travail donne un cadre législatif au co-investissement. Cet équilibre est pour nous porteur de dangers.
Dix ans plus tard, la loi de 2014 franchit un nouveau pas. Elle transforme le DIF en Compte personnel de formation (CPF) et l’inscrit sans équivoque dans une logique « adéquationniste », où la FPC a pour mission première l’adaptation des compétences des actifs aux besoins de court terme des entreprises, plutôt que le développement culturel et professionnel des citoyens. Sans aller jusqu’à parler de rupture, c’est bien un basculement du système qui s’opère alors en faveur de l’individualisation et de la marchandisation des formations. Ce choix doit être replacé dans le contexte plus large d’un train de réformes porté par l’évolution de la social-démocratie visant à « libérer l’entreprise ». La loi de 2014 réduit la contribution obligatoire des entreprises à 1 % et supprime la déclaration fiscale « 2483 », qui permettait de suivre leurs dépenses de formation. Dans la foulée, en regroupant les différentes obligations de consultation des salariés, la loi Rebsamen noie en 2015 la formation professionnelle dans un ensemble de sujets où elle risque d’être encore moins prise en charge par les syndicats qu’elle ne l’était. Dans le même esprit, la loi El Khomri va l’année suivante faciliter le licenciement et donner la primauté aux accords d’entreprise sur les accords de branche. Toutes ces réformes ont en commun une franche orientation « pro entreprise », où le développement de la FPC est présenté comme une compensation du recul des autres droits sociaux, tout en ouvrant lui-même la voie à d’autres reculs…
C’est donc pour vous l’adaptation des compétences aux besoins de court terme qui l’a emporté. Est-ce qu’au moins sur ce plan la FPC a su remplir son rôle ?
Oui et non, car ici revient la question des inégalités d’accès à la formation continue. Elles ont été suffisamment documentées pour que nous n’y revenions pas en détail dans notre livre, mais il est évident que certains salariés ont pu s’adapter et d’autres non. C’est ce que confirment les premiers travaux d’évaluation du CPF : il a été principalement mobilisé pour des formations courtes d’adaptation au profit de personnes déjà relativement qualifiées, et compte tenu du faible apport financier exigé de la part de l’entreprise c’est la capacité d’abondement du CPF par les salariés eux-mêmes qui a souvent fait la différence.
De ce point de vue la réforme de 2018 ne risque pas d’arranger les choses puisqu’en monétisant le CPF elle marque l’aboutissement de la logique individualiste et consumériste dont le compte est porteur. À quoi s’ajoutent les mesures de désintermédiation qui laissent le salarié seul face au marché de la formation, sans l’appui d’intermédiaires publics ou paritaires capables d’accompagner ses choix, mais qui dans la logique du présent quinquennat (cf. le programme de LREM) sont vus comme des obstacles au développement de la formation.
Pourtant les discours ne manquent pas sur les grands enjeux que sont aujourd’hui les transitions numérique, écologique et technologique ; force est malheureusement de constater que la FPC n’a pas été mobilisée pour préparer les salariés à ces mutations, et on peut craindre que ce soit encore le cas à l’avenir. À preuve les annonces récentes du Premier ministre, Jean Castex, qui se focalisent sur les difficultés actuelles de recrutement sur les métiers « en tension » et la nécessité d’y répondre dans l’urgence. De vieilles recettes, qui ont depuis longtemps montré leur inanité, en donnant priorité à l’adaptation immédiate aux besoins économiques de court terme. Cette adaptation était certes, comme nous l’avons nous-mêmes souligné en commençant, l’une des deux missions fondatrices énoncées par la loi Delors. Mais à l’époque, l’impératif d’adaptation-reconversion avait un sens beaucoup plus positif : il s’agissait non de répondre aux besoins immédiats de recrutement des employeurs, mais d’adapter les qualifications des actifs à l’évolution des besoins de la société, dans l’intérêt des gens eux-mêmes. En d’autres termes, l’échec de la FPC vient pour nous de ce que sa mise en œuvre ne s’est pas inscrite dans un projet global de transformation économique et sociale.
Le paritarisme a été l’un des piliers du système français de formation professionnelle continue mis en place en 1971, avant que la loi de 2018 ne rétrécisse singulièrement son périmètre. Quel bilan tirez-vous de ce point de vue ?
Au cours des cinquante dernières années, le paritarisme est intervenu à deux niveaux : celui de la loi négociée — en 1971 s’installe le principe qu’une loi devait être précédée d’une forme de concertation dans laquelle les organisations syndicales et patronales devaient en préalable à un projet de loi exprimer leurs souhaits d’évolution — et celui de la gestion — ou de la gouvernance pour employer un terme plus actuel — du système.
Sur le premier point, la « loi négociée » est formellement toujours en œuvre. Elle a même été instituée par la loi Larcher de 2007 (article 1er du Code du travail) ; mais de fait, avec la réforme de 2018 l’exécutif s’en est émancipé, manifestant une volonté évidente de ne pas tenir compte de l’avis des organisations syndicales représentatives.
En ce qui concerne la gouvernance, la mise en œuvre du CIF en 1978 se traduit par un financement dédié (0,1 %, qui devient 0,2 % en 1993) et par la mise en place de structures paritaires qui gèrent l’attribution du CIF. Cela a été un grand succès : ces Fongécif (et autres Opacif) ont fait un travail remarquable d’élaboration des modalités d’accompagnement des salariés pour qu’ils construisent un projet personnel et professionnel qui aboutisse réellement soit à un progrès professionnel, soit à une meilleure inscription des salariés dans l’activité professionnelle, soit à une reconversion totale. En outre les acteurs paritaires se sont préoccupés de trouver un équilibre entre les interventions du niveau interprofessionnel et celles des branches ; la tâche a été cependant difficile du fait d’un paysage éclaté en de trop nombreuses branches, dont beaucoup n’intervenaient pas du tout dans le champ de la formation.
Avec la réforme de 2009, à propos de laquelle nous parlons dans notre livre d’une ambition avortée, les organisations syndicales et patronales manifestent la volonté d’adopter une stratégie nationale en matière de formation professionnelle. Elles se saisissent ainsi d’une mission d’intérêt national. La loi qui suit entérine la mise en place les moyens de financement correspondants — à hauteur de 13 % de la contribution des entreprises — et les outils pour servir cette ambition. Ce renforcement des prérogatives et des moyens donnés au niveau national et interprofessionnel au paritarisme s’est fait naturellement au détriment du pouvoir des branches. 2014 a marqué de ce point de vue un retour de balancier, qui enlève au national interprofessionnel une partie de ses prérogatives pour les redonner aux branches professionnelles ; mouvement encore plus marqué avec la loi de 2018, qui ne laisse quasiment plus de prérogatives au niveau national interprofessionnel.
Nous avons beaucoup discuté entre nous sur ce point ; il ne s’agit pas d’opposer paritarisme et rôle de l’État, mais nous observons que, depuis quelques années, quand l’État prend ses responsabilités, il ne les prend pas assez, ou pas pour les bonnes raisons, pas pour répondre aux véritables besoins de la nation. Il y a une bien reprise en main du système par l’État, non pas au profit du bien commun — en vue d’un développement économique harmonieux — mais plutôt dans un objectif de réponse aux attentes des employeurs.
Un exemple caractéristique en est fourni par la monétisation et la désintermédiation du CPF. Celui-ci est devenu un « cheval fou » tant en termes de niveau de dépense — qui explose complètement — qu’en termes d’intérêt — critiquable sauf exception — des formations réalisées dans ce cadre. Globalement le CPF aujourd’hui ne permet pas une réelle évolution, que ce soit du point de vue de l’épanouissement personnel ou professionnel ou du point de vue de la société ; l’État ne s’est pas donné les moyens pour que le CPF soit utile à la société et réellement utile aux personnes
Toujours à propos du paritarisme, il semble qu’en 1971 l’idée d’organiser la FPC comme une assurance sociale (cotisation salariale et patronale, caisse paritaire) était dans les esprits. Pourquoi ce projet ne s’est-il pas réalisé ?
La dimension d’obligation nationale s’est en effet traduite par une obligation de financement de la formation professionnelle par les seules entreprises. Cela nous paraît tout à fait juste. Elles ont en effet une responsabilité propre puisqu’elles bénéficient par ailleurs de l’éducation nationale qui leur permet d’employer des salariés d’un niveau d’éducation élevée grâce au financement public de la formation initiale générale et professionnelle. Il est donc normal qu’elles contribuent à la part qui leur revient, à savoir l’adaptation des salariés à leur emploi et pour partie à leurs besoins d’évolution et de reconversion professionnelle. Pour ce qui est de la pertinence à créer une source de financement sous forme de cotisation sociale pour donner une dimension nouvelle à ce qui reste aujourd’hui du CIF, c’est-à-dire le « CPF de transition » seule la CFE-CGC parmi les organisations syndicales soutient une proposition de ce type depuis plusieurs années.
Votre ouvrage a pour objet l’histoire de la FPC, mais entre les lignes se dessinent les traits d’un contre-modèle. Pouvez-vous revenir sur les propositions que vous faites à cet égard dans votre conclusion ?
Ces propositions doivent être considérées comme des pistes de réflexion que nous soumettons au débat, sans qu’il soit question pour nous de nous substituer aux acteurs du système. Comme nous l’avons dit en commençant nous considérons que prendre la FPC isolément n’a pas beaucoup de sens et que la question centrale est double : dans quel projet de développement économique et social s’inscrit la nation ? Quelle place pour la formation dans ce projet ? Il y a bien sûr des aspects des réformes qu’il faudrait remettre en cause immédiatement, comme l’abandon du CIF, de l’obligation légale ou encore la monétisation du CPF et sa désintermédiation. Sur les aspects plus structurels, on peut distinguer cinq grandes pistes de réflexion.
— Accroitre l’effort financier : la formation devrait être considérée comme un bien commun, ce qui n’a jamais vraiment été le cas. Nous montrons que si on avait fait d’autres choix politiques que celui consistant à exonérer sans cesse davantage les entreprises de leurs cotisations sociales, on aurait pu dégager des masses financières tout à fait consistantes pour la FPC. Si on veut vraiment que celle-ci joue son rôle, il faudra y mettre des moyens.
— La formation initiale différée : il s’agit de rétablir ce qui n’a pas été obtenu par la formation initiale. On pourrait pour cela prendre pour référence la moyenne des années de scolarité suivies par ceux qui ont eu la possibilité de la mener à bien, et on donnerait à ceux qui n’en ont pas eu la possibilité un droit de tirage pour rétablir l’égalité. Face à un système qui tend à aggraver les inégalités de départ au lieu de les corriger, il s’agit de rétablir une certaine égalité de perspectives, d’offrir des chances de développement personnel et professionnel égales à tous les jeunes.
— La reconversion : on entend dire constamment que tout actif devra changer plusieurs fois de métier en cours de vie active, et il y a en effet un besoin impérieux, mais très mal pris en compte, de reconversion des actifs. En outre le caractère procyclique des dépenses de formation des entreprises (encore confirmé durant la crise sanitaire) joue à l’encontre de ce besoin, tout comme l’insuffisance des tentatives récentes pour accompagner les transitions collectives. Tout cela plaide pour un droit à la reconversion accessible aux salariés et aux travailleurs de façon plus large.
— Droits des salariés dans l’entreprise : le patronat s’est toujours violemment opposé à ce que la formation fasse l’objet dans l’entreprise d’une négociation, considérant que cela relevait de sa seule responsabilité, et le droit de consultation sur le plan de formation est la seule chose qui a pu être imposée. Ce droit a cependant été amoindri par les réformes de 2014-2015 et encore plus par les ordonnances de 2017. Ce droit des salariés à être représentés et à peser sur les choix des entreprises en matière de formation devrait être renforcé. C’est une piste essentielle, car l’idée même que des formations puissent être utiles à la fois aux salariés et aux entreprises ne peut être envisagée de façon équilibrée que dans un cadre où collectivement les droits des salariés sont défendus. Cet encadrement du pouvoir de l’entreprise, en matière de choix des formations et de ceux qui en bénéficient, est un élément essentiel pour permettre à la FPC d’être réellement utile à l’économie nationale et aux travailleurs.
— Reconnaissance de la formation : c’est le parent pauvre des réformes successives. Il faudrait réfléchir à un droit à la reconnaissance. Ce droit obligerait l’employeur à reconnaître dans un cadre collectif les qualifications acquises par un salarié dans le cadre d’une formation. Il permettrait d’encourager des catégories entières de salariés à s’engager dans une formation et notamment les moins qualifiés. Ce droit entrerait ainsi en opposition avec la notion de compétence, que le patronat et certains courants politiques ont réussi à imposer au détriment de celle de qualification. Alors que la reconnaissance de la compétence est à la main de l’employeur, la qualification se place en effet dans le cadre des conventions collectives et des grilles de classification. On se donnerait avec ce droit la possibilité de mettre en place des modalités sécurisées de reconnaissance des acquis de la formation.
La mise en œuvre de ces nouveaux droits serait pour nous le moyen de réconcilier les deux objectifs d’adaptation et de développement professionnel assignés dès l’origine à la FPC ; ainsi pourrait-elle concourir à donner un sens au travail.
Une nouvelle réforme du système est, semble-t-il, engagée. Sait-on ce qui est sur la table ?
Les partenaires sociaux (hors CGT) ont formulé 49 propositions qui s’appuient sur les critiques implicites ou explicites des choix opérés par la réforme de 2018, et notamment celui d’affecter une partie importante des financements des entreprises à la formation des demandeurs d’emploi au détriment de celle des salariés. Les critiques portent également sur la réalité du CPF, qu’il s’agirait de réorienter vers des formations plus utiles socialement. Elles portent aussi sur le manque de données permettant d’évaluer la loi, mais surtout sur le financement de la formation professionnelle qui, en l’état, n’est plus assuré, France compétences étant obligé d’emprunter sur le marché financier pour assurer les demandes de formation.
On le voit, le seul fait que trois ans seulement après ce qui était présenté comme un « big bang » de la FPC, le gouvernement décide de revoir les mesures prises en matière de financement de la formation et de gouvernance du système est en soi un véritable constat d’échec !
Pour en savoir plus
– Didier Gélot et Djamal Teskouk, « 1971-2021. Retour sur 50 ans de formation professionnelle » Editions du Croquant
– Droit Social N° 10-2021, « Formation professionnelle 1971 – 2021 », dossier coordonné par Jean-Marie Luttringer
Metis Septembre 2021, Jean-Marie Luttringer, Evaluation de la Loi « Avenir professionnel » de 2018
https://www.metiseurope.eu/2021/09/24/evaluation-de-la-loi-%e2%80%89avenir-professionnel%e2%80%89-d










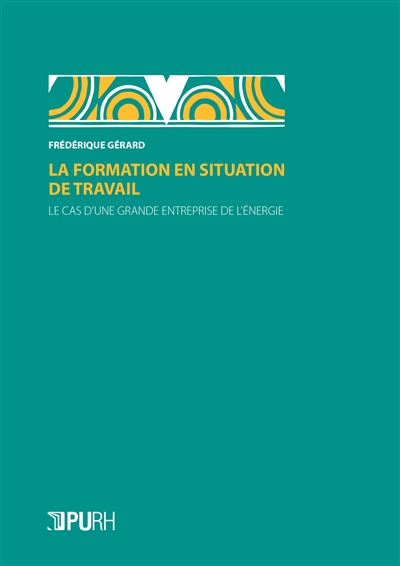
Laisser un commentaire