Le travail ne tient que très rarement le rôle d’un personnage principal dans la dramaturgie des campagnes présidentielles. Comme toujours, il est phagocyté par la tyrannie de l’emploi et plus récemment par celle du pouvoir d’achat, qui capte toute la lumière. Pourtant, les Français entretiennent un rapport très riche avec le travail, avec leur travail. Lorsqu’un candidat parvient à s’emparer de cette thématique et à faire résonance avec les enjeux du moment, comme François Mitterrand en 1981, Jacques Chirac en 1995, Nicolas Sarkozy en 2007 ou Emmanuel Macron en 2017, une alchimie s’opère, qui provoque la « rencontre d’un homme et d’un peuple »… Voyons comment le travail s’est invité (ou non) dans les principales campagnes présidentielles en France depuis que ces élections reposent sur le suffrage universel direct.
1965 : « Moderniser la France »
 Le premier scrutin présidentiel au suffrage universel direct est à l’origine d’une surprise : le Général est mis en ballotage. Pas par un intérêt soudain pour le travail, ni même par le fait d’un débat sur l’autorité, qui allait pourtant provoquer les convulsions de mai trois ans plus tard. Le travail ne fait qu’affleurer dans la campagne du premier tour, sous la forme d’une opposition entre l’âge, le conservatisme et la rente d’un côté, auxquels s’opposent la jeunesse, la volonté de changement et l’appui sur le monde du travail. Les deux principaux opposants au Général misent sur la jeunesse et la modernité. Dans sa « profession de foi », Jean Lecanuet insiste sur la volonté de « moderniser la France » ; affirmant que « le pays rejette le passé, mais le présent l’inquiète. Il attend une volonté jeune, franche et constructive ». Le slogan de campagne de leur adversaire SFIO (ancêtre du PS) lors du deuxième tour résume l’alternative : « François Mitterrand, un Président jeune pour une France moderne ». La campagne du second tour ignore le travail. Elle est axée sur l’armement nucléaire et sur les relations internationales et en particulier l’Europe – il fut un temps où les politiques parlaient d’Europe pour intéresser les citoyens…
Le premier scrutin présidentiel au suffrage universel direct est à l’origine d’une surprise : le Général est mis en ballotage. Pas par un intérêt soudain pour le travail, ni même par le fait d’un débat sur l’autorité, qui allait pourtant provoquer les convulsions de mai trois ans plus tard. Le travail ne fait qu’affleurer dans la campagne du premier tour, sous la forme d’une opposition entre l’âge, le conservatisme et la rente d’un côté, auxquels s’opposent la jeunesse, la volonté de changement et l’appui sur le monde du travail. Les deux principaux opposants au Général misent sur la jeunesse et la modernité. Dans sa « profession de foi », Jean Lecanuet insiste sur la volonté de « moderniser la France » ; affirmant que « le pays rejette le passé, mais le présent l’inquiète. Il attend une volonté jeune, franche et constructive ». Le slogan de campagne de leur adversaire SFIO (ancêtre du PS) lors du deuxième tour résume l’alternative : « François Mitterrand, un Président jeune pour une France moderne ». La campagne du second tour ignore le travail. Elle est axée sur l’armement nucléaire et sur les relations internationales et en particulier l’Europe – il fut un temps où les politiques parlaient d’Europe pour intéresser les citoyens…
1974 : « Changer la vie »
 L’Union de la gauche, stratégie poursuivie par François Mitterrand depuis le début des années 1960, se concrétise en 1972 avec l’adoption d’un programme commun de gouvernement par le Parti socialiste, le Parti communiste, et le Mouvement des radicaux de gauche, portant notamment sur les nationalisations, la réduction du temps de travail et la démocratie sociale. La forte ambition de modernisation des rapports de travail est cependant diluée dans un vaste ensemble bien résumé par le slogan « Changer la vie », titre donné au programme du Parti socialiste adopté en 1972.
L’Union de la gauche, stratégie poursuivie par François Mitterrand depuis le début des années 1960, se concrétise en 1972 avec l’adoption d’un programme commun de gouvernement par le Parti socialiste, le Parti communiste, et le Mouvement des radicaux de gauche, portant notamment sur les nationalisations, la réduction du temps de travail et la démocratie sociale. La forte ambition de modernisation des rapports de travail est cependant diluée dans un vaste ensemble bien résumé par le slogan « Changer la vie », titre donné au programme du Parti socialiste adopté en 1972.
Pour la première fois, le 10 mai 1974, les candidats du second tour de l’élection présidentielle, Valéry Giscard d’Estaing et François Mitterrand, acceptent de se confronter verbalement dans un débat télévisé, selon une tradition bien établie aux États-Unis. La thématique du travail est presque absente de ce débat, mais perce cependant sous une réplique restée célèbre, celle prononcée par Giscard d’Estaing disant à Mitterrand : « Je trouve toujours choquant et blessant de s’arroger le monopole du cœur. Vous n’avez pas, Monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. J’ai un cœur comme le vôtre qui bat à sa cadence et qui est le mien et ne parlez pas aux Français de cette façon, si blessante pour les autres… ». On ne s’arroge pas la légitimité de représenter le monde du travail sans incarner davantage ses valeurs.
1981 : « Les forces du travail »
 Une fois de plus, la thématique du travail est masquée par celle de l’emploi. Sur ce plan, le bilan du septennat de Valéry Giscard d’Estaing apparaît comme très faible : 1.660.000 demandeurs d’emploi en 1980, soit 7,3 % de la population active et quatre fois plus que sept ans auparavant. Sur le plan économique et social, la présidence VGE est demeurée très concentrée sur la politique macro-économique de lutte contre l’inflation, incarnée par la nomination de Raymond Barre en remplacement de Jacques Chirac, en août 1976.
Une fois de plus, la thématique du travail est masquée par celle de l’emploi. Sur ce plan, le bilan du septennat de Valéry Giscard d’Estaing apparaît comme très faible : 1.660.000 demandeurs d’emploi en 1980, soit 7,3 % de la population active et quatre fois plus que sept ans auparavant. Sur le plan économique et social, la présidence VGE est demeurée très concentrée sur la politique macro-économique de lutte contre l’inflation, incarnée par la nomination de Raymond Barre en remplacement de Jacques Chirac, en août 1976.
La question de la gouvernance du travail, qui avait soulevé les espoirs des progressistes, s’est progressivement éteinte. Dès 1972, Antoine Riboud, le patron de BSN (futur Danone), affirmait, dans un rapport présenté aux Assises du CNPF (futur Medef) à Marseille, qu’il fallait en finir avec les méthodes autoritaristes et reconnaître le rôle actif que jouent les salariés. En 1975, le rapport Sudreau (député-maire de Blois et ancien ministre) sur « La réforme de l’entreprise » (Documentation Française et Éditions 10/18) proposait de créer une nouvelle voie de participation, la « co-surveillance », au-delà du rôle consultatif du Comité d’entreprise, pour un véritable « droit de chacun à s’exprimer sur son propre travail ». Mais le projet de grande réforme de l’entreprise visant à améliorer les rapports entre patrons et salariés est abandonné. C’est la gauche qui reprend cette thématique durant la campagne électorale, qui se traduira, après l’élection, par le rapport de Jean Auroux sur « Les droits des travailleurs » (La documentation française, septembre 1981), qui mettait en avant le droit d’expression des salariés, puis par les trois lois que le nouveau ministre du Travail fera voter l’année suivante.
Pour sa troisième tentative à un scrutin présidentiel, François Mitterrand se situe directement dans le combat du second tour, et dresse un bilan très critique de la présidence de Valéry Giscard d’Estaing, chiffres à l’appui : « Quand j’entends dire que le désordre, ce sont les socialistes… Qu’appelle-t-on désordre, sinon 1.700.000 chômeurs, 100.000 entreprises industrielles et commerciales détruites, 100.000 exploitations agricoles disparues ? ». Sur l’emploi, le candidat socialiste s’engage : « C’est la première de nos obligations, j’y consacrerai toute ma volonté ». Il avance le chiffre de 210.000 emplois créés par an, dont 150.000 dans les services publics. Mais les propositions de François Mitterrand pour venir à bout de la crise économique ne s’éloignent guère des recettes classiques de la gauche des années 1980 : relance par la consommation, réduction du temps de travail, grands travaux, nationalisations, emprunt national pour investir dans l’industrie. Ces mesures forment l’essentiel du volet économique et social des « 110 propositions », publiées dans un Manifeste du PS, présenté au Congrès de Créteil le 24 janvier 1981.
Comme le PS, le Parti communiste a quantifié le nombre de ses promesses ; il y en a 131. Sur l’emploi, Georges Marchais est le candidat le « mieux-disant ». Affirmant avec aplomb que « le chômage ? On peut l’éliminer complètement », il promet la création de 1.500.000 emplois, dont 200.000 dans les services publics et 1.000.000 grâce à la réduction du temps de travail, qui s’impose comme la mesure phare de la gauche unie.
Cette campagne marque également l’avènement électoral de l’écologie, brillamment portée par Brice Lalonde. Celui-ci met en avant le « pouvoir de vivre », qui nécessite une réorientation du progrès « pour construire une société fondée sur le respect de l’être humain et de la nature, sur le temps de vivre, sur les relations personnelles, sur la sauvegarde de la santé et du cadre de vie ». Nous ne sommes pas encore au temps des « décroissants », mais la valeur travail en tant que pierre angulaire de l’organisation sociale en sort écornée.
Entre les deux tours, qui opposent les mêmes finalistes que sept ans plus tôt, le slogan de François Mitterrand, « Changer la vie » se transforme en « La force tranquille », sur fond de paysage typique et assoupi de la campagne française, montrant la délicieuse petite église de Sermages dans le Morvan. On en retient la pique adressée par François Mitterrand à son rival, pendant le débat de l’entre deux tours et visant principalement le bilan de ce dernier en matière d’emploi : « Vous ne voulez pas parler du passé, je comprends bien, naturellement et vous avez tendance à reprendre le refrain d’il y a 7 ans « l’homme du passé ». C’est quand même ennuyeux que dans l’intervalle vous soyez devenu l’homme du passif ».
Au soir du 10 mai, François Mitterrand prononce sa déclaration depuis l’hôtel du Vieux-Morvan, à Château-Chinon, dans la circonscription dont il fut longtemps le député : « Cette victoire est d’abord celle des forces de la jeunesse, des forces du travail, des forces de création, des forces du renouveau qui se sont rassemblées dans un grand élan national pour l’emploi, la paix, la liberté, thèmes qui furent ceux de ma campagne présidentielle et qui demeureront ceux de mon septennat. Elle est aussi celle de ces femmes, de ces hommes, humbles militants pénétrés d’idéal, qui, dans chaque commune de France, dans chaque ville, chaque village, toute leur vie, ont espéré ce jour où leur pays viendrait enfin à leur rencontre. À tous je dois et l’honneur et la charge des responsabilités qui désormais m’incombent. Je ne distingue pas entre eux. Ils sont notre peuple et rien d’autre ».
Dans les jours suivant sa prise de fonction, le gouvernement de Pierre Mauroy annonce la hausse du Smic de 10 %, des allocations familiales et des allocations logement de 25 %, du minimum vieillesse de 20 %, la création de 55.000 emplois publics et la mise en route des lois Auroux.
1995 : « La fracture sociale »
 La campagne de 1995 aura surtout laissé le souvenir de l’affrontement à droite, entre les deux « amis de trente ans », le Premier ministre de cohabitation, Edouard Balladur, annonçant sa décision de se présenter le 18 janvier 1995, face à Jacques Chirac, à qui la candidature à la Présidence semblait « réservée » depuis son refus de retourner à Matignon en 1993. Ayant annoncé sa candidature tôt, le 4 novembre 1994, Jacques Chirac résume sa vision politique à travers deux livres programmes parus à quelques mois d’intervalle : « Une nouvelle France, Réflexions 1 » en juin 1994 et « La France pour tous » (qui devient son slogan) en janvier 1995.
La campagne de 1995 aura surtout laissé le souvenir de l’affrontement à droite, entre les deux « amis de trente ans », le Premier ministre de cohabitation, Edouard Balladur, annonçant sa décision de se présenter le 18 janvier 1995, face à Jacques Chirac, à qui la candidature à la Présidence semblait « réservée » depuis son refus de retourner à Matignon en 1993. Ayant annoncé sa candidature tôt, le 4 novembre 1994, Jacques Chirac résume sa vision politique à travers deux livres programmes parus à quelques mois d’intervalle : « Une nouvelle France, Réflexions 1 » en juin 1994 et « La France pour tous » (qui devient son slogan) en janvier 1995.
Mais la surprise – la « triangulation », diront certains – vient plus tard, lorsque Jacques Chirac oriente l’axe de son discours sur la « fracture sociale », expression, dont la paternité revient au philosophe Marcel Gauchet, importée dans le langage du candidat par une de ses « plumes », Henri Guaino. Cette expression s’oppose à la fatalité de la dégradation du travail et de l’emploi, comme pour démentir la phrase que François Mitterrand avait prononcée en 1993 : « Dans la lutte contre le chômage, on a tout essayé ».
La vitesse d’importation du concept de triangulation est frappante. Cette stratégie politique venait d’être théorisée par Dick Morris, conseiller en communication du président américain Bill Clinton en janvier 1995. À l’époque, Clinton était au plus mal : les Républicains venaient de remporter la majorité dans les deux chambres et sa réélection pour un second mandat paraissait très compromise. Dick Morris élabore alors son concept de « triangulation ». Face aux deux camps idéologiquement opposés, les Démocrates et les Républicains, reliés par une barrière infranchissable, il faut passer la barre pour s’approprier une partie des propositions du camp adverse, ce qui permet de tracer une ligne entre les deux, qui forme un triangle, d’un côté les Démocrates, de l’autre les Républicains, et le candidat adepte de la transgression, qui se situe au milieu, mais au-dessus, au sommet du triangle. Clinton a été triomphalement réélu en 1996.
En particulier dans un des discours fondateurs de cette campagne, le 17 février 1995, Jacques Chirac indique que : « La France fut longtemps considérée comme un modèle de mobilité sociale. Certes, tout n’y était pas parfait. Mais elle connaissait un mouvement continu qui allait dans le bon sens. Or, la sécurité économique et la certitude du lendemain sont désormais des privilèges. La jeunesse française exprime son désarroi. Une fracture sociale se creuse dont l’ensemble de la Nation supporte la charge. La « machine France » ne fonctionne plus. Elle ne fonctionne plus pour tous les Français ». Jacques Chirac reprenait à son compte le thème des forces du travail qui avait si bien réussi à Mitterrand en 1981 : le travail n’est pas juste une pénibilité qu’il faut réduire ou partager, c’est aussi un levier d’émancipation.
2002 : « La France d’en bas »
 Antonio Gramsci l’avait exprimé clairement : il n’y a pas de victoire politique possible sans au préalable une victoire culturelle. Il faut d’abord mener la bataille des idées et conquérir l’hégémonie culturelle. La gauche n’a pas investi le terrain du travail, sauf en mode défensif, pour justifier le choix et les résultats des 35 heures mis en œuvre par le Premier ministre Lionel Jospin et sa ministre du Travail Martine Aubry. Elle a laissé la campagne filer dans le carré gagnant du camp opposé : elle a été entièrement dominée par la problématique de la sécurité. Le résultat s’inscrit dans une date qui restera gravée dans les mémoires, celle du 21 avril. La défaite inattendue de Lionel Jospin, Premier ministre sortant, éliminé au premier tour au terme de cinq années de responsabilités gouvernementales plutôt réussies a profondément marqué le pays.
Antonio Gramsci l’avait exprimé clairement : il n’y a pas de victoire politique possible sans au préalable une victoire culturelle. Il faut d’abord mener la bataille des idées et conquérir l’hégémonie culturelle. La gauche n’a pas investi le terrain du travail, sauf en mode défensif, pour justifier le choix et les résultats des 35 heures mis en œuvre par le Premier ministre Lionel Jospin et sa ministre du Travail Martine Aubry. Elle a laissé la campagne filer dans le carré gagnant du camp opposé : elle a été entièrement dominée par la problématique de la sécurité. Le résultat s’inscrit dans une date qui restera gravée dans les mémoires, celle du 21 avril. La défaite inattendue de Lionel Jospin, Premier ministre sortant, éliminé au premier tour au terme de cinq années de responsabilités gouvernementales plutôt réussies a profondément marqué le pays.
De son côté, la droite s’est saisie du thème du travail au sens de l’effort en appuyant sur la formule de « la France d’en bas », qui fleure bon le terroir et dégage un léger fumet de populisme. C’est Jean-Pierre Raffarin, futur Premier ministre du vainqueur Jacques Chirac, qui en revendique la paternité. Il l’a en fait emprunté à Balzac, dans « Les illusions perdues », ce qui n’est pas le pire des héritages, mais comporte une bonne dose d’ironie. Cette nouvelle triangulation était si artificielle que Jean-Pierre Raffarin en plaisantait. Le quotidien Le Monde (27 mai 2003) a relaté la saillie du récent Premier ministre à l’occasion d’un déplacement officiel le 23 mai au Québec devant un parterre de chefs d’entreprises canadiens : « En France, on était sur la voie de la société de loisirs. On était sur le point de perdre l’habitude de travailler tôt. Il y avait un projet de loi qu’on a arrêté à temps. C’était : quand on ne travaillera plus le lendemain des jours de repos, la fatigue sera vaincue ».
Le thème du travail s’est aussi invité dans cette campagne (comme dans les suivantes) par le cortège de plans sociaux et de restructurations d’entreprises, qui pose la question de la pérennité et de la compétitivité de l’outil industriel, de l’adaptation de la main-d’œuvre face aux mutations économiques. Ceci se traduira concrètement dans la Loi de cohésion sociale portée par Jean-Louis Borloo votée en janvier 2005.
2007 : « La France qui se lève tôt »
 Bien avant le démarrage de la campagne de 2007, Nicolas Sarkozy prolonge la triangulation de la France d’en bas par celle qui se lève tôt. Le 6 mars 2005, devant le Conseil national de l’UMP, il déclare : « L’Union pour un Mouvement Populaire souhaite que l’on fasse davantage pour la France qui se lève tôt le matin (…). La France qui n’en peut plus du nivellement, de l’égalitarisme et de l’assistanat, doit être entendue, écoutée et récompensée ». Quelques jours plus tard, il précise cette conception : « la France qui se lève tôt… celle qui paie ses impôts ». Comme l’explique Corinne Lhaïk, dans son excellent article « Comment la droite a braqué la valeur travail » (L’Opinion, 8 décembre 2020), « depuis 2007 et Nicolas Sarkozy avec son « travailler plus pour gagner plus », la droite a investi l’imaginaire du travail, laissant la gauche sans voix alors que cette valeur fait partie de son socle identitaire ».
Bien avant le démarrage de la campagne de 2007, Nicolas Sarkozy prolonge la triangulation de la France d’en bas par celle qui se lève tôt. Le 6 mars 2005, devant le Conseil national de l’UMP, il déclare : « L’Union pour un Mouvement Populaire souhaite que l’on fasse davantage pour la France qui se lève tôt le matin (…). La France qui n’en peut plus du nivellement, de l’égalitarisme et de l’assistanat, doit être entendue, écoutée et récompensée ». Quelques jours plus tard, il précise cette conception : « la France qui se lève tôt… celle qui paie ses impôts ». Comme l’explique Corinne Lhaïk, dans son excellent article « Comment la droite a braqué la valeur travail » (L’Opinion, 8 décembre 2020), « depuis 2007 et Nicolas Sarkozy avec son « travailler plus pour gagner plus », la droite a investi l’imaginaire du travail, laissant la gauche sans voix alors que cette valeur fait partie de son socle identitaire ».
À l’occasion d’un discours intitulé « Notre République » prononcé à Périgueux le 12 octobre 2006, il dit : « Je ne veux pas que ceux qui ne veulent rien faire, que ceux qui ne veulent pas travailler vivent sur le dos ce ceux qui se lèvent tôt et qui travaillent dur ». Et il ajoute juste après – comme souvent chez Nicolas Sarkozy, c’est la juxtaposition des thématiques qui fabrique le sens : « Je ne veux pas que ceux qui fraudent l’assurance chômage, l’assurance maladie, les allocations familiales, ceux qui escroquent le fisc ou les ASSEDIC, ceux qui détournent de l’argent public par copinage ou par favoritisme, continuent à mettre en péril la solidarité nationale. Parce que cela renforce la crise morale et la défiance vis-à-vis de ceux qui sont vraiment dans le besoin ». Le 18 décembre 2006, dans son discours de Charleville-Mézières, il valorise encore « la France qui croit au mérite et à l’effort, la France dure à la peine, la France dont on ne parle jamais parce qu’elle ne se plaint pas, parce qu’elle ne brûle pas les voitures ».
C’est ici que la triangulation se transforme en mystification. Il ne s’agit plus d’exalter la valeur travail, de célébrer ses vertus émancipatrices et intégratrices. Il s’agit au contraire, de dresser les Français les uns contre les autres, de donner à croire au monde du travail que l’adversaire n’est pas le rentier, les mauvaises conditions de travail, la précarité de l’emploi, mais les plus faibles, les « assistés », qui, bien entendu « ne veulent pas travailler » et que l’on juxtapose avec les fraudeurs, les escrocs et pourquoi pas, les voyous.
Cette mystification est propice aux quiproquos les plus invraisemblables, qui ont émaillé cette campagne. En voici un exemple relaté par le quotidien 20 minutes (2 février 2007) : « en se rendant au marché de Rungis hier matin, Nicolas Sarkozy voulait aller à la rencontre de « la France qui se lève tôt ». Accueilli plutôt chaleureusement, le candidat de l’UMP en est ressorti conforté dans ses convictions de « vouloir libérer le travail (…), qu’il soit enfin récompensé », même si les employés du marché lui ont surtout parlé de pénibilité et de retraite à 55 ans pour les travailleurs de nuit ».
Dans son discours à Meaux, le 13 avril 2007, il questionne : « Que doivent penser ceux qui se lèvent à 5 heures du matin pour prendre un bus et aller travailler quand leurs impôts financent les vacances et la carte orange de ceux qui ne travaillent pas ? Ce qui mine la société française, ce n’est pas l’élitisme, c’est l’égalitarisme, le nivellement, l’assistanat, le sentiment que, quel que soit le mal qu’on se donne, de toute façon ça ne servira à rien parce que tout le monde s’en moque ». Le mythe des hordes de Français oisifs, qui refusent volontairement de travailler est martelé comme un slogan moisi.
La jonction avec la politique macro-économique s’opère par le biais des heures supplémentaires. Nicolas Sarkozy (mais aussi François Bayrou et Philippe de Villiers, eux aussi candidats) dénonce la lourdeur des charges et préconisent l’exonération ou l’allègement des charges sur les heures supplémentaires afin que les salariés puissent « Travailler plus pour gagner plus ». Dans la bouche de Nicolas Sarkozy, ce slogan symbolise la volonté du candidat de critiquer les 35 heures instituées par le gouvernement socialiste quelques années plus tôt, qui visaient à un partage du temps de travail. En matière syndicale, Nicolas Sarkozy se prononce pour qu’en cas de conflit dans les huit jours soit organisé un vote des salariés à bulletin secret et propose de modifier la législation du droit de grève afin notamment d’instituer un service minimum dans les transports publics.
Ce détournement de la valeur travail s’est opéré d’autant plus facilement que le camp d’en face n’y opposait qu’une certaine vacuité. Ségolène Royal, son opposante du second tour, accréditait la nécessité de réduire le coût du travail et proposait de transférer les cotisations maladie et famille sur la fiscalité – ce que l’on appellera plus tard, la « TVA sociale ». Elle se prononce pour une augmentation du SMIC et insiste sur le fait que « personne ne doit être payé à ne rien faire ». Elle affirme que les 35 heures ont été un progrès pour une majorité de salariés, mais une régression pour d’autres. Le deuxième chapitre du livre édité sur son site Internet, intitulé « Les désordres du travail », développe cette idée, s’inspirant notamment des travaux de La République des idées et plus particulièrement d’un excellent livre de Philippe Askenazy, « Les désordres du travail – Enquête sur le nouveau productivisme » (Le Seuil), paru en 2005.
Ségolène Royal se prononce contre le principe même d’« immigration choisie » voulue par Nicolas Sarkozy, estimant « insupportable » que la France aille « piller la matière grise de ces pays après avoir pillé pendant des années et des années leurs matières premières en tant que pays colonisé » et prône l’aide au développement accordée par les pays riches aux pays en voie de développement.
Revenant à une conception doloriste et rédemptrice du travail, elle propose en juin 2006, de placer « dans un service à encadrement militaire à vocation humanitaire ou pour apprendre un métier » les mineurs de plus de 16 ans dès « le premier acte de délinquance ». À l’occasion de la campagne pour l’investiture socialiste à l’automne 2006 elle avait déjà insisté sur le fait que toutes les alternatives à la prison doivent être développées et que des camps humanitaires encadrés par des militaires peuvent permettre à un mineur délinquant de « reconquérir l’estime de soi ».
Une fois de plus, le cœur de la problématique du travail échappait à la campagne. Pourtant, ce que l’on n’allait pas tarder à appeler « la crise des suicides » — qui était en fait une crise du travail – avait déjà commencé, à EDF, au Technocentre de Renault, à France Télécom. Cette crise n’allait envahir le débat public que plus tard, culminant avec le plan d’urgence annoncé en octobre 2009 par Xavier Darcos, l’un des éphémères ministres du Travail de ce nouveau quinquennat.
2012 : « Le vrai travail »
 Au bout de son quinquennat, Nicolas Sarkozy cherche à rééditer la triangulation victorieuse de 2007, qui lui avait permis de mordre sur l’électorat populaire aujourd’hui tenté par les sirènes frontistes ou celles de l’abstention (voir dans Metis « Quand le FN charme les travailleurs », octobre 2016). Cette réédition se marque jusqu’à la caricature, allant jusqu’à réinvestir les mêmes lieux de meetings, comme pour y retrouver la « baraka électorale ». Après l’immigration et l’insécurité, il revient sur les questions de pouvoir d’achat et du travail pour séduire à nouveau les catégories populaires.
Au bout de son quinquennat, Nicolas Sarkozy cherche à rééditer la triangulation victorieuse de 2007, qui lui avait permis de mordre sur l’électorat populaire aujourd’hui tenté par les sirènes frontistes ou celles de l’abstention (voir dans Metis « Quand le FN charme les travailleurs », octobre 2016). Cette réédition se marque jusqu’à la caricature, allant jusqu’à réinvestir les mêmes lieux de meetings, comme pour y retrouver la « baraka électorale ». Après l’immigration et l’insécurité, il revient sur les questions de pouvoir d’achat et du travail pour séduire à nouveau les catégories populaires.
Le lieu choisi est symbolique : Charleville-Mézières, une cité ouvrière et sinistrée par la crise, là où le candidat Sarkozy avait parlé en décembre 2006 à « la France qui travaille », là où il avait rendu hommage « aux travailleurs pauvres », à « la France qui souffre et dont on ne parle jamais », là où il avait lancé son slogan « Travailler plus pour gagner plus ».
C’est le lieu qu’il retrouve en avril 2011, mais sans la dynamique originelle. Car cinq ans après, la déception est palpable. Le bouclier fiscal et le début de quinquennat bling-bling sont passés par là, mais aussi l’échec des promesses formulées. Il se contentera d’énoncer une proposition – la prime versée au personnel des entreprises qui versent des dividendes – qui fera flop et de consulter l’air navré, la liste des promesses non tenues en cinq ans (voir par exemple l’exercice de « fact-checking » mené à cette occasion par Le Monde : « Cinq ans après, que reste-t-il du « discours à la France qui souffre » de Nicolas Sarkozy ? », 19 avril 2011).
En février 2012, Nicolas Sarkozy réédite à nouveau en se rendant au marché de Rungis. Cinq ans auparavant, presque jour pour jour, le candidat de l’UMP se déplaçait déjà dans le pavillon de la viande du gigantesque marché pour adresser un signe à « la France qui se lève tôt ».
Cette fois, le camp adverse ne reste pas inerte. En février 2012, à l’occasion d’un meeting dans l’Essonne, François Hollande déclare : « Le travail est une valeur de gauche ; ne laissez pas la droite accaparer cette valeur ». Et de s’interroger : « Où est le respect du travail quand les patrons du CAC 40 s’augmentent de 34% ? » ou encore: « Où est le respect du travail quand les revenus du capital sont moins imposés que ceux du travail ? » (François Hollande : « Le travail est une valeur de gauche », L’Express, 22 février 2012). Dès le début de sa campagne, il avait présenté (janvier 2010) un « pacte productif » reposant sur un diagnostic d’un « défaut de compétitivité structurelle » des entreprises françaises, conduisant au « déclin dont la désindustrialisation est le premier symptôme ». Ses « 60 engagements » traitaient du travail sous différents angles comme la transmission des savoirs (Engagement No 33 sur les contrats de génération) ou la sécurisation des parcours professionnels (No 35), qui donnera lieu à la loi de sécurisation de l’emploi de juin 2013 et à la création du CPA (compte personnel d’activité).
La promotion du dialogue social était l’un des thèmes de campagne essentiels du candidat Hollande, qui a évoqué les partenaires sociaux dans le débat d’entre-deux-tours, au sein de sa célèbre anaphore : « Moi, président de la République, je ferai en sorte que les partenaires sociaux puissent être considérés – aussi bien les organisations professionnelles que les syndicats – et que nous puissions avoir régulièrement des discussions pour savoir ce qui relève de la loi, ce qui relève de la négociation ». Cela constituera un fil rouge de son quinquennat, fortement affirmé en début de parcours (premières Grandes conférences sociales), plus ténu à la fin (loi Travail). Cette thématique s’oppose frontalement au mode de conduite de la réforme prôné par Nicolas Sarkozy, qui après s’être affiché ostensiblement avec la CGT au début de son quinquennat, veut désormais se passer des « corps intermédiaires ».
L’appropriation de la thématique du travail par Nicolas Sarkozy s’est terminée par un fiasco en fin de campagne. Le 1er mai 2012, il opposait aux rassemblements traditionnellement organisés par les syndicats, la notion de « vrai travail », créant une polémique inutile, mais très révélatrice de la façon dont le travail a été compris et traité lors de son quinquennat. Cette malheureuse expression de « vrai travail » ne fut pas seulement le fruit amer d’une vaine polémique de fin de campagne électorale : elle signait l’échec de la politique de l’emploi, mais aussi l’ignorance de la nécessité d’une vraie politique du travail (voir : Martin Richer, « Le « vrai travail » : une journée de fête pour 5 années de défaites », Note de Terra Nova, 3 mai 2012).
2017 : « L’émancipation par le travail »
 Emmanuel Macron fait plus que de la triangulation sur les frontières entre les camps ; il fait tout simplement éclater lesdites frontières. Il a pris à la gauche de gouvernement la valeur émancipatrice du travail, qu’elle a laissé s’étioler. Et il a pris à la droite la valeur instrumentale du travail, le « gagner plus ». Cette combinaison permettra de réaliser ce que les commentateurs appelleront « le hold-up » ou « le casse du siècle ».
Emmanuel Macron fait plus que de la triangulation sur les frontières entre les camps ; il fait tout simplement éclater lesdites frontières. Il a pris à la gauche de gouvernement la valeur émancipatrice du travail, qu’elle a laissé s’étioler. Et il a pris à la droite la valeur instrumentale du travail, le « gagner plus ». Cette combinaison permettra de réaliser ce que les commentateurs appelleront « le hold-up » ou « le casse du siècle ».
Sylvain Fort, qui a longtemps été la « plume » d’E. Macron à l’Élysée, donne une clef dans sa tribune publiée par L’Express du 18 novembre 2021 intitulée, « Le travail, ce trésor perdu de la gauche ». Selon lui, Nicolas Sarkozy s’est avisé le premier de l’abandon du travail par la gauche. « Et la gauche ne s’est rendu compte de rien ! Jusqu’a aujourd’hui, personne à gauche n’a su où récupérer le Graal que désormais se partagent Emmanuel Macron, « candidat du travail » en 2017 et les Républicains ».
Lors de sa campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait sonné la charge en proclamant « mon ennemi c’est l’assignation à résidence » (mars 2017). Il paraphrasait le fameux slogan que son ancien mentor, François Hollande, avait prononcé lors de son meeting du Bourget lors de la primaire de l’élection présidentielle précédente, « Mon ennemi, c’est la finance ». Dans le viseur de l’ancien ministre de l’Économie, cette absence de mobilité qui scelle le destin des jeunes nés au mauvais endroit. Il s’agissait d’aider « les gens qui sont bloqués dans leur situation », changer « le regard qui cantonne les gens à leur quartier, leur famille, » explique-t-il, présentant alors son « projet d’émancipation » lors d’un déplacement à Saint-Denis.
Les lecteurs de son livre-programme (Emmanuel Macron, « Révolution », XO Editions, novembre 2016) n’étaient pas surpris. Voici ce qu’il écrivait : « Je ne crois pas aux discours sur « la fin du travail ». (…) Nos règles actuelles ne répondent plus aux défis contemporains. Elles favorisent les insiders, c’est-à-dire ceux qui sont dans l’emploi et plus protégés que d’autres, aux dépens des outsiders, c’est-à-dire les plus jeunes, les moins bien formés, les plus fragiles. C’est cela qui fait que notre modèle social est devenu à la fois injuste et inefficace : il favorise les statuts et paralyse la mobilité. (…) Pour certains, il est plus facile de trouver un client qu’un employeur. (…) Je crois au travail comme valeur, comme facteur d’émancipation, comme vecteur de mobilité sociale ».
Que se passait-il à droite ? Notre collègue et ami Wenceslas Baudrillart, que la Covid nous a emporté depuis, avait très bien montré la pauvreté de la réflexion des candidats de droite sur la question du travail. Parmi les candidats engagés dans la primaire de la droite et du centre, seule Nathalie Kosciusko-Morizet semblait avoir aperçu quelques vaguelettes de la profonde mutation qui affecte le travail avec l’extension du numérique (voir dans Metis, « Emploi et travail : les propositions des candidats à la primaire », octobre 2016).
Quant à la gauche, elle ne semble guère plus affûtée. Le Président sortant, François Hollande, pour la première fois dans l’histoire de la Vème République, a indexé sa candidature à un éventuel second mandat sur l’efficacité de sa politique en matière d’emploi. Beaucoup le lui ont reproché. Quelques-uns remarquent que c’est une façon de rendre du poids à la parole politique. Il ne se représentera pas, fait unique dans l’histoire de la Vème République. La gauche se livre au terme d’une primaire délétère en 2016, à Benoît Hamon, qui prônait le revenu universel, c’est-à-dire selon les termes de Jeremy Rifkin, « la fin du travail ». Il finira à 6 %.
L’espace était libre pour l’émancipation par le travail, thématique poussée par Emmanuel Macron. Les deux banques de la ville avaient laissé la porte des coffres bien ouverte.
2022 : « Le pouvoir d’achat »
Comme le fait remarquer le perspicace Marc Landré dans son article « Présidentielle 2022 : le candidat Macron place le travail au cœur de son projet » (Le Figaro, 18 mars 2022, page 4), « s’il y a un domaine sur lequel Emmanuel Macron a insisté lors de la présentation de son programme, c’est bien le travail, mot cité 62 fois durant son heure et demie de propos liminaire ». Présenté comme une valeur cardinale de son projet, le travail est l’une des « conditions de notre indépendance » afin de « renforcer notre croissance potentielle » et ainsi financer les transformations nécessaires pour faire de la France « une nation plus indépendante ».
Déjà lors de son intervention télévisée du 8 novembre 2021, le président de la République avait fait du travail l’axe majeur de son projet. « Emmanuel Macron met la “valeur travail” au centre de son action », » titrait Le Monde (Bertrand Bissuel) et « il a entonné une ode à la valeur travail » (Olivier Faye et Alexandre Lemarié, « Emmanuel Macron continue de miner la droite », Le Monde, novembre 2021). De son côté, Sud Ouest titrait : « 2022 : Emmanuel Macron et la “martingale du travail” » (Jefferson Desport, Sud Ouest, 14 novembre 2021). La droite de gouvernement s’est trouvée dessaisie, une fois de plus de ce qu’elle considère depuis N. Sarkozy comme sa chasse gardée. Au lendemain de cette allocution télévisée d’Emmanuel Macron, Valérie Pécresse prétendait qu’il avait effectué un hold-up sur les idées de la droite, au motif qu’il avait, à de multiples reprises, mis en avant le travail (Le Figaro, 10 novembre 2021).
Le président de la République, pas encore candidat, se laisse même aller à positionner toutes ses mesures sous l’emblème du travail, comme en témoigne cet extrait du texte qu’il a adressé à l’hebdomadaire Challenges en réponse aux attentes de dix mille Français, représentatifs de la population, interrogés par Challenges et Harris Interactive sur leur état d’esprit, leurs valeurs, leurs difficultés : « Lucidité encore sur la centralité du travail : les Français qui, pour la plupart, disent aimer leur emploi savent majoritairement que nous devrons travailler plus longtemps pour rembourser la dette ou pour financer de nouveaux droits comme l’accompagnement des personnes âgées dépendantes. (…) Voilà pourquoi, après avoir fait en sorte que le travail paie davantage en supprimant des cotisations, augmentant le SMIC et baissant les impôts, après avoir réformé dès l’été 2017 la fiscalité de l’investissement et du capital, nous avons engagé pour le 1er janvier une baisse sans précédent des impôts de production » (« Emmanuel Macron : Un peuple lucide se dévoile », Challenges, 2 septembre 2021).
Mais en délaissant la valeur émancipatrice du travail, E. Macron a commis l’erreur de réduire son terrain à la valeur instrumentale, là où sa concurrente frontiste laboure depuis des années. Le travail est ainsi presque réduit à un rôle de levier de pouvoir d’achat. « Le paradoxe le plus désolant de cette campagne est de voir une Marine Le Pen surfer sur la priorité des thèmes sociaux et installer l’idée quelle est la candidate du pouvoir d’achat et des classes populaires. Funeste illusion, » écrivait Paul Quinio dans son éditorial du quotidien Libération, à la veille du premier tour (Libération, 9 avril 2022).
Se trouver face à elle pour le second tour est un terrible échec pour Emmanuel Macron, qui avait promis, lors de son discours d’investiture au Louvre en 2017, de réduire à néant le vote d’extrême droite. Son programme « ni de droite ni de gauche » qu’il a dévoilé lors d’une conférence de presse fleuve le 17 mars 2022, ne contient rien de disruptif ni d’attractif vis-à-vis du travail. Après le meeting de la Défense, le candidat Macron poursuivra une campagne chaotique sans annoncer de nouvelles mesures, à part la proportionnelle intégrale pour les élections législatives annoncée le 18 mars à Pau et l’indexation des pensions de retraite sur l’inflation dès l’été, annoncée à la veille de la fin de la campagne du premier tour, clin d’œil à une catégorie de population qui persiste à ne pas s’abstenir. Le chef de l’État a mené une campagne-éclair de 38 jours sur fond de gestion de crise du Covid et de guerre en Ukraine. Il a présidé « jusqu’au dernier quart d’heure », comme il s’y était engagé.
Il se trouve donc enfermé dans le terrain de Le Pen dont le programme est très axé sur le pouvoir d’achat et repose sur des mesures simples, voire simplistes, à base de baisse drastique des taux de TVA, au risque de tarir les ressources des finances publiques, et de blocage des prix, qui créerait inéluctablement des pénuries. Depuis la « dédiabolisation » de 2017, Marine Le Pen a constamment édulcoré toutes les aspérités de son idéologie d’extrême droite pour en faire une sorte de synthèse qui n’effraie plus personne, une synthèse molle pour reprendre l’adjectif dont l’a qualifié le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin lors d’un débat télévisé, comme pour mieux cacher son programme anti-immigration et anti-Europe. Selon une étude de Gilles Ivaldi, politologue au CEVIPOF, 66 % des mesures au sein du programme de Marine Le Pen améliorent la redistribution des richesses, contre 43 % lors de l’élection de 2017.
Sur la question du pouvoir d’achat, Emmanuel Macron est en terrain difficile. Les faits lui donnent raison, mais le ressenti (comme on dit en météo) lui donne tort. Le pouvoir d’achat par unité de consommation a augmenté en cumul de 6 % en France entre début 2017 et fin 2021, contre 3 % en Allemagne, Italie et Grande-Bretagne. Mais les Français ne le ressentent pas ainsi. Interrogés sur les succès et les échecs d’Emmanuel Macron durant son quinquennat, ils ne sont que 22 % à juger son action positive sur le pouvoir d’achat, d’après l’enquête de l’IFOP publiée par Le Journal du Dimanche du 20 février 2022. Avec la maîtrise de l’immigration et de la dette publique, cet aspect fait partie des trois sujets sur lesquels Emmanuel Macron est le plus mal évalué par les Français. Interrogés sur leur propre sort, 69 % des Français considèrent que leur pouvoir d’achat a diminué et 75 % pensent que c’est le cas pour l’ensemble des Français. Ils ne sont respectivement que 13 et 12 % à penser le contraire. Le thème du pouvoir d’achat arrive en seconde position dans les déterminants du vote, après le sujet de la santé, alors que la lutte contre le chômage est reléguée en 8e position.
Si le SMIC n’a jamais reçu de coup de pouce durant le quinquennat, certains dispositifs, comme le minimum vieillesse ou la prime d’activité, ont été revalorisés, sous la pression des Gilets jaunes, plus vite que prévu. Quant aux mesures d’urgence liées à la crise économique provoquée par la pandémie, elles figurent parmi les plus généreuses du monde : chômage partiel à volonté, aides ponctuelles aux plus démunis, extension de la « garantie jeune » à défaut d’étendre le revenu de solidarité active (RSA) aux moins de 25 ans.
Dans son programme, E. Macron propose à chaque Français de « mieux vivre de son travail », à travers une myriade de mesures avec effet direct sur leur pouvoir d’achat : multiples mesures pour éviter les hausses de prix de l’énergie et de l’alimentation, triplement de la « prime Macron » sans charge ni impôt d’un montant de 1 000 euros par an ; baisse des charges pour les indépendants ; relèvement à 150 000 euros de l’abattement des droits de succession ; suppression de la redevance télé ou droit à une retraite minimale de 1 100 euros en cas de carrière complète.
À cela s’ajoutent des « marqueurs de gauche », qui sont davantage ancrés dans le sociétal que dans le monde du travail : chantiers sur l’école et la santé, versement des allocations à la source, droit opposable à la garde d’enfants et augmentation de 50 % de l’allocation pour mère seule, protection de l’enfance comme « grand combat », adaptation des logements pour les personnes âgées.
Conclusion
Alors que le travail est engagé dans une transformation particulièrement radicale, avec l’extension du travail indépendant, de la co-activité, des plateformes collaboratives, du travail à distance, il serait paradoxal qu’aucun candidat ne remarque que les Français attendent qu’on leur parle de leur avenir concret et non seulement de pratiques vestimentaires exotiques ou de réformes institutionnelles superfétatoires. Peut-être un candidat plus observateur que les autres pourrait-il aussi remarquer, comme le montre cet article, que la thématique du travail, lorsqu’elle rencontre les préoccupations des Français, est d’une puissance à nulle autre pareille. Le travail, passager clandestin des campagnes présidentielles, caché dans l’ombre de l’emploi, pourrait alors remonter de la cale et s’installer au poste de vigie. Qui sait ?
Mais pour l’heure, notre attention sera concentrée sur la façon dont le travail s’insère (ou non) dans la confrontation entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen pour le second tour de ces élections. Cela fera l’objet d’un article publié dans 15 jours, dans la prochaine livraison de Metis.
Pour aller plus loin
Cet article est une réactualisation des précédents articles de Martin Richer sur le rôle du travail dans les campagnes présidentielles, revus tous les 5 ans (voir dans Metis : « Le travail, passager clandestin des campagnes présidentielles », octobre 2016).







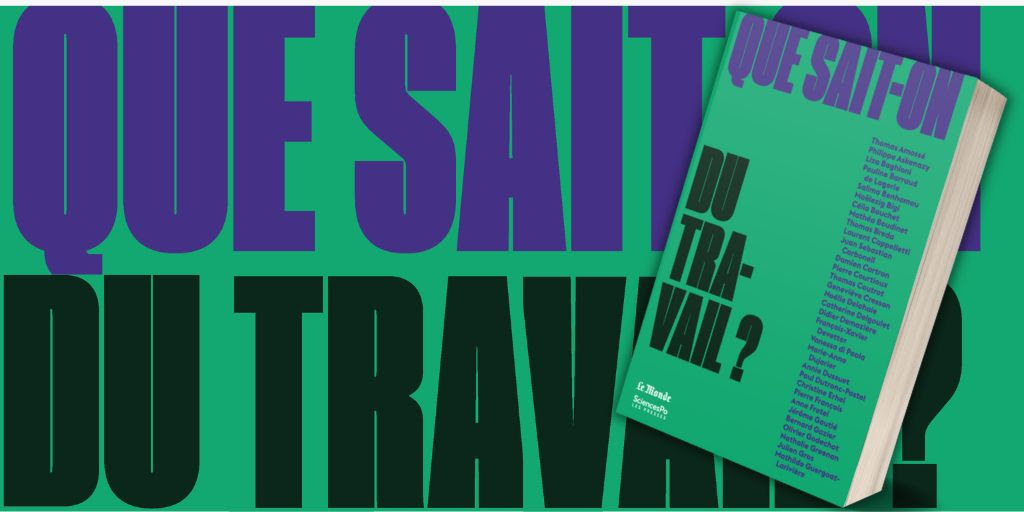

Laisser un commentaire