
Etre un homme politique français qui prétend aux plus hautes destinées passe en France par un exercice (presque obligé) : LE LIVRE qui distingue notre monde politique de ses homologues étrangers qui se contentent des interviews et des discours et ne se privent pas d’ironiser sur nos prurits littéraires. Il arrive que ces ouvrages soient parfaitement ignorés du public, il arrive qu’ils connaissent de vrais succès de librairie. C’est le cas cette année où les ouvrages des principaux candidats de la droite font la fortune de leurs auteurs, de leurs éditeurs et des libraires, sans doute anticipation sur le retour à une société du plein emploi.

Photo de Elodie GREGOIRE/REA pour Capital
Succès conséquence des profondes incertitudes qui tenaillent le corps électoral français et cherche de nouvelles boussoles ou bien succès dû à la puissance des concepts et propositions dans les principaux domaines de notre vie nationale ? Quelle que soit la réponse à cette alternative, nous disposons aujourd’hui d’un corpus intéressant qui balaie l’essentiel des réponses qu’un gouvernement peut apporter aux problèmes de la France d’aujourd’hui. Le travail et l’emploi (ordre non hiérarchisé) occupent évidemment une place importante, voire centrale, dans ces ouvrages. Pour Metis, depuis toujours centré sur ces problématiques, il y a là une aubaine qu’il faut saisir en faisant le point sur ce qu’expriment ces auteurs/candidats sur ces sujets. Alors vive les livres politiques, même si lus en série ils sont moins passionnants qu’un traité de socio-ethnologie participative comme L’Amie extraordinaire de la mystérieuse Elena Ferrante.
Sont utilisés ici 5 ouvrages : La France pour la vie et Tout Pour la France de Nicolas Sarkozy (Plon), Faire de François Fillon (Albin Michel), Cinq ans pour l’emploi d’Alain Juppé (JC Lattès), « Ne vous résignez pas » de Bruno Lemaire (Albin Michel). En dehors de ces textes édités, on se réfère aussi à d’autres documents qu’ils ont produits, notamment sur leurs sites Internet souvent plus détaillés que le livre initial, même si tous ne vont pas jusqu’aux 1.012 pages -pas une de moins- de fiches thématiques de B. Le Maire.
Nathalie Kosciusko-Morizet a bien publié un « Nous avons changé de monde » (Albin Michel) mais celui-ci ne se présente pas avec le même objectif programmatique. Quant à son site Internet il présente de grandes orientations en 28 pages dont plus de la moitié sont occupées par des logos, des photos et des titres en immenses majuscules. Ne pas la mentionner davantage ne relève donc pas d’un antiféminisme militant ou, pire, inconscient mais de la différence de production d’écriture. On peut aussi noter que dans des entretiens radiophoniques et autres interventions, elle est la seule à faire une place de choix aux nouvelles garanties à rechercher pour les nouvelles formes d’emploi (travail indépendant, travail à la tâche liés à l’ubérisation…).
Deux modes de présentation s’opposent. N. Sarkozy et F. Fillon exposent leur projet à partir des expériences d’élus et de gouvernement qu’ils ont accumulées. A. Juppé et B. Le Maire le développent à partir de ce que leur ont dit des citoyens aux paroles desquels ils se réfèrent constamment, agriculteurs, jeunes de banlieue, enseignants, infirmières, etc. rencontrés au gré des réunions et des déplacements.
Une vraie communauté de pensée
Sur nos sujets, l’appartenance des quatre candidats à un même parti se justifie pleinement. Ce qui se dégage en premier lieu de leurs textes, c’est leur communauté de pensée. Bien sûr de nombreuses nuances les distinguent, en particulier sur la tonalité de l’écriture où l’on retrouve ce que l’on sait bien de leurs tempéraments : vigoureux, voire virulent chez Nicolas Sarkozy, presque sans aspérité sauf quand ils parlent de l’action de François Hollande chez les trois autres « écrivants » (pour reprendre la distinction de Marcel Aymé entre écrivains, écrivants et écrivassiers). Y a-t-il encore une vraie différence entre la droite et la gauche ? On se souvient que pendant des décennies le mantra de la droite fut qu’il n’y avait plus lieu de les différencier, la croissance des 30 Glorieuses ayant résolu les drames du paupérisme. Aujourd’hui nos quatre candidats l’affirment avec force : ils sont de droite, et droite et gauche ne sont vraiment pas semblables. Et leurs textes montrent clairement qu’il y a convergence sur les diagnostics et les remèdes. Pour résumer d’une manière qui ne surprendra personne, le fond de la pensée est le libéralisme économique, la libéralisation du marché du travail, l’allègement de la fiscalité en tant que moteur du développement de l’emploi. Si les candidats à la primaire organisée par le PS avaient eu le temps ou la capacité eux aussi de produire un livre de programme, il aurait été amusant de mesurer leurs divergences au regard de cette convergence.

Un hymne à l’entreprise
Seule l’entreprise crée de la richesse et de l’emploi et il est inutile de compter sur l’Etat pour cela. Voilà un point absolument commun à tous. Truisme, peut-être. Mais sur quel substrat les entreprises peuvent-elles prospérer, sur quelle sécurité publique, sur quelles infrastructures matérielles et intellectuelles ? Ces sujets sont naturellement abordés dans d’autres chapitres de ces ouvrages mais sans jamais être mis en relation avec le besoin de l’entreprise de disposer d’un environnement qui -chez nous encore aujourd’hui- échappe largement aux logiques de la privatisation et de la relation marchande.
Ce concept d’entreprise, brandi avec tant d’insistance, est lui-même curieusement désincarné. L’entrepreneur n’apparaît pas -si ce n’est à l’évocation de la fiscalité qui doit lui laisser le juste retour de son effort. Il n’est pas fait de distinction entre la très grande entreprise aux racines ou aux branches multinationales et la PME ou la TPE. Manque même dans cet hymne le couplet traditionnel « On sait bien qu’aujourd’hui c’est dans les PME que se créent les emplois ». Il n’est fait nulle mention de la consistance de cette communauté humaine que constituent les salariés, des tensions et des convergences qui la traversent, des conditions qui favorisent la création et la persistance d’un climat de travail favorable à son développement.
Si les entreprises ne sont pas assez aimées, la responsabilité en repose principalement sur la gauche, partis et syndicats unis dans une même défiance. Mais elle vient aussi des gouvernements de droite qui n’ont pas su désamorcer la culture de la défiance qui imprègne les administrations et ont accepté l’inflation de normes et de contrôles qui ralentissent, non : qui paralysent l’innovation en France. En témoignent notamment les programmes de contrats aidés qui sont massivement tournés vers les collectivités publiques et le secteur associatif et qui, lorsqu’ils bénéficient aux entreprises, ne le font qu’avec des montants fortement réduits par rapport au secteur non marchand.
Se débarrasser enfin des 35 heures
Pourquoi commencer par ce paramètre ? Parce que c’est là que les formules convergent le plus et là qu’elles sont exprimées avec le plus de vigueur. Voilà des années que la droite a fait du discours contre la réduction du temps de travail et très précisément contre « Les 35 heures » le marqueur dominant de son discours sur le travail, en particulier dans leur version Jospin-Aubry parce qu’il est parfois fait mention du contraste entre leur approche autoritaire avec celle, fondée sur le volontariat, de Gilles de Robien en son temps. (Voir mon article, Metis, » Le roman des 35 heures « ) Symbole de la gauche bisounours ou bobo ou irresponsable, les 35 heures doivent être abolies et les actes de contrition pour ne pas l’avoir fait dès 2012 pleuvent sans que personne ne réponde à la question « Pourquoi ne l’avons-nous pas fait ? » En quoi les 35 heures sont-elles criminelles ?
Elles témoignent d’abord d’une vision malthusienne de l’économie : elles révèlent que leurs auteurs ne croient plus au développement économique, qu’ils sont convaincus que « la taille du gâteau » ne saurait être agrandie et qu’en conséquence il faut le découper différemment pour que chacun puisse en espérer quelques miettes. S’appuyant sur un discours qui valorise un nouvel équilibre entre temps de travail et temps consacré à la famille, au loisir, au développement personnel elles « tuent » la valeur et le sens du travail. A les lire tous les quatre, on a le sentiment qu’avant 1999 les Français baignaient dans le bonheur d’une addiction généralisée au travail et que l’institution des 35 heures les a fait basculer dans une négation non moins généralisée de la valeur du travail. Nulle mention n’est faite de ce vaste mouvement séculaire de réduction de la durée du travail sous ses différentes formes, durée quotidienne et hebdomadaire, congés payés régulièrement allongés, abaissement de l’âge de la retraite – jusqu’à ce que la prise de conscience des enjeux liés à l’allongement de l’espérance de vie et de l’espérance de vie en bonne santé conjuguée à une natalité faible en dépit des cocoricos ne conduise à renverser la perspective. Quand le partage du travail est évoqué, c’est pour le démonétiser en tant que destructeur de l’emploi sinon dans l’immédiat du moins dans la durée et en tant que destructeur du travail comme fondement de la vie en société. A partir de cette prémisse, les propositions de substitution divergent. Elles sont à relier à la vision de la réforme du code du travail sur laquelle on reviendra plus loin.
Il y a les 35 heures en entreprise et les 35 heures dans les administrations. Dans les administrations les quatre s’accordent pour faire passer le temps de travail à 39 heures et, de manière paradoxale, pour permettre la réduction des effectifs sans dégrader les prestations servies aux administrés. Car si la réduction du temps de travail ne permet pas de créer de l’emploi, l’augmentation de sa durée permet en revanche d’en supprimer. C’est ainsi que pourront -avec bien d’autres mesures- être atteints les objectifs de diminution du nombre de fonctionnaires aussi bien d’Etat que territoriaux, la fonction publique hospitalière pouvant être préservée de ce vaste mouvement -sauf bien entendu à accompagner la diminution du nombre d’hôpitaux publics permis par le développement de la médecine ambulatoire et par une meilleure prise en charge des affections lourdes par la médecine libérale dont la condition devra naturellement être améliorée. Y aurait-il négociations pour accompagner ce changement, comment la pyramide des comités techniques paritaires sera-t-elle impliquée ? ? Silence généralisé, sauf la brève mention par A. Juppé de négociations sur les missions, la durée du travail, l’organisation et les effectifs.
Il y a les 35 heures dans les entreprises. Là on constate des nuances. La vision maximaliste indique que la seule mention légale sera celle des prescriptions européennes sur les durées hebdomadaire et quotidienne maximales. Tout le reste sera renvoyé à la négociation de branche et, de préférence, d’entreprise. Si les syndicats, tellement minoritaires qu’ils ne survivent que grâce à leur politisation, refusent d’adopter une attitude responsable, constructive, le referendum d’entreprise permettra de dépasser leur opposition de principe, les salariés sachant bien quel intérêt ils auront à travailler plus en gagnant plus. La vision moyenne choisit de fixer une nouvelle durée légale à 39 heures qui deviendront le seuil de déclenchement des heures supplémentaires donnant lieu à majoration et à défiscalisation. A moins que là aussi des accords d’entreprise n’y dérogent pour permettre de préserver la compétitivité de leur entreprise confrontée à une concurrence de plus en plus féroce et que le seuil des heures supplémentaires ne soit relevé ou leur taux de majoration diminué. Enfin une troisième voie est possible : la disparition de la notion de durée légale -sous réserve des dispositions européennes et heures hebdomadaires. L’accord d’entreprise seul fixera le seuil à 36, 37, 38 ou 39 heures. Il y a un risque : ce nouveau seuil risque de pénaliser ceux qui aujourd’hui perçoivent de façon habituelle un salaire majoré dès la trente-sixième heure. Une exonération d’impôt sur le revenu et de cotisations salariales leur permettra de ne rien perdre.

Le retour au plein emploi
La valeur du travail ayant été restaurée dans les esprits par l’abolition des 35 heures, il convient de donner à chacun la possibilité de vivre ce travail et de vivre de ce travail. Donc l’objectif est de « REVENIR AU PLEIN EMPLOI », c’est-à-dire en ne conservant que le chômage frictionnel, soit un taux de chômage de 5% environ. Et chacun de citer la phrase de François Mitterrand en 1993 : « Dans la lutte contre le chômage, on a tout essayé. » Oui, on a tout essayé, sauf ce qui marche comme le montre d’autres pays, Allemagne, Etats-Unis, Grande-Bretagne.
On a réduit le temps de travail avec les conséquences que l’on sait. On a dépensé des milliards pour des contrats aidés dont tout le monde connaît les limites. On a une indemnisation du chômage anti-incitative à la reprise du travail. On a un système de formation des adultes qui combine gabegie et inefficacité. On a un code du travail qui décourage l’embauche. La fiscalité détruit nos entreprises en stérilisant les capacités d’investissement. Pôle Emploi a fait la preuve de son incapacité et personne ne dit rien. En agissant sur tous ces paramètres à la fois, on reviendra au plein emploi.
Naturellement ces comparaisons internationales n’ont qu’une portée limitée. On ne s’appesantit pas sur la démographie allemande. On ne s’appesantit pas sur le taux d’activité étasunien. On ne mentionne pas le retrait des bénéficiaires d’allocations sociales du décompte des chômeurs en Grande-Bretagne.
Il est fait mention du fait que l’emploi d’aujourd’hui n’est pas celui d’hier. La stabilité de l’entreprise, la stabilité du métier, la stabilité dans le métier sont effectivement dépassée. Le mouvement vers l’auto entrepreneuriat est vu aussi bien comme une nouvelle vision positive du travail dans une société plus mobile que comme une compensation à l’impossibilité de retrouver l’emploi stable qui reste le rêve. Les perspectives éventuellement révolutionnaires de la société numérisée pour l’emploi classique ne sont souvent même pas mentionnée (N. Sarkozy) ou alors d’une plume infiniment légère (F. Fillon, B. Le Maire). Seul A. Juppé s’appesantit sur cette dimension mais son optimisme n’en est pas altéré puisque l’ensemble des politiques publiques qu’il prône sera facteur de croissance retrouvée et moteur d’innovations salvatrices. L’hypothèse qu’une société parvenue à notre degré de développement ne puisse peut-être pas connaître les taux de croissance de l’époque où tant de besoins de base n’étaient pas encore couverts n’est pas non plus envisagée.
Il faut mentionner spécifiquement une proposition de B. Le Maire et, poussant plus loin, de N. Sarkozy. Tous deux veulent mettre fin aux statuts généraux des fonctions publiques, sauf dans les fonctions régaliennes. La conception de l’emploi à vie dans une carrière qui progresse doit être abandonnée au profit du contrat de travail. N. Sarkozy se dit même partisan du contrat à durée déterminée généralisé dans les administrations.
L’indemnisation du chômage : abaissée, dégressive, raccourcie, contrôlée
Encore un point de convergence complète entre nos candidats d’un même parti sur les principes, même s’il existe entre eux de vraies nuances sur les modalités. Les principes sont clairs et, peut-on dire, d’évidence. L’indemnisation française du chômage souffre d’un déséquilibre nuisible entre volonté de protection et incitation à reprendre un travail. Elle est ouverte trop généreusement avec des conditions d’ancienneté dans l’emploi insuffisantes qui doivent être allongées. Elle est d’un montant trop élevé et son taux de remplacement doit être abaissé. Sa durée est trop longue si on la combine avec son absence de dégressivité. Sur ce diagnostic tout le monde s’accorde. Ensuite, le curseur ne se pose pas toujours au même emplacement mais c’est de l’ordre du débat sur des modalités. L’écart porte sur les combinaisons entre durée totale et taux de dégressivité. Ce peut être une durée de dix-huit mois avec réduction de 20% après un an. Ce peut aussi être une durée de deux ans avec un an à taux plein et deux paliers de dégressivité de 20% chacun après douze puis dix-huit mois. Manifestement aucun d’eux ni de leurs multiples conseillers n’a eu vent des études de l’OCDE, pourtant peuplée de nombre d’apôtres du libéralisme économique, qui tendent à montrer qu’on ne peut établir aucune relation de dépendance entre durée du chômage et présence ou non d’une dégressivité.
Ceci va de pair avec un renforcement des obligations du chômeur. Un contrôle accru de l’effectivité de sa recherche doit s’exercer. Il n’est pas possible de nier que de la fraude existe, soit perception d’indemnités indues, soit fausse recherche d’emploi. La possibilité de refuser un emploi (mais comment sait-on si le demandeur a refusé un emploi ou s’il s’est fait refuser par cet employeur ?) ou de refuser l’entrée dans une formation, en particulier vers un métier en tension doit être sanctionnée par une dégressivité immédiate ou par une suspension.
Reste la question de la maîtrise du système de décision et de gestion actuel. N. Sarkozy et B. Le Maire ont sur ce sujet les positions les plus radicales en voulant redonner à l’Etat le pouvoir de décider les montants de l’indemnisation. N. Sarkozy a un propos plus général : il veut mettre fin au paritarisme là où il existe parce qu’il aboutit à des « accords de boutiquiers », et donc priver l’UNEDIC de son pouvoir de négociation. B. Le Maire a une autre vision : il veut que l’Etat reprenne la main sur les montants et veut en même temps cantonner Pôle Emploi à la seule gestion de cette indemnisation, le reclassement étant confié à des entreprises et associations spécialisées puisque Pôle Emploi a fait preuve d’une inefficacité croissante.

Réforme de la formation professionnelle : priorité à l’apprentissage et aux conversions des chômeurs
Difficile dans ce domaine de dépasser les considérations de café du commerce sur l’inefficacité ou les gabegies de notre système de formation professionnelle qui « mobilise pourtant près de 30 milliards ». Sauf à déplacer le débat très au-delà de la frontière des adultes pour y intégrer les formations professionnelles initiales. Là aussi il y a consensus pour une transformation de fond : l’ensemble de l’enseignement professionnel doit être placé sous l’autorité des régions (parfois combinée avec celles des branches professionnelles). En même temps cet enseignement doit être totalement transformé par la priorité absolue donnée à l’apprentissage pour lequel il faut se donner pour objectif d’atteindre les effectifs allemands. Les moyens existent : il suffit de transférer les ressources affectées aux contrats aidés (oui, on le sait, cela suscitera des résistances dans les institutions bénéficiaires des contrats actuels) vers les établissements et les employeurs de l’apprentissage, les apprentis devant voir leurs conditions de travail alignées sur celles des salariés de droit commun.
S’agissant des chômeurs, le propos est plus flou et pour les entreprises un peu inquiétant. En effet le flou réside dans la pétition de principe : il faut rendre le système de formation plus efficace. Certes, mais comment ? La réponse manque cruellement. On connaît la situation de ce secteur : d’innombrables organismes de taille réduite, employant des vacataires moins bien payés aujourd’hui qu’il y a dix ans, dans des locaux médiocres avec un matériel dépassé parce que les niveaux et les modalités de rémunération de ces organismes sont trop faibles. Ceci dans une perception commune des administrations intervenantes qui continuent obstinément de parler des organismes comme de « marchands de soupe » et à se gargariser des « formations au macramé » que demanderaient les salariés au titre de la formation continue. L’inquiétude pour les entreprises pourrait venir de la priorité que les candidats veulent donner aux fonds de la formation professionnelle : ils les veulent massivement orientés vers les demandeurs d’emploi, sans jamais mentionner à quel point le besoin de formation en entreprise va croissant du fait des évolutions aussi bien technologiques qu’organisationnelles.
Un code du travail massivement allégé pour un dialogue social « constructif »
Voici des dizaines d’années que les employeurs, enquête d’opinion après enquête, le disent : le code du travail est trop compliqué, il encadre trop, il fait courir des risques imprévisibles, il est donc l’ennemi de l’emploi. Nos quatre auteurs reprennent cette antienne avec enthousiasme. Trois d’entre eux ont pourtant exercé des responsabilités gouvernementales de premier plan et l’on ne se souvient guère de leurs travaux d’allègement de ce code. Au contraire on croit même se souvenir que chacun d’entre eux à efficacement contribué à l’augmentation de sa pagination. Mais cette fois-ci sur la base du principe « Nous disons ce que nous ferons et nous ferons ce que nous aurons dit », le code du travail pourrait connaître une sérieuse cure d’amaigrissement si les électeurs venaient à couronner de succès un de leurs projets. La question est donc « Que va-t-il rester dans ce code light ? »
Les réponses ne sont pas particulièrement éclairantes, et on comprend bien pourquoi : qu’est-ce qui distingue un principe fondamental du droit du travail d’un simple principe ? Parce que la déclaration est celle-ci : le code du travail se concentrera sur les principes fondamentaux du droit du travail qui constitueront un ordre public social auquel il ne sera pas possible de déroger et dont les violations seront sanctionnées pénalement. Le ton martial sur « l’ordre public social » et la « sanction pénale » n’éclaire pas vraiment sur l’étendue de ces principes généraux. Il faut donc s’en contenter et regarder par quel processus on passe d’un code législatif rétréci à l’ensemble des règles qui structurent la vie en entreprise et les relations aussi bien individuelles que collectives entre salarié et employeur. Dans une apostrophe que tous n’ont pas oublié, Martine Aubry avait dit « Là où c’est flou, il y a un loup ». Peut-être est-ce bien le cas ici tant le terrain est dangereux. Si le législateur ne s’érige plus en protecteur de première et dernière instance du salarié quitte à faire son bonheur malgré lui, à quel niveau cette protection se formulera-t-elle et avec quels interlocuteurs. Pour ce qui est du niveau la priorité est nettement marquée : l’entreprise. On retrouve là cette hymne mentionné plus haut. Même lorsque l’intervention de la branche est prévue, l’accord d’entreprise reste prioritaire. C’est dans l’entreprise que se décide concrètement aussi bien l’avenir de l’emploi par une compétitivité maintenue que les conditions de cet emploi en termes de sécurité, de bien-être au travail, de santé au travail. Il est donc normal que ce soit là que s’organise la rencontre des volontés, celle de l’employeur et celle de la collectivité des salariés.
Comment, par quelle voie s’exprime cette collectivité ? Quelle est la place des syndicats dans cette détermination du cadre collectif de l’emploi. Quatre constats : les syndicats sont faibles, les syndicats sont politisés et cette politisation les conduit à développer des visions globales contraires à l’intérêt concret des salariés dans une entreprise donnée. Il faut donc avoir une instance d’appel en cas de blocage syndical : c’est le referendum d’entreprise qui peut intervenir quand l’employeur pour un projet qui améliore ou préserve la compétitivité de son entreprise ne peut obtenir un accord des syndicats de son entreprise. Mais il faut aussi œuvrer à une évolution des syndicats vers un syndicat de participation, constructif, responsable. Plusieurs mesures peuvent y contribuer. Les mandats syndicaux peuvent être limités en nombre d’années. Les mandats syndicaux peuvent ne pas devoir impliquer plus qu’un mi-temps. Le monopole de présentation au premier tour doit être aboli : tout salarié doit pouvoir se présenter dès le premier tour. Les instances de représentation doivent être simplifiées avec la fusion générale des délégués du personnel, comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et comité d’entreprise. Là où il y a comité de groupe européen, il ne doit plus y avoir de comité de groupe national. Et, bien entendu les seuils doivent être relevés.

Une fiscalité allégée, prévisible et incitative à l’investissement
On entend ici fiscalité au sens large, intégrant les cotisations sociales. Le principe de fond est que notre fiscalité directe sur les entreprises et sur les personnes ne doit pas être plus lourde que le niveau moyen d’imposition constaté dans l’Union européenne. Cela représente évidemment un allègement considérable qui rend d’autant plus impérieuse la réduction de la dépense publique, que ce soit pour l’Etat, les collectivités territoriales ou le système de santé. A partir de cet objectif il y a divergence sur le rythme. N. Sarkozy veut la baisse immédiate des prélèvements bien que la baisse de la dépense ne puisse se faire que progressivement, et tant pis pour le déficit budgétaire et son creusement instantané : nos partenaires européens seront tellement convaincus de la volonté française de réforme qu’ils accepteront sans sourciller de déroger au pacte de stabilité (et de croissance). Pour les trois autres auteurs, à des degrés divers, il doit y avoir parallélisme entre ajustement fiscal et ajustement de la dépense. Mais en tout état de cause le début du nouveau quinquennat devrait voir une aggravation temporaire du déficit parce qu’il faudrait d’abord solder les dérives du quinquennat précédent.
Impôt des sociétés allégé, taxation des revenus du capital allégée et redevenue forfaitaire sont les deux mesures de base, celles qu’il est possible de faire adopter sans contestation interne. Mais il faut avoir le courage de prendre une mesure sans doute impopulaire : la suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune. Il faut faire comprendre aux Français qui semblent attachés à ce symbole à quel point l’ISF est destructeur de l’emploi parce qu’il stérilise les ressources qui pourraient être consacrées à l’investissement à la fois par leur prélèvement mais plus pernicieusement par l’incitation qu’il représente à l’expatriation de ceux qui lui seraient assujettis, fortunes établies aussi bien que fortunes en devenir. Plus même que cette suppression, il faut en plus inciter à l’investissement par une défiscalisation des ressources que les particuliers lui consacrent. F. Fillon va jusqu’à citer le chiffre de plus d’un milliard.
Le sentiment de la sécurité pour le futur est à la base de la confiance des investisseurs. La fiscalité doit donc devenir compréhensible grâce à sa simplification par la suppression d’innombrables niches à l’efficacité douteuse. Elle doit surtout devenir prévisible avec des engagements de stabilité des règles et des taux qui peut en particulier passer par la simplification et la généralisation des rescrits fiscaux. Au moment où la France s’indigne quotidiennement des tax ruling du Benelux ou irlandais, cette proposition est sans doute promise à un avenir précaire. Mais elle s’insère dans un propos plus vaste qui porte sur le renversement de la relation administration/administré. L’administration française est animée d’une méfiance structurelle envers le citoyen et en particulier envers l’entreprise. Il en découle contrôles tatillons et irréalistes et normes paralysantes. Il faut opérer un vrai retournement vers une relation de vraie confiance, au moins à l’égard des entreprises et des entrepreneurs parce qu’il ne saurait être question d’un relâchement à l’égard des bénéficiaires de prestations sociales. Ainsi méfiance et principe de précaution seront remplacés par confiance et principe de responsabilité. C’est à ce prix que sera restaurée notre capacité d’innovation et que nous saurons reprendre notre rôle dans la grande compétition de la mondialisation.
En conclusion
Le ton de ce texte peut paraître polémique. Non, ce n’est pas de cela qu’il s’agit. C’est d’abord une analyse de ce qui est écrit, avec la réaffirmation constante d’une ferme volonté de mettre en application ces projets. Mais la lecture de ces livres -dont on salue l’effort que représente leur conception et leur rédaction- laisse sur un sentiment étrange. On s’est concentré ici sur le travail et l’emploi dans leurs lignes essentielles. On aurait pu mentionner la virulence croissante de la tonalité sarkozienne entre son premier et son deuxième ouvrage. On aurait pu citer cette idée sous-jacente, que seul F. Fillon exprime clairement quand il propose la désindexation du Smic, la seule indexation qui vaille étant celle de la compétition mondiale. On aurait pu gloser sur les effectifs de fonctionnaires promis à la disparition, entre 300 et 600.000, sans que soit esquissée la moindre piste de la réorganisation des services publics que cela suppose. Mais ces développements emploi-travail sont à resituer par rapport aux autres chapitres : la sécurité, l’immigration, le système de santé, la protection sociale. Une conception globale de ce que la société française doit devenir s’en dégage qui peut faire peur. Au-delà des formulations compassionnelles obligées sur les plus faibles, elle projette un démantèlement d’un vaste et (sûrement trop) complexe de régulations publiques façonné par nos votes successifs et qui ont à leur tour façonné notre culture sociale commune. Derrière ces batteries d’affirmations et de projections, jamais n’est explicité le cadre macroéconomique et macrosocial sous-jacent. Sauf à invoquer la « réalité » et le « réalisme » auquel il faut se plier.







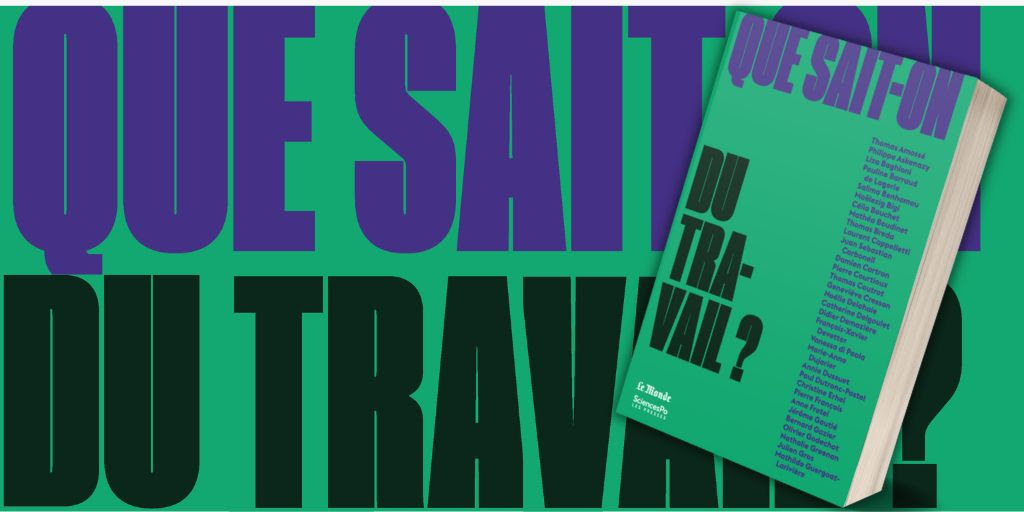

Laisser un commentaire