Suzanne Gorge, propose recueillis par Martin Richer
Responsable du mécénat de Terra Nova et auteure de plusieurs études sur les mutations de la consommation, Suzanne Gorge nous montre que la consommation, ancrée dans les usages et les pratiques sociales, ne change pas aussi vite que nous le pensons… et que nous le souhaiterions.
La crise sanitaire a apporté un changement majeur avec le développement des plateformes de livraison et plus largement du commerce en ligne. Y voyez-vous des menaces ou plutôt un progrès ?
Il est vrai que le e-commerce n’a pas cessé de prendre de l’ampleur, notamment dans les années 2020 et 2021, marquées par plusieurs confinements. De nouveaux acteurs et de nouveaux services sont apparus, comme par exemple les « dark stores », les consignes ou encore les magasins robots, qui se sont multipliés. Un Français reçoit en moyenne un colis par semaine et dans les prochaines années, cela pourrait encore augmenter.
Néanmoins, les estimations de la part du commerce en ligne ont souvent été surévaluées. Lorsqu’on interrogeait les dirigeants de la grande distribution, il y a quelques années, sur l’évolution des canaux de distribution, ils anticipaient 25 % de parts de marché pour le commerce en ligne en 2022[1]. Or, selon la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (FEVAV)[2], sur l’ensemble de l’année 2022, la part du e-commerce dans la vente de produits est estimée à 12,5 % du commerce de détail. Le e-commerce n’a donc que très partiellement remplacé les achats en magasin. La vente par internet devrait continuer de progresser, mais de façon relativement lente, tirée principalement par la vente de services.
Il ne s’agit donc pas d’une transformation brutale et rapide, mais d’une évolution lente des comportements de consommation. Cela me semble bénéfique, car les externalités négatives, sociales et environnementales, induites par le développement du commerce en ligne sont nombreuses. Quelles réponses apporter à la très forte augmentation de l’immobilier logistique, notamment en périphérie des villes ? Comment anticiper l’automatisation des entrepôts et les menaces sur l’emploi non qualifié ? Comment lutter contre la précarisation des emplois avec le développement de plateformes numériques de mise en relation entre clients et livreurs auto-entrepreneurs ? Comment limiter la pollution atmosphérique et les nuisances en ville liées aux véhicules logistiques et notamment aux livraisons du e-commerce ? Les questions sont nombreuses et nous sommes loin d’avoir toutes les réponses…
Y a-t-il d’autres mutations de la consommation qui vous semblent majeures dans les dernières années ?
La grande distribution a été un vecteur d’émancipation des classes moyennes et d’accès à la société d’abondance. S’il y a eu des politiques publiques extrêmement volontaristes (métropoles d’équilibre[3], villes nouvelles), elles trouvent aujourd’hui leurs limites. Les surfaces de vente ont cru plus rapidement que la consommation, et l’équipement commercial est désormais trop important face aux besoins réels de consommation de la population. En conséquence, depuis 2008, des magasins ferment. La vacance des commerces, qui s’est développée à partir de 2010 dans les centres-ville, mais également dans les zones commerciales, est le marqueur de ce système. Dans ce contexte, internet joue un rôle finalement assez faible. Le e-commerce est finalement une faible part des problèmes du secteur qui pâtit d’abord d’une suroffre de ses capacités de vente. Cette « obésité » est constatée dans la plupart des pays industriels qui sont passés par la case société de consommation de masse (Japon, Afrique du Sud, Angleterre, France, États-Unis).
Enfin, la mise en place de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) vise à faire évoluer l’économie linéaire, « produire, consommer, jeter », en une économie circulaire, qui ambitionne non seulement de limiter la production de déchets, mais d’en faire une ressource. Elle vient aussi transformer nos modèles de consommation et a déjà fait changer certaines de nos habitudes quotidiennes.
L’actualité a aussi mis l’accent sur la baisse de la consommation des produits de l’agriculture bio, qui après avoir été multipliée par 3,5 en dix ans représente aujourd’hui 10 % des surfaces agricoles françaises et 19 % de l’emploi agricole. Or, depuis 2021, la consommation baisse et cette tendance se confirme et s’accentue en 2022 et 2023. Vous mettez en avant plusieurs causes possibles. Quelles sont les plus importantes ?
En effet, le bio a perdu 16 % de consommateurs en 2021. Ce chiffre sera plus important en 2022, selon l’Agence Bio. Conséquence de ce ralentissement, certaines filières sont en difficulté, notamment les filières porcine et laitière, parfois forcées d’écouler leur production sur le marché conventionnel par manque de débouchés.
Plusieurs raisons expliquent cette baisse de consommation : La démocratisation du bio, qui avait commencé avec le référencement en grandes et moyennes surfaces de nombreux produits bio, est menacée par un contexte économique tendu, où l’inflation des prix alimentaires a une forte incidence sur le pouvoir d’achat des ménages. L’augmentation des prix de 14,8 % entre février 2022 et février 2023, selon l’INSEE, oblige les consommateurs à faire des choix, singulièrement les plus contraints, parfois au détriment du bio, dont les prix sont en moyenne plus chers. La méconnaissance du label AB et des exigences de son cahier des charges peut également expliquer ce désintérêt pour le bio, fortement concurrencé par d’autres certifications et labels, moins contraignants, mais qui répondent à des besoins sociétaux parfois considérés par les consommateurs comme plus importants (la juste rémunération des agriculteurs par exemple). Le ministère de l’Agriculture et de la souveraineté alimentaire estime ainsi que la cause principale de la baisse de consommation se situe dans « la perte du lien avec les consommateurs ». Enfin, le bio souffre de la concurrence des produits « locaux », qui ne sont aujourd’hui définis par aucun référentiel spécifique.
Ce que le grand public sait moins, c’est que le bio offre des bénéfices environnementaux, sanitaires et économiques conséquents. Pouvez-vous nous les résumer ?
En effet, et tout l’enjeu est d’arriver à mieux valoriser les nombreux bénéfices de l’agriculture biologique :
- Les bénéfices environnementaux : par son cahier des charges exigeant qui exclut l’usage des OGM et qui limite le recours aux intrants, l’AB assure le maintien et l’amélioration de la fertilité des sols, limite l’érosion de ces derniers, conserve une plus grande biodiversité, limite la pollution des nappes phréatiques et permet une plus forte résistance aux aléas climatiques
- Les bénéfices sanitaires : La manipulation des intrants chimiques par les agriculteurs est associée à un risque accru de pathologies (en particulier cancer de la prostate, lymphome et maladie de Parkinson). De plus, des études ont confirmé la présence de résidus de pesticides synthétiques beaucoup plus fréquente et à des doses plus élevées dans les aliments issus d’une agriculture conventionnelle, comparés aux aliments bio[4].
- Les bénéfices économiques : Les filières bio sont moins sensibles à l’inflation que les filières conventionnelles, car moins dépendantes des engrais, et donc du gaz. De plus, elles bénéficient souvent de contrats de long terme qui leur assurent plus de stabilité financière et moins de sensibilité aux marchés. Enfin, grâce au système de rotation pluriannuelle et à la plus grande diversité de cultures, l’agriculture bio est moins impactée par les phénomènes météorologiques extrêmes, conséquences du réchauffement climatique.
Pour toutes ces raisons, l’agriculture biologique doit continuer à se développer.
Mais alors, comment faire pour que le bio brise son image élitiste et devienne accessible à tous ?
La restauration collective publique a un rôle primordial à jouer. Avec chaque année 3 milliards de repas servis dans 80 000 restaurants collectifs (cantines scolaires de la crèche à l’université, hôpitaux, EHPAD, restaurants administratifs…), elle constitue un puissant levier pour rendre accessible le bio. Il faut donc absolument faire respecter la loi Climat et Résilience qui impose 20 % de bio à la cantine !
Si les grandes et moyennes surfaces représentent 50 % du marché bio, la configuration des réseaux de commercialisation du bio engendre encore des inégalités. Sur l’ensemble du territoire, il existe pourtant 26 000 points de vente directe contre 18 000 grandes surfaces. Malgré cela, les circuits courts développés et privilégiés par les agriculteurs bio tels que les marchés de plein vent ou les associations pour le maintien d’une agriculture paysanne (AMAP), limitent l’accès à la consommation des biens qu’ils produisent aux personnes appartenant à des classes sociales aisées et souvent informées.
Comment démocratiser davantage l’accès aux circuits courts ? Les commerçants du quotidien comme les boulangers ou les bouchers peuvent être des intermédiaires ou des relais du drive fermier (le consommateur passe commande en ligne et récupère ses produits auprès d’un intermédiaire).
Une autre option favorable à la démocratisation du bio consiste à soutenir la demande des ménages qui en sont le plus souvent exclus en fléchant le « chèque alimentaire » vers ce type de produits. Issue de la Convention citoyenne pour le climat, cette proposition attend toujours sa mise en œuvre concrète. Pour le moment, le chèque alimentaire s’est résumé au versement d’une prestation en numéraire aux ménages modestes à la rentrée 2022. Un chèque alimentaire ciblé sur ces ménages, mais exclusivement affecté à certains produits alimentaires de qualité — produits frais, de saison et/ou bio, par exemple — pourrait créer de nouveaux débouchés, toucher un public nouveau et éviter la diminution continue du nombre de références bio dans les grandes surfaces. Tout le monde n’a pas accès aux réseaux spécialisés, aux circuits courts notamment dans la périphérie des grands centres urbains et dans les quartiers prioritaires (QPV).
Enfin, pour contrer l’inflation, plusieurs enseignes ont lancé des opérations commerciales en soutien au pouvoir d’achat des Français en limitant la hausse de prix sur les produits du quotidien. Certains produits de première nécessité labellisés bio (sucre, lait, café, biscottes, compotes,…) sont inclus dans ces offres.
Les applications digitales de notation de type Yuka font désormais partie des outils mis à disposition des consommateurs pour les aider à choisir les produits. Quelle est l’évolution de leur diffusion et ont-elles changé la donne chez les distributeurs, chez les industriels et pour les consommateurs ?
Les applications de notation répondent à des demandes fortes et légitimes de consommateurs qui sont de plus en plus soucieux de la qualité sanitaire et nutritionnelle de leur alimentation et de celle qu’ils donnent à leurs enfants. Depuis la création de Yuka, la plus connue, de nombreux dispositifs ont émergé, en réponse à ces nouveaux besoins, que ce soit à l’initiative des distributeurs, des consommateurs, de la puissance publique ou d’ONG.
En quelques années, ces applications ont permis de faire bouger des lignes et de faire évoluer le rapport de force entre consommateurs, distributeurs, industriels (transformateurs) et producteurs. Leur montée en puissance a incité les distributeurs et les industriels à réagir en faisant évoluer leurs recettes, en adoptant le Nutri-score, en développant leurs propres outils de notation, en améliorant la qualité nutritionnelle de leurs produits pour être bien notés ou en collaborant avec les initiateurs de ces nouvelles solutions. C’est une bonne chose, car ça a permis d’inverser, un peu, le rapport de force dans le secteur de l’agroalimentaire, et ce, au bénéfice des consommateurs. Il est essentiel de continuer de les associer à l’amélioration de leur alimentation. Le changement de modèle agricole, qui s’impose à nous, ne pourra se faire sans impliquer largement les consommateurs !
Aujourd’hui, les informations que le consommateur obtient sur le produit après avoir scanné le code-barre sont essentiellement de nature nutritionnelle et sanitaire. Pensez-vous que dans le courant de la RSE, ces applications vont s’élargir aux impacts sociaux et environnementaux de ces produits ?
Plusieurs dispositifs existent. L’ADEME finalise actuellement le futur affichage environnemental. Une phase d’expérimentation de cinq ans est prévue d’ici la fin 2023. L’objectif est d’ajuster le dispositif afin de permettre un déploiement large de l’affichage environnemental dans les années à venir, pour l’ensemble des produits de consommation et services.
Concernant les applications, si l’on veut aller plus loin, il faut favoriser l’extension de ces initiatives à d’autres secteurs de consommation et donner au consommateur une meilleure visibilité de son impact carbone, quel que soit le produit qu’il achète. L’alimentation était un terrain de développement assez naturel pour elles, car elle lie des préoccupations économiques, physiologiques, sanitaires et écologiques. Mais d’autres secteurs pourraient être investis : les produits d’entretien, les équipements électroménagers ou même le prêt-à-porter. Ces extensions appelleront d’autres référentiels et d’autres indicateurs (carbone-score, réparabilité des produits, durée de vie, équité sociale, etc.).
La confiance croissante que portent les consommateurs à ces applications pourrait trouver là un nouveau terrain d’exercice. La révolution digitale a manifestement doté les consommateurs d’un nouveau pouvoir. Pourvu qu’il soit correctement régulé, celui-ci mériterait d’être étendu.
Ces applications doivent-elles continuer à se développer de façon spontanée comme aujourd’hui ou préconisez-vous une régulation ?
Au rythme où il s’est développé ces dernières années, le marché des applications ne tardera pas à approcher une phase de maturité. Le nombre d’applications existantes est en augmentation constante. Même si l’application Yuka reste largement plébiscitée par le public, plusieurs nouveaux autres acteurs s’y sont fait une place. Jusqu’à présent, toutes les applications reposaient sur la même offre de services, et il était difficile de se démarquer autrement que par le graphisme ou l’ergonomie de l’application. Pour se différencier des concurrents et consolider leurs modèles économiques, ces acteurs vont devoir proposer davantage de services de conseils et de coaching personnalisés. Elles se différencieront en permettant au consommateur d’indiquer ses préférences, ses envies, éventuellement ses interdits, et de recevoir ainsi des conseils et des recommandations singularisés.
Cependant, plus le modèle est basé sur des indicateurs physiques et physiologiques personnalisés, plus le risque est élevé pour les consommateurs. Si cela n’est pas a minima contrôlé, des applications de surveillance santé pour les diabétiques ou les personnes allergiques peuvent avoir de vraies incidences sur la santé de leurs utilisateurs. Pour ces raisons, elles devraient être régulées et soumises à des évaluations scientifiquement reconnues, en particulier concernant les recommandations qu’elles adressent à des patients (diabétiques, etc.), lesquelles tangentent une prescription de nature médicale.
Il est également essentiel de connaître le modèle économique de ces applications et de contrôler davantage la manière dont elles gèrent les données personnelles de leurs utilisateurs. Qu’il s’agisse des habitudes alimentaires détaillées des consommateurs, de leurs informations médicales ou de celles liées à leur pratique religieuse, ces données sont personnelles, doivent rester confidentielles et ne peuvent être transmises sans l’accord explicite des individus.
À l’échelle de la France d’une part et de la planète d’autre part, est-il juste de dire qu’on a besoin de l’agriculture industrielle et productiviste pour pouvoir nourrir tout le monde, y compris les plus défavorisés ?
La révolution verte des années 1960 avait pour objectif d’augmenter la productivité de l’agriculture pour répondre aux besoins alimentaires. Ça a été une réussite puisque le volume de consommation a été multiplié par deux et la part du budget des ménages consacrée à l’alimentation est passée de 38 % en 1960 à 17 % en 2019. Mais cela n’a été possible que grâce à une production d’aliments plus standardisés, d’agrandissement des surfaces, de spécialisations régionales et de l’usage massif d’intrants. Les conséquences de ce modèle agricole productiviste sur la biodiversité et la qualité des sols et des eaux ont été négatives.
Des évolutions sont donc nécessaires. Elles concerneront aussi bien le contenu de nos assiettes que les modes de production agricoles et devront garantir l’accès de toutes et tous à une alimentation durable. De toute façon, comme le rappelle Pascal Canfin dans un rapport récent pour Terra Nova[5], avec le réchauffement climatique, à système productif constant, l’ensemble de nos cultures va faire face au cours des prochaines années à des baisses continues de l’ordre de 10-20 % ainsi qu’à des rendements en dents de scie. Il faut donc prendre des mesures rapidement pour limiter l’impact écologique de l’agriculture et rééquilibrer nos régimes alimentaires.
Pour aller plus loin
– Suzanne Gorge, « Les applications de notation, un ingrédient de poids sur le chemin de la transition alimentaire ? », Rapport Terra Nova, 16 décembre 2020
– Suzanne Gorge, « Le bio en baisse : simple ralentissement ou véritable décrochage ? », Note Terra Nova, 15 février 2023
– Suzanne Gorge, « Le bio en crise : quelles solutions pour relancer la demande ? », 4 mars 2023
– Laetitia Dablanc, Suzanne Gorge, Thierry Pech, Alphonse Coulot, Michel Savy, Antoine Doussaint, Vincent Le Rouzic, Note Terra Nova — 26 octobre 2022 — « Les métamorphoses de la logistique territoriale | Terra Nova (tnova.fr) »
[1] Audition de Pascal Maudry dans le cadre du rapport : les métamorphoses de la logistique territoriale
[2] Bilan du e-commerce en France : Les Français ont dépensé près de 147 milliards d’euros sur internet en 2022 – Fevad, la Fédération du e-commerce et de la vente à distance
[3] Une métropole d’équilibre désigne une des villes françaises sélectionnées par l’État dans les années 1960 pour contrebalancer la prééminence de Paris. Ces métropoles furent dotées d’équipements et d’investissements publics renforcés.
[4] INSERM – Communiqué de presse 22/10/2018 : Moins de cancers chez les consommateurs d’aliments bio.
[5] Comment réussir la transition agro-écologique ? | Terra Nova (tnova.fr)








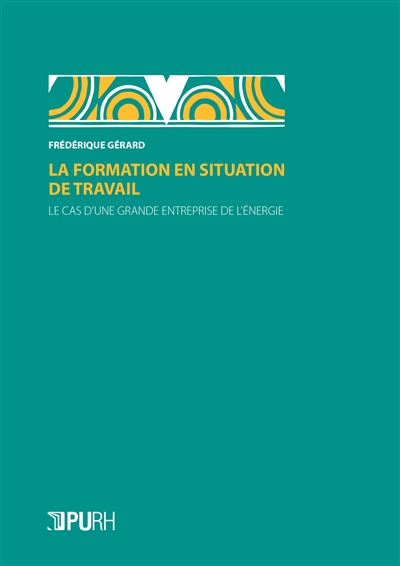

Laisser un commentaire