Le livre de Jean-Pierre Bouchez Le travail et ses espaces invite à un parcours historique et géographique des évolutions du travail au travers du prisme des espaces : l’usine fermée sur elle-même, le gratte-ciel de fer et de verre, les bureaux paysagers plus ou moins utopiques, les open spaces, le flex-office, le télétravail à la maison : autant de formes qui modifient le sens du travail.
« Working anytime, anywhere, any device »
En remontant le temps à la recherche de l’histoire des espaces de travail, l’auteur nous montre à quel point les tendances actuelles que nous imputons un peu trop rapidement à la crise sanitaire du COVID, sont le prolongement d’une évolution et de quelques révolutions audacieuses d’architectes et de concepteurs (Franck Lloyd Wright par exemple) ainsi que d’entreprises de tous pays. Le long parcours qu’il décrit, documente et illustre aboutit, pour l’heure, à ces étranges combinaisons et hybridations que sont le télétravail, le coworking (plus ou moins collaboratif et plus ou moins commercial), le corpoworking, les tiers lieux (plus ou moins dynamiques et plus ou moins associatifs).
Ces espaces où s’exercent le travail, les interactions entre les uns et les autres, les relations entre managers et managés, où se dessinent les chemins de l’innovation produisent toujours les « conditions de travail », le « bien-être au travail » (ou son contraire !) et l’imaginaire du travail, la représentation que l’on s’en fait.
L’imaginaire de la flexibilité généralisée, de l’hybridation, du full remote est-il celui d’un « non lieu », pour reprendre le titre d’un livre de l’anthropologue Marc Augé ? Que véhicule-t-il ?
Le temps des usines aux champs et de la liberté
Le 19e siècle fut en grande partie marqué au plan géographique par une « proto-industrie » encore ancrée dans le rural (la localisation de certaines usines dans des petits bourgs en témoigne encore) et finalement marquée par une réelle autonomie ouvrière. On retiendra la figure de ces « entrepreneurs-marchands » urbains, mais s’appuyant sur une main-d’œuvre mi-paysanne, mi-ouvrière, dispersée géographique, encore faiblement influencée par les mouvements sociaux : « on pourrait qualifier aujourd’hui cette pratique de temps partiel annualisé combiné avec de la pluri-activité ». C’était un système flexible, mais dans lequel la qualité n’était pas toujours au rendez-vous.
Survient alors le basculement vers le « système usinier » dont l’auteur montre en s’appuyant sur les historiens qu’il fut d’abord caractérisé par une faible supervision hiérarchique (Yves Cohen, Le siècle des « chefs ») et une certaine marchandisation des tâches : salaires aux pièces, tâcheronnat, et marchandage direct. Celle que l’on retrouve aujourd’hui dans l’univers des travailleurs des plateformes. Patrick Fridenson et Gérard Noiriel ont largement contribué à documenter ces périodes en montrant comment l’imposition de l’ordre et de la discipline ne fut pas chose facile, d’autant que l’usine et les ateliers étaient encore des espaces ouverts.
De Balzac (« Les employés ») aux premiers gratte-ciels
 C’est dans la deuxième moitié de ce même 19e siècle que la réorganisation des administrations, l’élargissement des fonctions de l’État, fabriquent la nouvelle catégorie des employés, d’abord fonctionnaires et agents publics, puis employés des banques, du commerce. S’y ajouteront ensuite les nombreux services commerciaux et supports des grandes entreprises industrielles. Quelques beaux exemples illustrent la manière dont l’organisation de l’espace figure et traduit matériellement les réalités hiérarchiques et la distribution des statuts et des rôles : le livre de Jean-Pierre Bouchez est ainsi émaillé de nombreux encadrés qui sont autant d’illustrations, de petits récits, précieux et si révélateurs : ici de la Compagnie parisienne du Gaz.
C’est dans la deuxième moitié de ce même 19e siècle que la réorganisation des administrations, l’élargissement des fonctions de l’État, fabriquent la nouvelle catégorie des employés, d’abord fonctionnaires et agents publics, puis employés des banques, du commerce. S’y ajouteront ensuite les nombreux services commerciaux et supports des grandes entreprises industrielles. Quelques beaux exemples illustrent la manière dont l’organisation de l’espace figure et traduit matériellement les réalités hiérarchiques et la distribution des statuts et des rôles : le livre de Jean-Pierre Bouchez est ainsi émaillé de nombreux encadrés qui sont autant d’illustrations, de petits récits, précieux et si révélateurs : ici de la Compagnie parisienne du Gaz.
Toutes les grandes villes américaines témoignent de l’explosion démographique, de l’urbanisation grandissante et des premiers gratte-ciels comme expression d’une formidable énergie créatrice. De nombreux historiens et architectes ont étudié les étapes de l’« érection » du gratte-ciel comme figure centrale de la ville. D’abord des immeubles en briques d’une dizaine d’étages : on se balade alors dans Lower Manhattan ou dans le Loop à Chicago. Puis viennent les structures de verre et d’acier : ces immeubles se multiplient en parallèle des organisations bureaucratiques, la hauteur et la verticalité sont symboles de puissance et de richesse : 45 étages pour la Compagnie d’assurances Metropolitan à NY, dépassée ensuite par l’immeuble Woolworth (1915). À l’extérieur, une formidable démonstration de puissance et à l’intérieur, une stricte organisation bureaucratique.
Et à l’intérieur ? Comment y travaille-t-on ?
Une stricte spécialisation des tâches, une stricte séparation des activités et des espaces des hommes et de ceux des femmes, « sténodactylographes » qui peuplent de grandes salles toutes identiques.
« Olivier Zunz (1990) relève qu’à l’intérieur du Metropolitan Life à New York, on observe l’apparition d’un Nouveau Monde de cols blancs. Selon la firme Remington, cinq ans après l’achèvement de la tour, 20 000 personnes y pénétraient chaque jour… la structure technique était particulièrement performante : elle comptait 48 ascenseurs parcourant chaque année 20 000 Kms, ainsi qu’un réseau téléphonique de 3 940 km, reliant les bureaux les uns aux autres, et au monde extérieur. On avait affaire à une véritable ville. La lumière pénètre partout et la soumission au regard d’autrui est totale, à l’exception des cadres supérieurs qui ont des bureaux individuels.»
C’est alors que l’innovation vint d’un grand architecte, Franck Lloyd Wright connu pour toutes sortes de réalisations, de nombreuses villas jusqu’au Musée Gugghenheim, et qui en matière de bureaux fut le précurseur de nombres de tentatives d’aujourd’hui.
Dans les bâtiments du siège de la Johnson Wax Company, l’architecte dessine lui-même les meubles.
 « Le bâtiment affiche un profil bas, tout en longueur, pour accentuer l’horizontalité. De ce fait il va à l’opposé des gratte-ciels qui apparaissent en grand nombre à Chicago.
« Le bâtiment affiche un profil bas, tout en longueur, pour accentuer l’horizontalité. De ce fait il va à l’opposé des gratte-ciels qui apparaissent en grand nombre à Chicago.
Le bâtiment s’organise autour de la grande salle de travail, un rectangle de 45 mètres par 65 mètres de côté, au plafond très haut. Cet espace est créé pour être une « cathédrale du travail ». Il n’y a pas de cloisons, c’est ce qu’on appellera plus tard un open space. Idée du collectif, où tout le monde est sur un pied d’égalité. Toute la salle est scandée de colonnes en forme de nénuphars, de 6,5 mètres de haut, dont la base ne mesure que 22 centimètres de diamètre et qui s’élargissent en haut jusqu’à créer un toit. Elles sont reliées entre elles par une couverture en briques de verre.» (Wikipédia)
Une série de correspondances s’établit : entre l’extérieur sans prétention ni marques de puissance, l’aménagement intérieur et le mobilier, et l’atmosphère de travail. Pour un autre bâtiment à Buffalo (le Larkin Building), l’architecte avait fait graver des mots sur les murs : generosity, altruism, loyalty, sacrifice, fidelity, imagination, enthusiasm… Le bien-être repose sur une certaine égalité dans l’accès à l’espace, sur la volonté de favoriser de bonnes relations entre employés et employeurs. Sur la transparence également : tout le monde pouvait voir tout le monde.
C’était en 1936-39, et c’est d’une grande modernité : on ne peut cependant s’empêcher de penser que si l’aménagement des espaces de travail traduit une certaine philosophie du travail et tout particulièrement de la hiérarchie, un espace de travail ouvert et beau ne conduit pas automatiquement à des relations de travail heureuses !
Fermeture et ouverture : les usines forteresses et les pools de secrétaires
Franck Lloyd Wright resta une belle exception. La croissance prodigieuse des effectifs tertiaires, la multiplication des fonctions-supports, la diffusion des machines : à écrire, à calculer, à fabriquer des statistiques ont engendré les premiers grands espaces ouverts pour les secrétaires. Les travaux de Delphine Gardet sur Renault montrent comment l’entreprise s’est directement inspirée d’une visite chez Ford Company : un véritable « pool » d’une centaine de femmes en blouses blanches penchées sur leur Remington montre la standardisation du travail. Même le papier et les dossiers cartonnés se mettent aux normes avec la sacralisation du format 21 x 29,7.
Le contrôle de l’espace s’accompagne du contrôle du temps. Toutes et tous arrivent en même temps : les horaires deviennent sacrés au bureau comme dans les usines ; des huissiers à l’entrée y veillent. Les usines se referment, s’entourent de grillages, de barrières, de murs : soucis de sécurité et volonté de contrôle se combinent pour produire ce « grand renfermement ». C’est l’époque de la règle des trois unités : unité de lieu, unité de temps et unité d’action. C’est la grande époque du taylorisme, du travail répétitif et de la méfiance envers ceux qui travaillent. Il est toujours là, même s’il s’est déplacé de l’usine aux entrepôts ou la grande distribution (dont d’ailleurs il est issu).
Les années 60 et 70 : les plantes vertes peuvent-elles changer les relations sociales ?
Dans de nombreux pays, on voit naitre une nouvelle conception des bureaux : certes moins révolutionnaire que Lloyd Wright (et moins réussie sur le plan formel) autour de la notion de « bureau paysager ». À Mannheim, les frères Schnelle traduisent dans le bureau paysager une envie de communication, une volonté d’accorder moins d’importance aux hiérarchies statutaires. L’idée se répandit, mais fut vite dévoyée en initiatives de réduction de surfaces par des préoccupations purement économiques.
D’autres innovations virent apparaitre le « cubicle » ou « micro-bureau » (dont le film de Tati Playtime donne une bonne idée, 1967), tandis qu’une équipe du MIT fit des propositions d’« Activity Based Working » avec des espaces de travail sans cloisons ni postes de travail attribués, en somme un « bureau non territorial » complété par une « salle de tranquillité totale »…
Une autre ligne d’imagination rechercha de l’inspiration du côté du « village » ou « de la tribu » : ainsi d’une société d’assurance néerlandaise Central Beheer, on est en 1972. Vint ensuite la thématique du « campus » bâti dans l’horizontalité, composé de nombreux bâtiments à taille humaine, dans un environnement le plus naturel possible bien que très paysagé et très entretenu : Spies Batignolles, Bouyghes Construction, Crédit Agricole evergreen, EDF Paris Saclay en France, le Googleplex aux USA illustrent cette tendance.
C’est un peu comme si l’on avait tout essayé ! Et le parcours que propose Jean-Pierre Bouchez montre bien combien les transformations post-Covid étaient déjà à l’œuvre, en tout cas dans les grandes entreprises.
Le flex office comme « non lieu » ?
On a pris l’habitude de dater le « flex office » du moment du déménagement d’Accenture aux Champs-Élysées en 1996 : avec une « staff room » et des bureaux individuels statutaires (à partir du grade de manager). 1000 consultants travaillaient régulièrement à la Tour Gan à la Défense, il y aura 300 postes de travail aménagés au « Georges V » et non attribués. Une sorte de « just in time » dans l’univers du bureau, avec un modèle de réservation hôtelière et une sorte de relation marchande entre le consultant et son espace de travail : « concrètement après réservation, l’occupation d’un poste de travail ou d’un bureau fermé est imputée en charge sur le budget du contrat d’affaires du consultant ». Dans l’une des annexes au livre, Alain d’Iribarne évoque une hybridation du statut de salarié et du statut de travailleur indépendant dont on imagine bien qu’elle se situe dans le prolongement de ces « innovations » des espaces et des temps de travail.
En 2004, Eric Veldhoen met en place dans une société d’assurance aux Pays-Bas un mix de flex office et d’espaces de bien-être et de services. C’est alors que les fauteuils aux grandes oreilles protectrices et les cabanes de réunion font leur apparition ! Exactement ce que de très nombreuses entreprises cherchent à organiser aujourd’hui en période post-Covid, mais qui était bien en germe depuis longtemps…
Le mélange des codes de l’hôtellerie et du bureau
Alors que selon l’auteur, nous entrons vraiment dans l’ère de « la flexibilité spatiale et temporelle généralisée », le travail devient « hybride » (travail en présentiel et télétravail au domicile, ou ailleurs), les lieux s’hybrident également. Tandis que le domicile s’organise pour accueillir les télétravailleurs (plus ou moins bien, avec l’aide des entreprises ou non), de nouveaux lieux se développent. Les récits d’Irène Valdelomar lors de son voyage d’études en Amérique centrale et en Amérique du Sud publiés dans Metis en témoignent (« Co-living et co-working autour du monde » : épisode 1, le Mexique et épisode 2, l’Argentine Irene Valdelomar, 2022).
Les lieux de coworking se développent : espaces collaboratifs ou simples locations de bureaux avec des codes qui ressemblent de plus en plus à ceux de l’hôtellerie. Le groupe Accor développe ce type d’offre. Les startupers et les travailleurs indépendants échappent ainsi aux contraintes des baux de location et aux nécessités des garanties financières.
Les « labs » (espaces d’innovation au sein des grandes entreprises), les fablabs (espaces d’innovation autogérés) ou les lieux de corpoworking prospèrent : ainsi de la Villa Bonne Nouvelle inaugurée par Orange en 2014 (dont Carine Chavarochette et Marie Durand Yamamoto font le récit dans l’une des annexes du livre) qui s’inspire des analyses des anthropologues et se veut productrice de « tribus » et d’esprit d’appartenance.
Les tiers-lieux mêlent des acteurs variés et des activités de tout type cherchant à entrer en cohérence, souvent sur une base territoriale.
Mais pour Jean-Pierre Bouchez, la question de base est celle de « la maturité organisationnelle de l’entreprise » et la recherche des corrélations positives entre ces nouveaux espaces de travail et la performance ne montre pas que des réussites. « La collaboration ne se décrète pas » et de beaux meubles ou des plantes vertes n’induisent pas nécessairement de l’efficacité et un bon climat social. Ainsi la plupart des collaborations se développent ailleurs que dans les openspaces. Les lieux de co-working développeraient plutôt des « comportements de réserve » : pour préserver le calme, la concentration, éviter les nuisances sonores, les interactions sont réduites, à l’image du silence que l’on observe dans un compartiment de TGV où tout le monde travaille !
Résultat : la plupart des études (celle d’Actineo dans les grandes métropoles du monde par exemple) montrent que les préférences des salariés vont toujours au bureau individuel, ou à la rigueur au « petit bureau partagé » couplé avec des jours de télétravail. L’espace de travail augmenté par le numérique, le « working anywhere, anytime » devrait s’accompagner d’un management augmenté : des changements se produisent, mais ils sont lents.
Pour en savoir plus
- Jean-Pierre Bouchez, Le travail et ses espaces, Le pari du bien-être et de la performance, de Boecksupérieur, 2023.
- Jean-Pierre Bouchez, « Le travail et la performance économique des organisations », Metis, mars 2023








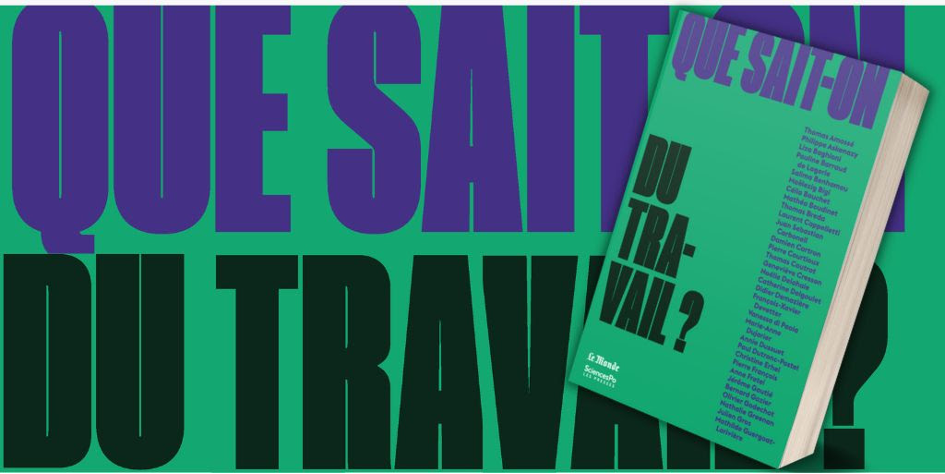
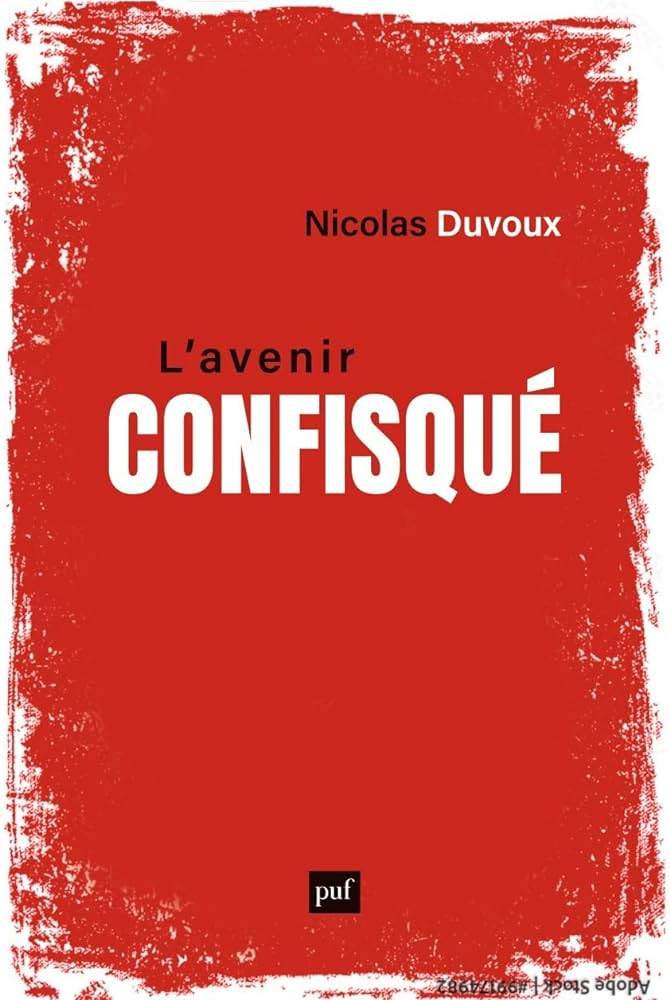
Laisser un commentaire