L’étrange période dans laquelle nous vivons, suspension radicale de toutes sortes d’activités, conduit le sociologue et consultant, spécialiste des questions de classification et rémunération Philippe Denimal à s’interroger sur le travail et sa reconnaissance.

Métiers invisibles, métiers indispensables
La pandémie et le confinement conduisent commentateurs, acteurs politiques, économiques ou sociaux, et nous tous, à rendre hommage à tous ces métiers le plus souvent invisibles et pour autant indispensables au bon fonctionnement de la société.
Femmes et hommes, titulaires de ces emplois de caissier, cantonnier, agent de nettoyage, ouvrier agricole, épicier, aide-soignant, auxiliaire de vie, travailleur social, manutentionnaire, livreur… méritent d’abord notre attention au premier sens du terme.
Ne rater aucune occasion de valoriser leur travail n’est pas qu’une marque de sympathie ou un acte de générosité, c’est aussi exprimer une évidente réalité : car enfin quels types d’emploi ne servent à rien ? S’il existe ici ou là des bullshit jobs, éradiquons-les. Ils sont la honte d’un groupe formant société humaine.
Des « boulots de pas grand-chose », disait-on autrefois. De fait, les titulaires ont souvent intériorisé cette dévalorisation et l’on remarque fréquemment ce sentiment gêné d’annoncer son métier lorsqu’il n’est pas spontanément reconnu comme faisant partie des activités professionnelles nobles et dignes. C’est pourquoi il est nécessaire de les aider à prendre pleinement conscience de toutes les composantes de leur rôle, de repérer avec eux toutes les compétences mises en œuvre, de réfléchir à des améliorations ou aux conditions de travail – pourquoi pas à l’occasion de l’entretien annuel au sein de leur entreprise –, mais cela suppose la présence d’un responsable hiérarchique assez sensibilisé et ouvert qui veuille bien leur consacrer un peu de temps sur le terrain.
À l’inverse, un DRH d’une structure hospitalière soutenait qu’il pouvait être souhaitable d’augmenter très peu – 0,5 % par exemple – et souvent, sinon tous les ans, les salariés qui effectuent un travail peu qualifié au motif que la fixation d’objectifs n’aurait pas de sens pour eux ou que la qualité de leur travail – supposé basique – serait trop difficile à évaluer. Un non-sens managérial selon nous qui se double d’une erreur économique puisque « l’aumône » versée, qui coûte en termes de masse salariale, est vraisemblablement très mal perçue à chaque fois qu’elle est octroyée.
Quelle (re)valorisation ?
Tous les emplois contribuent à notre vie en société, chacun pour leur part, à des niveaux différents, avec une influence variable, nécessitant plus ou moins de connaissances et plus ou moins d’interactions avec les autres. Cette diversité rend la chose sociale possible, via le travail et ses productions, biens et services.
Ces emplois dévalorisés méritent de ce fait, entend-on consécutivement, une plus grande reconnaissance salariale. Cela pose la question des critères socialement acceptables qui permettent de construire une hiérarchie équitable aux yeux des uns et des autres. Car aucune hiérarchie salariale ne se justifie autrement que par ce qu’accepte et entérine le corps social. Aucune loi fondamentale ni scientifique n’est en mesure d’expliquer les écarts de salaire entre les emplois. Nous savons juste qu’au-delà de quelques cas particuliers, nous admettons collectivement que certains emplois puissent être mieux rémunérés que d’autres. Il est vrai qu’il existe des structures, souvent associatives ou coopératives, dans lesquelles les distinctions salariales n’existent pas : ainsi, les 70 salariés du Théâtre du Soleil bénéficient-ils d’un salaire unique depuis 1968, l’emblématique cheffe de troupe Ariane Mnouchkine comprise. Mais dans des entreprises de taille importante, la chose n’est guère envisageable.
En dernière analyse, une hiérarchie salariale n’est qu’une construction sociale.
Depuis fort longtemps, cette construction se réalise dans un cadre négocié entre partenaires sociaux – les grilles de classification des conventions collectives (1919, 1936, 1945 en France) – et au moyen de modalités d’évaluation destinées à objectiver la valorisation des emplois – les critères classants (1975 en France). Le plus souvent désormais, on compte parmi ces critères ceux qui mesurent les éléments techniques – la complexité, les connaissances requises –, les aspects liés à la responsabilité – l’autonomie, l’impact – et les différents types d’exigence relationnelle – le management, la communication interne et externe. Les éventuelles sujétions, conditions de travail ou d’exercice font en outre l’objet d’une rémunération dans le cadre de dispositifs complémentaires, l’objet de la classification ne portant que sur l’évaluation des stricts contenus de travail.
Dès lors, comment serait-il possible de reconnaître et payer l’utilité sociale autrement qu’au travers de ceux cités à l’instant ? Il faudrait en premier lieu déterminer ce que cette utilité sociale signifie. Selon le type de crise qui nous secoue, les emplois les plus utiles peuvent ne pas être les mêmes ! Santé/care, protection des personnes et des biens, sécurité, agriculture, chaîne alimentaire, commerces essentiels… nous aurions bien des difficultés à les identifier sans omission et encore davantage à les hiérarchiser.
Même en rythme de croisière, la question se pose de la même façon. En fonction de quels éléments pourrait-on hiérarchiser ces différentes formes d’utilité qui dépassent les valorisations habituellement retenues ? Avec quelle échelle pourrions-nous reconnaître cette utilité sociale dans des conditions socialement acceptables, conformes à des valeurs suffisamment partagées au sein du corps social ? Cette quête semble illusoire.
On évoque parfois dans le cadre de séances de travail – notamment dans les commissions paritaires de branches professionnelles qui traitent des classifications et que nous animons – le cas des personnels d’accueil ou chargés du standard : « Ils véhiculent l’image de l’entreprise, ils représentent l’entreprise tout entière, leur rôle est majeur ». Certes leur emploi est au cœur des interactions entre l’interne et l’externe, certes le service qu’ils apportent est très utile – comment envisager l’absence d’interactions de cette nature ? –, certes le savoir-faire relationnel requiert des connaissances précises, mais pour autant, notre compromis social salarial ne reconnaît pas ces emplois au-delà d’un certain niveau de rémunération. Et ce compromis n’est pas le fait d’une minorité dominante, du moins pas fondamentalement. Il correspond à cet acceptable social qui permet de vivre en bonne intelligence… jusqu’à ce qu’il soit éventuellement bousculé ou qu’il se délite. Peut-être le bouscule-t-on à l’occasion de la crise actuelle.
Un facteur commun à dépasser
Si l’on considère cette utilité sociale comme un facteur commun à tous les emplois, ou dont l’intensité est variable en fonction du moment, alors aucune différenciation salariale pérenne acceptable n’est envisageable.
Mais la question de cette reconnaissance mérite sans doute d’être envisagée autrement. D’ailleurs, si autant de voix s’élèvent pour dénoncer ce déficit en cette période inédite, c’est sans doute parce que ces emplois sont souvent déconsidérés, mais surtout parce qu’ils se situent dans le bas de l’échelle salariale. Il apparaît alors aux yeux de tous un écart saisissant entre leur utilité qui nous frappe tous et la reconnaissance en monnaie sonnante et trébuchante dont ils bénéficient – ou qu’ils subissent, comme on veut.
Nous sommes alors aiguillés sur une problématique alternative, celle, mieux connue, de la rémunération des emplois les moins qualifiés au sens où nous l’entendons habituellement. Ce sujet ne se résoudra pas en claquant des doigts. Écartons ici l’hypothèse d’une révolution majeure : les signaux faibles – réels – enregistrés en ce début de siècle ne suffisent pas à l’envisager de façon probable dans l’immédiat (souhaitable ou pas, le sujet vaudrait tant de développements). Nous sommes finalement conduits – ou condamnés c’est selon – à modifier la trajectoire avec tact, en respectant quelques grands équilibres sociaux-économiques et en agissant avec fermeté sur les rémunérations les plus modestes, à défaut de renverser la table.
Aussitôt naissent des questions économiques évidentes, notamment l’impact sur le coût du travail et la faisabilité économique de cette action de fermeté si elle était menée. Aux macro-économistes, statisticiens, chercheurs, de prendre le relais. Aux partenaires sociaux éclairés de se mettre d’accord. Dans nos rêves les plus fous, un modèle européen émergerait dans ce sens. D’ailleurs, comment jouer cette affaire-là en solo ?
Faisons un pas de plus. Un revenu universel inconditionnel pourrait nous aider dans cette complexe et lourde tâche. L’une des problématiques essentielles dans ce domaine est celle du curseur à mettre au bon endroit : le montant pourrait ainsi se situer entre deux tiers et quatre cinquièmes du Smic pour générer un véritable effet. Laissons de côté la question du financement, pour autant évidemment essentielle ; nouvelles formes de redistribution, droits de mutation repensés, etc. Selon le niveau financier défini pour ce revenu universel, l’une des conséquences serait de conduire un certain nombre de salariés à arbitrer entre conserver un emploi peu qualifié, peu reconnu, mal payé, et renoncer à travailler de manière rétribuée, bénéficier du seul revenu universel en faisant un sacrifice financier pour agir ou se mouvoir différemment dans la société (faut-il à ce sujet redouter le syndrome du canapé-TV ? Sans doute pas davantage qu’aujourd’hui).
Si ces arbitrages conduisaient à devoir revaloriser salarialement les emplois les plus délaissés, pour qu’ils soient tout de même occupés, cela ne constituerait certainement pas le moindre intérêt de cette politique innovante. Cela aurait le mérite de, sinon résoudre du moins, réduire significativement les problèmes d’attractivité, de recrutement et même d’absentéisme dans ces métiers aujourd’hui déconsidérés et difficiles ou pénibles à exercer au quotidien.
Il peut sembler assez paradoxal qu’un spécialiste des questions de rémunération du travail évoque une telle proposition visant à rétribuer précisément autre chose que le travail. Car enfin chacun sait combien il structure notre vie personnelle et sociale. Hé bien… même pas peur : c’est parce que le modèle salarial sur lequel nous vivons depuis l’industrialisation est à la peine, tout comme sans doute ce libéralisme à bout de souffle qui n’en génère plus guère, qu’il semble impératif de repenser globalement les règles qui régissent les différentes formes de rétribution.
Au moins cette période de crise et de confinement nous conduit-elle à échafauder des scénarios pleins de rêves et de lendemains qui chantent.
Pour aller plus loin
– Entretien avec Philippe Denimal dans Metis « Regard d’un sociologue sur la reconnaissance du travail », Danielle Kaisergruber, novembre 2016
– Rémunération et reconnaissance du travail: Classification, compétences, appréciation, dialogue social, Philippe Denimal, Entreprises & Carrières, 2016








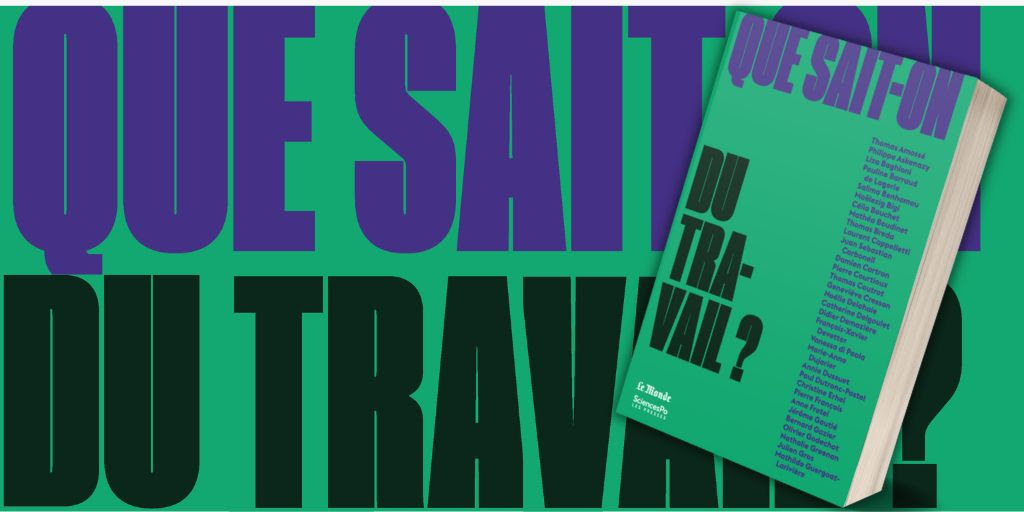
Laisser un commentaire