Pierre-Yves Le Dilosquer, propos recueillis par Félix Traoré
L’adaptation au cinéma du livre Le Quai de Ouistreham par Emmanuel Carrère a brièvement remis les travailleurs de la propreté au-devant de la scène, tout en nous rappelant le manque de reconnaissance dont ils font l’objet. La sortie de l’invisibilité se joue néanmoins sur un temps plus long, celui des acteurs, et pourquoi pas, celui de la recherche. Félix Traoré s’est entretenu avec Pierre-Yves Le Dilosquer, docteur en sciences économiques, chef de projet R&D au sein du Pôle Études du Monde de la Propreté, et auteur d’une thèse intitulée « Travail et valeur servicielle dans les modèles économiques des entreprises de propreté » (2021).
Votre travail interroge la faible valeur attribuée aux activités de propreté. Quels sont les ressorts de cette déconsidération ?
Pierre-Yves Le Dilosquer : L’activité exercée par ces femmes et ces hommes est souvent méconnue, voire dévalorisée, alors qu’elle permet à chacun de bénéficier d’un environnement propre et agréable.
La propreté souffre d’une double invisibilisation du travail. La première est causée par la nature d’un travail qui ne se révèle que lors de son absence. Le résultat du service de propreté, ce qu’il apporte en termes d’hygiène, de confort, de bien-être, de capacité à agir, est en grande partie intangible, et c’est souvent lorsqu’il n’est pas réalisé que l’on comprend toute l’importance qu’il a. La seconde est causée par les conditions de sa réalisation, encore souvent en horaires décalés, tôt le matin ou en fin de journée, ce qui ne permet pas de voir le travail en train de se faire.
Les recherches en sociologie ont aussi montré qu’il pouvait être lu dans cette dévalorisation du travail, une dévalorisation plus générale du travail des femmes — qui représentent plus de 70 % des œuvrants du secteur. Elles critiquent un processus de naturalisation des compétences : souvent les compétences requises ne sont malheureusement pas reconnues comme des compétences professionnelles, mais comme des compétences qui seraient « naturellement » féminines.
Il y a ainsi une sorte de paradoxe entre l’utilité du travail et sa reconnaissance sociale. Une étude de la New Economics Foundation avançait en 2009, malgré sans doute quelques limites méthodologiques, qu’un agent de service hospitalier chargé de la propreté créerait dix fois plus de valeur pour la société que le salaire qu’il perçoit, tandis qu’un banquier ou trader détruirait sept fois plus de valeur qu’il n’en créerait pour l’économie.
Ça n’est donc pas un problème propre à ce secteur ?
Cela renvoie, plus généralement, à la difficulté d’attribuer une valeur à certaines activités de service. Aujourd’hui, près de 80 % des emplois en France sont dans les services. Mais paradoxalement, on a des difficultés à saisir la réalité de la production d’une activité de service et la réalité de son résultat. C’est-à-dire ce que cela implique en termes de compétences et en termes de coopération avec les bénéficiaires, mais aussi ce que cela produit en termes de valeur servicielle et d’effets utiles, pour la société, pour les personnes, à court terme comme à long terme. Cette difficulté s’accroît pour les activités de services qui ont des dimensions relationnelles et immatérielles.
Face à cette complexité, on peut être tenté de réduire un travail qu’on sous-estime à la simple exécution d’une tâche. Et de ne valoriser monétairement seulement ce qui est pris en compte par nos grilles de lecture traditionnelles, en général à travers ce qui est dénombrable et mesurable. Le risque est alors une perception réduite de la valeur réelle produite par certaines activités.
S’agissant de la propreté, quelles stratégies ont été déployées pour valoriser ces activités ?
Le secteur de la propreté est en fait relativement récent. Il a connu plusieurs périodes de développement. Il s’est surtout constitué, sous la forme qu’on lui connait aujourd’hui, dans les années 1970 avec la grande vague d’externalisation des activités initiée par les clients. À cette période, il était déjà confronté à ce déficit d’image. Une première stratégie a été de miser sur la technicité, de développer la formation et les compétences nécessaires en termes de nettoyage professionnel et d’hygiène. Je pense qu’aujourd’hui les acteurs de ce secteur sont reconnus pour leurs savoir-faire dans ce domaine. Malgré cela, le secteur a aussi subi les travers de la financiarisation de l’économie. À partir des années 1990, on a pu observer de nouvelles exigences de réduction des coûts de la part des clients, de nouvelles conventions marchandes, la massification des marchés, une concurrence qui s’accentue, une réduction des taux de marge, des leviers de productivité qui atteignent leur limite.
Tout cela peut d’ailleurs se lire dans l’expression de « donneurs d’ordres » qui qualifie généralement les clients et acheteurs de services de propreté, et qui induit en corolaire des « preneurs d’ordres » qui seraient dans une simple posture d’exécutant. Cette expression contient une forme de négation du professionnalisme, de l’expertise et de la capacité de conseil des entreprises. L’achat de services de propreté est trop souvent aujourd’hui réduit à l’achat d’un « quasi bien », comme s’il s’agissait d’acheter des fournitures, des ramettes de papier ou des stylos, en se concentrant sur les dimensions le plus mesurables et les plus tangibles, des mètres carrés de surface à nettoyer, et en essayant de les avoir en volume et à moindre coût, avec peu ou pas de considération sur les personnes ni sur les effets utiles de leur travail.
Ce modèle n’est donc pas remis en cause ?
Aujourd’hui de plus en plus d’entreprises et de clients s’accordent sur les impasses de ce modèle de la « prestation de service ». C’est un modèle économique qui en quelque sorte applique des recettes industrielles à une activité de service. Cela peut se lire à plusieurs niveaux, que ce soit dans le modèle de valeur, le modèle de la demande dont on vient de parler, le modèle de rentabilité ou encore le modèle de travail : horaires atypiques, faible reconnaissance du travail, difficultés à valoriser monétairement l’activité… Mais si on s’accorde sur les impasses, il faut aussi trouver le moyen d’imaginer d’autres manières de faire.
Justement, voit-on des alternatives se profiler ?
On observe des transformations en train de se faire qui sont soutenues et expérimentées par les acteurs du secteur. Ce qui est intéressant c’est qu’elles produisent des inflexions servicielles par rapport aux pratiques dominantes. On peut les résumer au nombre de trois. La première porte sur l’organisation du travail avec le développement du travail en continu et en journée qui cherche à rompre avec les difficultés causées par les horaires décalés et fragmentés. La deuxième porte sur l’évolution de l’offre des entreprises dans une recherche d’enrichissement fonctionnelle, ce qui se traduit notamment par le développement d’offres de performance cherchant à s’adapter aux usages et aux besoins des bénéficiaires du service. Enfin, la troisième porte sur le modèle de la demande, avec des pratiques d’achat appelées à évoluer de manière plus responsable, mais aussi de manière à permettre l’innovation servicielle, en s’écartant de la posture du « donneur d’ordres ».
Ces inflexions induisent un autre modèle de travail et un autre modèle économique, fondés sur la compréhension de l’activité servicielle. C’est-à-dire sur la compréhension de ce que font réellement les personnes et de ce qu’elles produisent. La reconnaissance du travail, la coopération, la relation de service et les ressources immatérielles deviennent stratégiques. C’est ce que nous avons cherché à montrer dans le travail de recherche entrepris au sein du secteur.
Vous démontrez notamment les vertus du travail en continu et en journée…
Comme nous l’évoquions, les interventions de propreté ont aujourd’hui principalement lieu en horaires décalés, tôt le matin ou en fin de journée, souvent en raison des exigences des clients publics et privés. Mais toutes les études montrent que cette organisation du travail peut être source de difficultés pour les agents de propreté, pour les entreprises prestataires, mais aussi pour les clients. D’un côté, cela produit un temps de travail fragmenté qui complique la vie des salariés, avec une multiplication des déplacements, des périodes creuses, mais aussi des risques de sécurité avec le travail isolé. De l’autre, les bénéficiaires ne se rendent souvent pas compte du service réalisé et ne peuvent bénéficier d’une propreté en continu.
C’est pour cela que depuis plus de dix ans le travail en continu et en journée se développe. Et là aussi toutes les études montrent que c’est une solution favorable pour l’ensemble des parties, y compris pour les territoires dont certains sont désormais très engagés sur le sujet, comme à Dijon, Nantes ou Toulouse. En fait, ce n’est pas qu’une question d’horaires qu’il s’agirait de déplacer. C’est une véritable évolution du service et un engagement concret de responsabilité sociétale. Les employeurs remarquent que les agents se sentent plus reconnus dans leur travail par les bénéficiaires. C’est aussi un vecteur de sens, car on voit directement l’utilité de son action. Cela change aussi le comportement des bénéficiaires, ils sont plus respectueux et plus attentifs à la salissure qu’ils peuvent produire, ils peuvent même faciliter l’intervention en aménageant l’espace, en débarrassant leur bureau, etc. Un des enseignements majeurs est que pour les clients ayant fait le choix du travail en journée, le taux de satisfaction est proche de 100 %. Une fois mis en place, il n’y a, en général, pas de retour en arrière.
Ce mode d’organisation est-il appelé à se généraliser ?
Malgré ces enseignements, le travail en journée a du mal à se développer plus largement. Les horaires décalés restent une normalité qu’il est difficile de déconstruire, c’est presque un changement culturel. Cela ne pourra pas se faire du jour au lendemain. Aujourd’hui les plages horaires d’intervention ne sont pas systématiquement réinterrogées par les clients. Il y a une forte inertie. Il y a aussi un certain nombre d’idées reçues comme la crainte de gêne ou de bruits liés à l’aspirateur. Mais souvent la réalisation préalable d’une étude de faisabilité et une analyse des rythmes d’activité menées conjointement entre entreprise et client permet de les éviter ou de les minimiser.
Les syndicats de salariés sont aussi favorables à cette organisation et ont d’ailleurs pris des engagements conjoints avec la Fédération des Entreprises de Propreté, d’Hygiène et Services Associés (FEP) lors d’une conférence de progrès tenue en septembre dernier en présence de Mme Élisabeth Borne, ministre du Travail de l’Emploi et de l’Insertion. L’État a également pris à plusieurs reprises des engagements pour développer le travail en journée sur ses marchés (circulaire Fillon de 2008, circulaire Ayrault de 2013 par exemple) bien que nous n’ayons pas de données permettant de mesurer les résultats réels de ces annonces.
Mais si des progrès sont possibles, il ne faut pas non plus idéaliser le sujet ou envisager sans réserve un déploiement général. Les politiques achat peuvent encore être bloquantes, par exemple lorsqu’on pose la question à des acheteurs de savoir s’ils seraient prêts à payer davantage un service qui leur permet de répondre au plus près du juste besoin de leurs usagers, de garantir une propreté en continu, de remplir certains de leurs objectifs RSE, ils sont 69 % à répondre non. Aussi, il faut prendre en compte qu’une part des salariés ne souhaite pas forcément travailler en journée, ce qui signifierait modifier une organisation personnelle déjà établie, dans certains cas devoir gérer avec d’autres employeurs. Il peut également y avoir des appréhensions légitimes quant à l’exercice, sous le regard des autres, d’un travail encore trop souvent dévalorisé. Cela fait aussi émerger le besoin de nouvelles compétences servicielles. Dans tous les cas, il s’agit d’un changement qui doit se construire de manière partenariale et tripartite, entre entreprise, client et salariés. La FEP a d’ailleurs produit une clause type de marché et des recommandations pour faciliter la mise en œuvre du travail en journée.
On a observé un regain d’intérêt pour le travail de la propreté, d’ordinaire si peu visible. Que peut-on en attendre ?
Comme le livre de Florence Aubenas sorti en 2010, le récent film d’Emmanuel Carrère a cette qualité de faire apparaître aux yeux du grand public les enjeux économiques et sociaux qui touchent les travailleurs de la propreté. Il insiste très justement sur cette tension entre le professionnalisme des œuvrants et la faible reconnaissance du travail par les bénéficiaires et acheteurs du service. Surtout, la crise sanitaire a produit un effet de révélation pour toutes ces activités qui ont la particularité de conditionner le travail des autres, sans lesquelles on ne pourrait pas exercer ses actions quotidiennes dans de bonnes conditions. Elles ont soudainement été reconnues comme essentielles, voire stratégiques, pour la continuité de la vie économique et sociale. On peut espérer que cela déclenche des prises de conscience durables, mais il y a encore du chemin à parcourir.








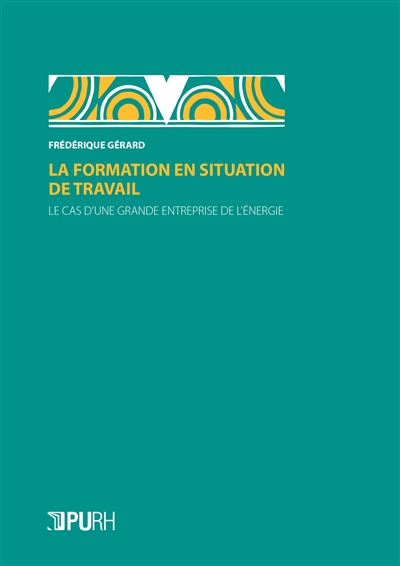

Laisser un commentaire