Le livre Sociologie politique du syndicalisme (Baptiste Giraud, Karel Yon, Sophie Béroud) propose un regard neuf sur le syndicalisme français. Qu’est-ce qu’un syndicat : un groupe de représentation d’intérêts comme un autre, un corps intermédiaire, une sorte de parti politique ? Trois questions structurent le livre : le fonctionnement du champ syndical, les modalités d’organisation de l’action syndicale et ses formes de l’action.

@ Jarkko Manty, Pixabay
En mettant l’accent sur une série de travaux empiriques développés depuis le début des années 2000, notamment par la génération des politistes à laquelle ils appartiennent, les auteurs.e.s répondent à ces différentes questions.
L’ambivalence des processus d’institutionnalisation du syndicalisme en France
En revenant dans les deux premiers chapitres, à partir des travaux des historiens du syndicalisme, sur les dynamiques socio-historiques d’institution du syndicalisme en France et en les comparant avec celles qui ont prévalu dans d’autres pays, les auteur.e.s mettent en avant tout à la fois les héritages des luttes sociales et les dynamiques engendrées par la production législative. Les premiers sont notamment marqués par la centralité initiale des ouvriers de métiers, les secondes ont par exemple conduit à la dissociation du syndicalisme et des mutuelles et à la restriction du domaine d’intervention des syndicats à la défense des intérêts particuliers renforçant par là les frontières entre syndicats et partis. Les processus spécifiques de production des solidarités en France sont également marqués par le double principe de structuration selon l’industrie et suivant les configurations territoriales. Ainsi historiquement construits les territoires pertinents de l’action collective sont différents, encore aujourd’hui, selon les confédérations. Le rôle des bourses du travail a fait des unions départementales des lieux politiques et de politisation pour la CGT ou la CGT-FO alors que les unions locales ont un poids faible à la CFDT qui a pu plus aisément s’adapter au rôle des Régions en donnant une place importante aux unions régionales.
Une telle démarche socio-historique est également appliquée au constat d’institutionnalisation des syndicats et au rôle central joué par l’Etat dans ce processus. Les auteur.e.s rappellent les étapes de cette institutionnalisation et ses conséquences en termes d’activité syndicale centrée sur les mandats et insistent sur l’intérêt qu’il y a à se pencher sur l’articulation entre les pratiques de mobilisation et des pratiques plus instituées.
S’interroger sur l’institutionnalisation des syndicats les conduit aussi à analyser les facteurs de puissance syndicale. A cet égard, les auteur.e.s reviennent sur une démarche d’analyse mettant en avant quatre facteurs de puissance syndicale : la puissance structurelle liée à la place dans la division du travail des travailleurs qu’ils organisent, la puissance organisationnelle au sens de la capacité à faire nombre, les ressources institutionnelles sur lesquelles ils peuvent s’appuyer et enfin la capacité discursive qui saisit la possibilité de faire partager ses conceptions du changement social et les alliances qui peuvent être liées [1]. Ils observent que cette démarche, si elle est heuristique notamment dans la comparaison internationale, peut néanmoins être questionnée en ce qu’elle présuppose qu’on pourrait mesurer le pouvoir syndical et ses effets.
Peut-on considérer les syndicats comme un groupe d’intérêt comme un autre ? Pour répondre à cette question, les auteur.e.s, considérant que les syndicats ne maîtrisent que partiellement les contours du groupe qu’ils représentent, délaissent la conception commune des groupes d’intérêt essentiellement liée à leur poids institutionnel. Lui est préférée une perspective constructiviste qui saisit l’espace de représentation comme un champ dans lequel sont à étudier les rapports de pouvoir au sein des organisations, les logiques de reproduction des dirigeants et les positions occupées par les différentes organisations.
Les auteur.e.s concluent cette partie sur la nécessité de relativiser une vision d’une puissance syndicale liée à son institutionnalisation excessive et de s’interroger sur les facteurs de faiblesse que constituent aussi cette institutionnalisation en ce qu’elle tend à monopoliser l’activité syndicale et à imposer une certaine vision du syndicat comme acteur du dialogue social.
Le pluralisme syndical et la politisation des syndicats, des notions socialement construites
On considère souvent que la faiblesse du syndicalisme en France serait à imputer à sa trop grande politisation et à l’importance du pluralisme syndical. Pour appréhender ces notions les auteur.e.s reviennent sur la typologie usuelle qui a historiquement défini trois formes de syndicalisme dominant dans chaque configuration nationale. Pour la France, le syndicalisme révolutionnaire fondé sur la conception de « la double besogne » — défense des intérêts économiques et préparation d’un avenir révolutionnaire — qui a pu inspirer d’autres pays latins. Pour la Grande-Bretagne, le syndicalisme dit trade-unioniste qui fut longtemps considéré comme plus tourné vers la défense des intérêts strictement économiques. Enfin, le syndicalisme social-démocrate en Allemagne et en Europe du Nord où l’action de défense des intérêts économiques du syndicat s’est articulée à l’action politique des partis. Ils montrent notamment que cette typologie doit être revisitée à la lumière notamment, de la fragilisation de la frontière entre politique et économie, des ressources liées à la position des groupes professionnels sur le marché du travail et du rôle croissant de l’Etat.
Sous ce dernier aspect de la dynamique des relations Etat/syndicats, les analyses sont placées dans le cadre de la théorie de l’échange politique dans lequel la reconnaissance institutionnelle des syndicats et la consultation sur l’élaboration des politiques sociales s’échangent contre la participation à la régulation économique et sociale globale afin de construire un cadre au développement du marché. Dans ce cadre, il apparaît que l’Etat, à travers un certain nombre de dispositifs législatifs d’institutionnalisation des syndicats, a pu contribuer au pluralisme syndical afin de lutter contre la domination de la CGT.
Pour les auteur.e.s, le pluralisme syndical s’il emprunte aux différentes conceptions des rapports entre syndicalisme et politique ne se résume pas au clivage réformiste/révolutionnaire lequel a historiquement parcouru plusieurs confédérations. Ils nous invitent, à partir de nombreuses études, à réexaminer ce clivage à l’aune de la recomposition des rapports entre ces deux sphères : d’une part la distance à la politique partisane est la seule aujourd’hui légitime, d’autre part la socialisation à la politique continue à se faire par le biais de l’engagement syndical notamment à travers les réseaux militants, enfin le rôle croissant pris par la négociation modifie les rôles dévolus aux militants et tend à en faire le paradigme de l’action syndicale au détriment d’une vision plus radicale du changement social.
Dans le cadre institutionnel ainsi caractérisé, les auteur.e.s se penchent dans une seconde partie sur les modalités d’organisation de l’action syndicale en analysant les logiques de représentativité et le travail de représentation, les logiques de l’adhésion syndicale et les obstacles à l’engagement et le fonctionnement interne des organisations.
Une mesure de la représentativité par l’élection tel un scrutin municipal
 Quand on parle de représentativité, il y a lieu de distinguer la représentativité sociale qui réfère à la capacité à représenter et à recueillir l’assentiment des représentés et la représentativité juridique conférée selon certains critères par les pouvoirs publics et qui procure des avantages institutionnels. Les auteurs reviennent sur le jugement selon lequel la crise de la représentativité se traduirait par le décrochement entre ces deux notions au profit de la seule institutionnalisation du syndicalisme faisant des syndicats des « agences sociales », pour reprendre l’expression bien connue de Pierre Rosanvallon.
Quand on parle de représentativité, il y a lieu de distinguer la représentativité sociale qui réfère à la capacité à représenter et à recueillir l’assentiment des représentés et la représentativité juridique conférée selon certains critères par les pouvoirs publics et qui procure des avantages institutionnels. Les auteurs reviennent sur le jugement selon lequel la crise de la représentativité se traduirait par le décrochement entre ces deux notions au profit de la seule institutionnalisation du syndicalisme faisant des syndicats des « agences sociales », pour reprendre l’expression bien connue de Pierre Rosanvallon.
Les auteur.e.s observent que dans les dernières décennies la centralité de la négociation d’entreprise et la fragilisation du principe de faveur par l’essor de la dérogation ont posé avec une nouvelle acuité la question de la représentativité des acteurs de la négociation et corrélativement celle de l’accord majoritaire. En introduisant un principe électoral en lieu et place de la logique descendante de la représentativité octroyée par l’Etat, la réforme de 2008 visait à re-légitimer les organisations existantes et éventuellement à en faire entrer de nouvelles. De fait le livre montre, à partir d’études fines des votes aux deux cycles électoraux, que ces mesures d’audience électorale tendent plus à refléter l’ancrage social différencié des syndicats dans le monde du travail et ses évolutions qu’à restituer une image de la représentativité réelle des organisations syndicales. En cela elles pourraient s’apparenter, par la différenciation des contextes dans lequel chaque élection s’insère, à des élections municipales dont on sait qu’il est difficile d’en inférer la primauté de telle ou telle organisation politique. Ces analyses conduisent les auteur.e.s à considérer à ce principe électoral comme un « bricolage opérationnel visant à consolider la négociation collective » et à s’interroger sur le sens à donner à la qualification de première organisation syndicale.
Adhésions et mécanismes de renouvellement ébranlés par les mutations économiques
En dehors de quelques périodes comme 1936 ou la Libération, l’adhésion syndicale n’a jamais été très forte en France comparée à d’autres pays où l’adhésion s’accompagne d’un certain nombre de services. Néanmoins les effectifs syndicaux ont connu une chute importante dans les années 1980 et une stabilisation relative depuis le milieu des années 1990. Les transformations du système productif dans les dernières décennies et les recompositions du salariat agissent tout à la fois sur les reculs de l’adhésion et sur la propension à adhérer. La stabilité dans l’emploi, la taille des entreprises, le secteur d’activité et la présence syndicale favorisent l’adhésion. Celle-ci est donc déstabilisée par la disparition des concentrations ouvrières dans les grandes entreprises et la précarisation des emplois qui touchent particulièrement les jeunes et les femmes, groupes peu enclins à adhérer. De plus l’augmentation du niveau de diplômes tend à engendrer un processus de « désouvriérisation » des jeunes embauchés qui n’ont plus le même rapport au travail et au militantisme, ni les mêmes attentes professionnelles se traduisant notamment par la difficulté de renouveler les bastions syndicaux qui touchent plus particulièrement les syndicats originellement plus implantés dans l’industrie comme la CGT.
Les différentes organisations mettent en place des stratégies différenciées pour « fabriquer des militants » et s’adapter aux nouvelles configurations du salariat. Celles-ci sont adaptées aux caractéristiques socio-démographiques différentes de leur implantation (secteur public et grandes entreprises pour la CGT, PME de moins de 200 salariés pour la CFDT ; plutôt employés et ouvriers pour la CGT, plus de cadres à la CFDT….) mais également à leur vision du syndicalisme (valorisation de l’expertise — capital expert — à la CFDT, de l’expérience militante — capital militant — à la CGT). Elles s’appuient sur des outils variés, que ce soit la formation syndicale afin de faciliter la production de référents culturels communs, la mise en place de quotas de femmes dans les instances, ou encore de structures spécifiquement tournées vers les jeunes ou bien de divers types d’articulation entre parcours militants et carrières professionnelles.
Un répertoire d’action élargi
L’analyse en termes de répertoire d’action vise à rendre compte de la diversité des formes d’action syndicale — qui ne saurait se réduire aux grèves et à la négociation — et de leur évolution. Les transformations du modèle productif avec la diminution du nombre de grands établissements par le recours à la sous-traitance influent sur l’importance du recours à la grève : baisse du volume des grèves et baisse du nombre de salariés en grève vont de pair. Parallèlement les enquêtes statistiques en entreprises permettent de noter une multiplication des courts arrêts de travail qui ont pu toucher jusqu’à 30 % des établissements entre 2008 et 2010 et le lien entre présence syndicale et conflits, celle-ci facilitant le passage à l’action collective.
La médiatisation est de plus en plus souvent utilisée pour légitimer l’action du groupe et entretenir la mobilisation. Si les principes d’action propres à chaque organisation syndicale influent dans une certaine mesure sur les formes d’action, ils ne structurent pas néanmoins l’ensemble des pratiques lesquelles sont liées à de nombreux critères plus locaux (attitude de l’employeur, normes du groupe professionnel…). Globalement le recours à des dispositifs d’action institutionnelle centrés sur la négociation ou l’intervention dans les instances de représentation s’articule avec d’autres formes de mobilisation plus tournées vers le conflit ou encore avec l’appui sur des ressources juridiques ou cognitives (expertise).
En conclusion les auteur.e.s mettent en avant la vitalité des recherches engagées et la richesse qui naît de l’hybridation des regards issus des différentes approches tout en regrettant de n’avoir pas pu suffisamment se pencher sur les formes alternatives de représentation. On pourrait y trouver d’autres paradigmes. Mais ces réserves s’estompent devant la qualité de cet ouvrage qui permet d’approfondir, en les plaçant dans leurs dynamiques socio-historiques, les processus de construction et d’institutionnalisation du syndicalisme, d’éclairer la complexité du travail syndical de représentation et de déconstruire un certain nombre d’idées reçues sur « la crise du syndicalisme ».
Pour en savoir plus
– Baptiste Giraud, Karel Yon, Sophie Béroud, Sociologie politique du syndicalisme, Armand Colin, 2018 (Collection U)
– ETUI, Rough waters : European trade unions in a time of crisis (2018)






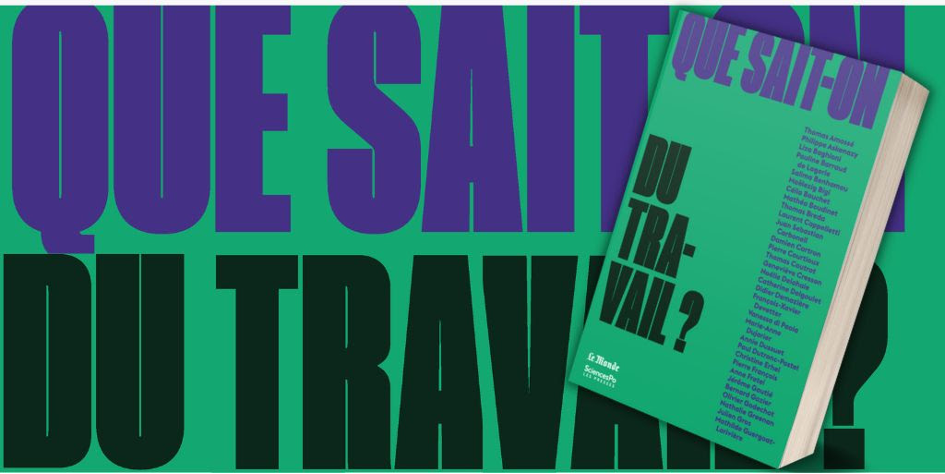
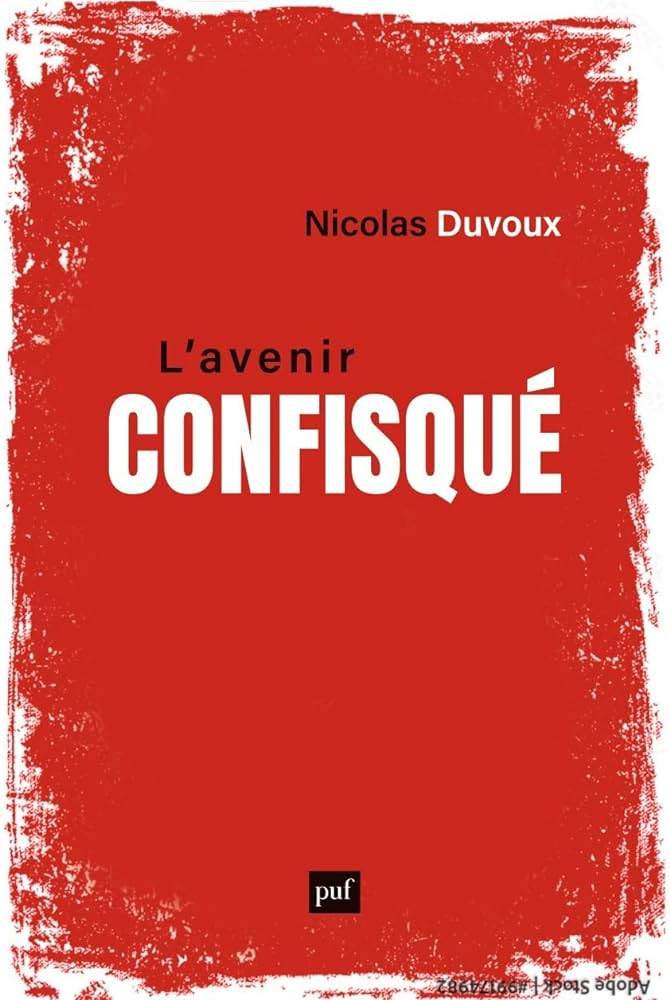

Laisser un commentaire