
Si l’on en croit le dictionnaire, mesurer, c’est « déterminer la valeur de certaines grandeurs par comparaison avec une grandeur constante de même espèce prise comme étalon ». Mais avec l’intrusion et la diffusion du numérique en entreprise, l’étalon s’emballe et la mesure se mue en démesure. Que faut-il faire pour éviter la dérive vers un taylorisme 2.0 ?
J’emprunte le terme de « quantophrénie » à Vincent de Gaulejac, professeur de sociologie et directeur du laboratoire de changement social de l’Université de Paris 7-Diderot, qui désigne ainsi l’obsession du chiffre qui s’est emparée des organisations, et ce d’autant plus facilement que la technologie rend la création et la manipulation de ces chiffres plus faciles. Je ne reconnais pas toujours l’entreprise (les entreprises ?) qu’il dépeint de sa plume sans concession, mais je reconnais les excès qu’il dénonce avec clairvoyance. Les titres de ses livres résument bien l’impasse dans laquelle ces machines gestionnaires nous entraînent : « Le coût de l’excellence » (avec Nicole Aubert, Le Seuil, 1991) ; « La société malade de la gestion » (Le Seuil, 2005) ; « Travail, les raisons de la colère » (Le Seuil, 2011) ; « Manifeste pour sortir du mal-être au travail » (avec Antoine Mercier, Desclée de Brouwer, 2012). Il est aussi l’un des sociologues qui s’est intéressé très tôt à l’impact des systèmes d’information sur le travail (avec Alain Bron, « La gourmandise du tapir – Utopie, management et informatique », Desclée de Brouwer, 1995).
D’autres chercheurs qui se sont intéressés au travail ont eux aussi dénoncé l’emprise du chiffre, et cela notamment par l’entremise du management. Dans « Le Livre noir du management » (Bayard, 2011), Isabelle Bourboulon décrit minutieusement la modification de l’environnement de travail au nom de « l’obsession de la mesure ». Pierre-Yves Gomez (« Le travail invisible ; enquête sur une disparition », Ed. François Bourin, 2013) nous adresse une alerte salutaire sur l’expulsion du travail réel derrière les batteries de chiffres et ses conséquences particulièrement délétères : « A tous les niveaux de responsabilité, le manager s’est de moins en moins occupé de travail réel. Fixant des objectifs et des moyens, il est devenu un spécialiste de l’organisation, une organisation rationalisée, tendue vers la performance mais vide de travailleurs concrets. Combien savent aujourd’hui ce que font vraiment les personnes qu’ils dirigent pour avoir partagé, au moins un temps, leur travail. (…) Les gestionnaires sont devenus des experts du travail abstrait grâce notamment aux informations normalisées que fournissent les tableaux de bord, interprétées dans leur sabir anglicisant et conceptuel ». La gouvernance actionnariale, nous dit-il, fantasme l’entreprise comme « une bureaucratie de verre » : il faut pouvoir tout mesurer, tout évaluer, tout contrôler au détriment du travail réel. Bien entendu, comme dans les phases antérieures de l’automatisation, les salariés résistent à cette virtualisation de la sphère du travail, par exemple en se référant à une identité imaginaire, mythique, qui glorifie le passé où le travail était « bien fait ».
Mesure du sens et sens de la mesure
A force de rendre le travail abstrait, la tentation quantophrénique provoque une mise à distance du travail réel. Et pourtant, je ne parviens pas à me résoudre à cette « diabolisation de la mesure ». Car la notion même de mesure est paradoxale : la dérive quantophrénique n’est pas une issue fatale et prédéterminée. Au contraire, la mesure, c’est aussi la capacité à accepter les limites, la recherche de simplicité et d’économie, ce que le sens commun désigne par le « sens de la mesure ». Et effectivement, la mesure permet parfois de résumer (sans nécessairement caricaturer) des réalités complexes, pour permettre à un dialogue de s’engager. Comme le montre Danielle Kaisergruber dans son article de ce dossier, la mesure pertinente dépend du nécessaire aller et retour entre la généralisation (le chiffre) et le terrain (le réel). Beaucoup de négociations réussies sont fondées sur des diagnostics chiffrés et partagés (égalité professionnelle, lutte contre les discriminations, prévention du stress en entreprise, etc.). La diffusion du numérique ira probablement dans le sens d’un renforcement de ces diagnostics chiffrés, qui permettent, autant que faire se peut, de caractériser une situation de façon dépassionnée, avant d’enclencher une négociation.
Il y a d’ailleurs un fait qui ne trompe pas : les mouvements sociaux ne répugnent plus à se dénommer eux-mêmes par un chiffre. Dans le sillage du mouvement « Occupy Wall Street », s’est créé en 2011 « We are the 99% », qui est à la fois un mouvement et un slogan, qui désigne ceux qui estiment payer pour les excès des 1% qui détiennent à eux seuls l’essentiel des richesses. Ce mouvement se serait-il autant développé sans la « mise en chiffres » et la mesure des inégalités effectuée par une cohorte de jeunes économistes et sociologues talentueux ? La mesure n’est donc pas forcément un enfermement du travail ; elle est aussi libératrice. Comme tout outil, sa finalité dépend de l’utilisation qui en est faîte.
Prendre LES mesures pour prendre DES mesures
La médecine nous a montré que la qualité du traitement dépend beaucoup de la qualité du diagnostic. Un autre aspect positif de la mesure est qu’elle constitue une incitation à agir. Ainsi par exemple, en matière de RSE, la longue bataille du reporting extra-financier (depuis la loi NRE du 15 mai 2001, qui imposait des obligations de reporting RSE mais seulement aux entreprises cotées, soit environ 700 entreprises) a connu une nouvelle victoire avec la loi du 12 Juillet 2010, dite Grenelle 2, qui étend ces obligations à toutes les entreprises de chiffre d’affaires (ou total du bilan) supérieur à 100M€ et d’effectif supérieur à 500 salariés. Victoire, vraiment ? Le décret d’application de l’article 225 de cette loi, publié (après quelques rocambolesques aventures) en avril 2012 prévoit une liste précise d’indicateurs, ce qui constitue un double contresens. Contresens sur l’utilité d’un indicateur (permettre le suivi d’actions d’amélioration) ; contresens sur la nature de la RSE (engagements volontaires). Ce nouveau dispositif prévu par Grenelle 2 va concerner plus de 2000 entreprises en France d’ici à 2017 (versus 700 seulement pour la législation antérieure, la loi NRE).
Malgré ces regrettables imperfections, il est permis d’espérer que le fait d’avoir à constituer ces données, les publier et même les faire certifier par un tiers accrédité, apportera le bénéfice d’inciter les entreprises à agir sur des aspects qui figuraient auparavant dans l’angle mort de leurs dispositifs de « cost-control ». C’est ainsi que « prendre les mesures » est une incitation à « prendre des mesures ». Lors de son audition par la Commission du développement durable du Sénat (27 mai 2013), Hélène Valade, présidente du C3D (Collège des Directeurs du Développement Durable) saluait le reporting, prescrit par l’article 225 de la loi Grenelle 2, « afin qu’il soit généralisé, qu’il soit un outil de pilotage du changement – une entreprise incitée à mesurer sa consommation d’eau doit chercher à la réduire – et qu’il se voie accorder la même importance que les indicateurs financiers ». Comme Janus, les usines à chiffres ont deux faces… y compris une face positive.
A peu près en même temps, survient un second attirail de chiffres bien alignés, bien normés et impeccables dans leur homogénéité, elle aussi déterminée par décret ministériel : la fameuse base de données économiques et sociales (dite improprement « unique » alors qu’elle se superpose aux dispositifs existants) résultant de l’accord interprofessionnel sur la sécurisation de l’emploi de janvier 2013. Celle-ci s’applique à toutes les entreprises de plus de 50 salariés. Face négative : là encore, une liste d’indicateur ignorant les spécificités des métiers, avec cependant la possibilité d’en négocier le contenu par accord de branche (nombre de négociations de branche à ce jour : zéro !) ou d’entreprise (nombre de négociations d’entreprises : moins d’une demi poignée). Face positive : cette base de données est le support d’une nouvelle information-consultation sur la stratégie, qui donnera du sens et de l’anticipation au dialogue social, qui en a bien besoin.
Ces deux nouvelles usines à chiffres présentent deux points communs :
Elles ne proviennent pas des dérives managériales et de l’appétit insatiable des entreprises pour la mise en chiffres. Au contraire, les organisations professionnelles représentant les entreprises étaient réticentes dans les deux cas alors que les représentants des salariés, du gouvernement et des ONG y étaient favorables.
Les indicateurs sociaux qu’elle contiennent évitent soigneusement le travail pour se cantonner à des aspects plus traditionnels (emploi, formation, etc). Il est vrai que le travail a toujours su échapper à la mise en chiffres.
Le travail reste donc un objet de mesure à la main exclusive des directions d’entreprise. Cette mesure est un enjeu politique car « pour la direction, la mesure du travail sert à piloter la productivité alors que pour les salariés, c’est le travail bien fait qui compte » (Adeline Gilson, « La mesure du travail opérée par les salariés : une norme partagée ? »). Or le numérique rendra de plus en plus aisé le calcul en temps réel de la productivité mais ne saura pas rendre compte de la complexité de ce « travail bien fait ». Il contribuera à l’expulsion « digitalu-militari » du travail réel.
Par ailleurs, il existe aussi trop souvent le cas d’entreprises qui se réfugient derrière l’hypertrophie de la mesure pour éviter d’agir. C’est ainsi que trop de démarches de prévention des risques psychosociaux (RPS) se sont égarées dans des tentatives éperdues de mesurer à grands renforts de baromètres, enquêtes et sondages et se sont enlisées à la lecture des résultats. Dans bon nombre de cas, il suffisait de se rapprocher des salariés, de faire l’effort de comprendre leur travail, d’engager une concertation… et d’agir. C’est avec raison que Pierre-Éric Sutter tournait en dérision « les Trissotin de la mesure du bien-être au travail » : « Les offres de consultants, spécialistes et autres gourous du bien-être fleurissent, promettant le paradis au travail : stages de massage, salle de relaxation, méditation transcendantale s’invitent dans les entreprises en promettant à tire larigot épanouissement et bonheur professionnel ».
Qu’est-ce que l’on mesure lorsqu’on quantifie le travail ?
N’en déplaise à Airbnb ou Uber, le vrai fondateur de l’économie collaborative est Aristote, avec sa théorie de l’échange fondée sur la transaction : pour qu’un échange entre deux biens soit équilibré, il faut que ces deux biens incorporent des quantités de travail équivalentes. Quelques siècles plus tard, Adam Smith poursuivra dans cette lignée : « la valeur de toute marchandise, pour la personne qui la possède, est égale à la quantité de travail qu’elle lui permet d’acheter (…). Le travail est la mesure réelle de la valeur échangeable de toutes les marchandises » (« De la richesse des Nations », 1776).
Si le travail est une mesure, rien ne permettrait de mesurer le travail ? Plus de deux siècles plus tard, nous n’avons pas réussi à enfermer le travail dans UNE mesure. Et c’est tant mieux. Tout au plus parvenons-nous à le cerner par ses multiples facettes : sa durée, sa pénibilité, son intensité, la place qu’il prend dans nos vies, etc.
Et pourtant, à intervalle régulier, revient cette tentative de résumer, de synthétiser le travail en une mesure unique. Fin 2007, Xavier Bertrand, alors ministre du Travail, confiait à Philippe Nasse, inspecteur général de l’Insee et vice-président du Conseil de la concurrence et à Patrick Légeron, psychiatre, directeur général du cabinet Stimulus, une mission sur la détermination, la mesure et le suivi des risques psychosociaux au travail. L’une des recommandations de cette mission visait à parvenir à une mesure « scientifique » des RPS. Un collège d’experts présidé par Michel Gollac, sociologue et administrateur de l’Insee, se voyait confié la mission d’élaborer cette mesure. Le collège d’expertise n’est pas tombé dans le piège d’une mesure unique et scientifique. Il a confirmé le caractère multiforme du travail et multifactoriel des RPS en présentant (octobre 2009) une première liste de 40 indicateurs provisoires, réparti entre six dimensions de risques à caractère psychosocial. Cette démarche est sans doute l’effort le plus abouti de mesure sur le travail. En effet, ces six dimensions permettent d’aborder le travail sous ses différentes facettes :
1. les exigences du travail (7 indicateurs) : la quantité de travail, la pression temporelle (4), la complexité du travail, les difficultés de conciliation entre travail et hors travail;
2. la charge émotionnelle, (7 indicateurs) : la relation au public (3), l’empathie, contact avec la souffrance (2), le devoir cacher ses émotions, la peur au travail;
3. l’autonomie et les marges de manoeuvre (8 indicateurs) : autonomie procédurale (2), prévisibilité du travail, utilisation et développement des compétences (4), participation, représentation;
4. les rapports sociaux et relations de travail (13 indicateurs) : la coopération, le soutien social au travail (4), les conflits, harcèlement (5), la reconnaissance des efforts (2), leadership (2);
5. les conflits de valeur (2 indicateurs) : conflits éthiques, qualité empêchée;
6. l’insécurité socio-économique (3 indicateurs) : sécurité de l’emploi, du salaire, de la carrière (2), soutenabilité du travail.
Le second intérêt de cette approche est qu’elle permet d’anticiper l’impact du numérique en examinant ses effets sur chacune des six facettes. Et c’est ici que l’on comprend qu’il sera indispensable d’agir.
1. les exigences du travail : le numérique accroît les exigences, notamment par le biais de la charge mentale ; il raccourcit les délais de traitement et brouille les frontières entre vie professionnelle et vie privée.
2. la charge émotionnelle est accrue par le numérique, notamment par l’effet de la désintermédiation qui multiplie les contacts directs clients-fournisseurs.
3. l’autonomie ne s’accroît que pour une minorité de travailleurs du savoir. Pour les autres, pensons au « voice picking » mis en œuvre dans les gigantesques entrepôts d’Amazon : les opérateurs, équipés d’un casque à microphone, reçoivent en temps réel les instructions qui optimisent leur déplacement pour préparer les commandes des clients. L’asservissement (au sens mécanique du terme) à la technologie est plus criante encore que dans les « Temps modernes ».
Et l’on pourrait poursuivre l’exercice, qui montre que :
1) les impacts de la technologie doivent être anticipés et maîtrisés par le dialogue social. Or ce dernier n’a effectué que de timides incursions dans ce domaine…
2) la mesure du travail sous ses différentes facettes n’est pas seulement un moyen (à combattre) de contrôler les salariés mais peut aussi constituer un observatoire de l’évolution des risques professionnels, utile au progrès social.
Vers un taylorisme 2.0. ?
Le premier aspect sur lequel le numérique change radicalement la donne est la fragmentation et la versatilité du travail. Lorsque Henry Mintzberg a réalisé sa célèbre étude sur les managers (« The Nature of Managerial Work », 1973), il a montré que leurs temps pour chaque tâche duraient en moyenne entre 6 et 15 minutes en raison des interruptions provoquées par des tiers. Comparons à aujourd’hui : une étude du Dr. Gloria Mark de l’Université de Californie montre que l’employé américain est interrompu toutes les trois minutes en moyenne et qu’il lui faut environ 23 minutes pour revenir sur son travail, pour se « reconnecter » à son travail. Les interruptions au travail sont un phénomène connu et largement étudié mais restent un problème à prendre en compte par les RH : selon Deloitte, 75 % des professionnels RH considèrent cette tendance à la « sur-sollicitation » des employés comme un sujet urgent et important. En effet, ces interruptions très rapprochées réclament un méta-travail, un effort pour trouver de la cohérence dans un environnement dispersé. C’est une sollicitation cognitive supplémentaire, une charge mentale additionnelle.
Le second domaine d’impact majeur du numérique est la profusion de données générées par le suivi du travail. La nouvelle ère d’internet est celle des objets (IoT : Internet of Things). L’usine du futur (ou usine 4.0) est peuplée de robots mais aussi de capteurs, qui accumulent les données et les utilisent pour réguler les flux de production, alerter les opérateurs, déclencher des demandes de réapprovisionnement, planifier la maintenance des machines, optimiser la productivité. Dans la santé, on mesure en continu les paramètres sur le patient (lentille qui améliore la vue et mesure le taux de sucre, patch de peau électronique, nano-robot qui circule dans le sang,…) ce qui prépare la prévention et le diagnostic. Dans la maison intelligente, une personne âgée qui tombe sur le sol déclenche automatiquement un signal d’alarme avec le centre de services des ambulances, qui va arriver à temps en se faufilant dans la ville intelligente, en conversant avec les feux de circulation…
L’économie numérique tendra naturellement à renforcer l’évolution actuelle vers une ingénierie informatisée de la performance individuelle. Or dans le même temps, l’entrée dans l’économie de la connaissance requiert davantage de travail collectif. Anne Chemin a dessiné l’avenir proche dans un article récent (« L’entreprise, machine à évaluer ») : « la révolution technologique a transformé l’évaluation en une gigantesque machine à mesurer l’activité humaine. L’informatique permet de tout chiffrer : le temps passé au téléphone avec un client, le pourcentage de progression du chiffre d’affaires, la quantité de marchandises stockée sur un site, le nombre d’opérations réalisées à l’heure, voire à la minute – dans le service d’accueil d’une caisse primaire d’assurance-maladie, les employés doivent ainsi traiter 80 % des appels en moins de 180 secondes ».
Si cet avenir est le nôtre, on peut alors parler de « La tyrannie de l’évaluation » (La Découverte, janvier 2013), selon le mot de la philosophe Angélique del Rey. Elle montre que cette dernière conduit d’autant plus à une impasse qu’elle passe sous silence l’un des éléments-clés de la réussite : le travail collectif. Par ailleurs, cette tyrannie de la mesure du travail est aussi la négation de la complexité du travail. La chercheuse Françoise Dany, professeur de gestion des ressources humaines, citée dans l’article d’Anne Chemin l’exprime avec force : « Il y a pourtant de nombreux éléments, dans le travail, difficiles à mettre en mots, et a fortiori en chiffres : la capacité à faire face à certaines difficultés, la connaissance intime du métier qui va permettre de trouver des solutions originales et de qualité, les savoir-faire et les ficelles que l’on apprend avec l’expérience et qui font que l’activité se passe bien. Ces éléments sont essentiels, mais ils ne peuvent pas rentrer dans les grilles. On ne peut résumer une activité avec des indicateurs. »
Ce constat confirme la conclusion de trois chercheuses, Marie-Ange Cotteret, Anne-Marie Breuil et Danièle Bretelle-Desmazieres, qui constatent que la mesure du travail doit être complétée par un jugement collectif (« Travailler… ou mesurer le travail ? ») : « Avec l’introduction dans les procédés industriels des ‘nouvelles technologies’, dont la conduite et la maintenance induisent de nouvelles tâches et de nouveaux métiers, l’analyse du travail devient plus complexe, la charge physique se doublant d’une charge mentale et d’une charge psychique, toutes deux très difficiles à caractériser. (…) L’objectif des gestionnaires [qui ont supplanté les ingénieurs] est le résultat du travail, et non plus le travail en lui-même. (…) La dimension humaine du travail, qui comporte des aspects non directement quantifiables, ne permet pas de réduire l’évaluation à la seule mesure : on doit combiner la mesure et un jugement collectif ».
Enfin, dernier impact majeur du numérique sur le travail : la nécessaire ré-invention du management (voir sur ce point : « Le management 2.0 sera-t-il socialement responsable ? »).
Conclusion
Le management exprime souvent cette conviction : « Ce qui ne peut pas être mesuré ne peut pas être managé ». A cette conviction, qui n’est ni totalement fausse ni totalement exacte, c’est Albert Einstein qui a donné la meilleur réponse: « Tout ce qui peut être compté ne compte pas forcément et tout ce qui compte ne peut pas forcément être compté ».
Pour éviter de tomber dans les travers d’un taylorisme 2.0 à l’heure où la compétitivité passe de plus en plus par le potentiel d’initiative et de créativité du travail (individuel et collectif), il faudra que le management prenne quelques décisions courageuses et salutaires : mettre un frein à la quantophrénie, compensée par un surcroît de confiance et de qualité de la relation humaine ; revenir à quelques indicateurs simples, concertés avec les parties prenantes de l’entreprise ; prendre le risque de mesurer moins et d’agir davantage.
A propos de l’auteur :
Martin RICHER est consultant en Responsabilité sociale des entreprises. Il a été directeur du marketing d’Oracle, au moment où le Web produisait ses premiers balbutiements…
Pour aller plus loin
Economie collaborative : entre promesses d’avenir et fragilisation des modèles (Metis – octobre 2014)
Numérique : c’est la nature même de l’Etat qui est remise en cause (Metis – septembre 2014)
Les quatre R de l’entreprise 2.0 (Metis – octobre 2014)
Crédit image : CC/Flickr/Sebastiaan ter Burg








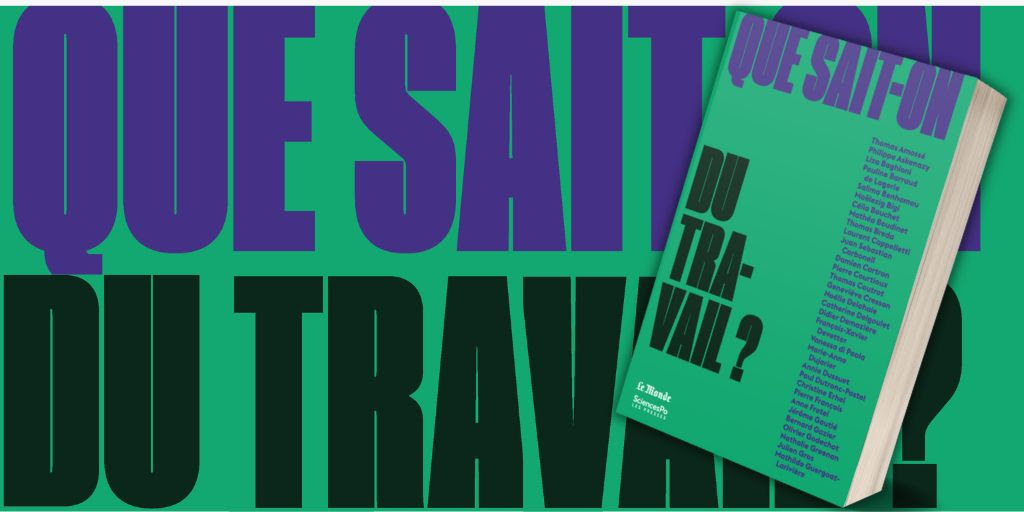

Laisser un commentaire