Bénédicte Zimmermann, Directrice d’études à l’EHESS, propos recueillis par Jean-Louis Dayan et Michèle Tallard
Les travaux de Bénédicte Zimmermann portent, entre autres, sur la dialectique des droits individuels et des possibilités de parcours professionnels et sur la notion de responsabilité dans le travail et la construction des compétences. Elle analyse pour Metis l’évolution vers une responsabilité plus individuelle en matière de formation.

Comme en écho à vos travaux, la loi de 2018 portant réforme de la formation professionnelle s’intitule « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel ». Pensez-vous que ce texte fait avancer la liberté professionnelle des personnes ?
Bénédicte Zimmermann : Par son intitulé aussi bien que par les objectifs qu’elle poursuit, la loi de 2018 pose la question des conditions d’exercice de la liberté dans un monde du travail toujours dominé par le salariat, donc par la subordination. La plupart des travailleurs se trouvent dans une situation de dépendance juridique (vis-à-vis de leur employeur) ou économique (vis-à-vis de leur donneur d’ordre).
Parler de « liberté de choisir son avenir professionnel » pose donc, en soi, question. J’y vois néanmoins une démarche très intéressante. L’enjeu est en effet d’introduire des espaces d’expression et d’affirmation de soi dans le travail et la formation, champs qui souffrent d’un manque patent de marge de manœuvre pour les travailleurs et les travailleuses. Que ce soit dans l’entreprise ou dans les dispositifs de lutte contre le chômage, ce sont des tiers (l’employeur, le conseiller, l’accompagnateur) qui le plus souvent choisissent, directement ou indirectement, pour les personnes concernées. J’ai donc accueilli cette loi avec beaucoup de curiosité et un réel intérêt ; mais j’y ai aussi trouvé beaucoup d’ambivalences.
La plupart de ces ambivalences viennent de ce qu’il existe entre liberté et responsabilité une relation étroite. La liberté ne peut se concevoir indépendamment de la responsabilité qu’elle engendre envers soi-même et les autres. Vouloir accroître la liberté individuelle signifie donc aussi accroître la responsabilité individuelle. C’est pourquoi la loi de 2018 est en même temps une loi de responsabilisation des actifs quant à leur avenir et leur formation professionnelle. Cela invite à réfléchir aux formes que peut prendre cette responsabilité. Le texte fait porter la responsabilité des personnes sur le choix de leur formation et l’adéquation entre les finalités recherchées par la formation et les moyens disponibles. Il responsabilise aussi les actifs dans la recherche de moyens complémentaires, sous la forme d’« abondements », afin de pouvoir entreprendre une formation conforme à leurs aspirations quand son coût excède la dotation de base du compte personnel de formation (CPF), soit 500 euros annuels cumulables sur 10 ans (5 000 euros maximum). Or le coût moyen d’une formation qualifiante est nettement plus élevé. A titre d’exemple, le coût moyen d’un congé individuel de formation (CIF) en Ile-de-France était de 27 000 euros. Cela donne une idée du montant des abondements à trouver. Le titulaire du CPF devient, de ce point de vue, un acteur à part entière d’un système de co-investissement désormais appelé à financer tout le pan de la formation continue qui ne relève pas de l’obligation de l’employeur ou de Pôle emploi. Le système est conçu de telle façon que la contribution individuelle peut se comprendre en temps, mais aussi en argent (l’actif peut décider d’abonder par ses moyens personnels la dotation de son compte). La liberté de choisir doit donc également s’entendre comme liberté de financer.
Le principe de libre choix pose par conséquent la question des moyens accessibles pour exercer non seulement sa liberté, mais aussi sa responsabilité ; ce qui soulève la question de la capacité d’agir des individus. Pour le dire vite, la capacité d’agir se saisit de l’effectivité de la liberté. Elle conditionne la liberté de choisir à l’exigence d’un pouvoir d’agir. A ce titre, elle requiert des ressources, mais aussi la possibilité de convertir ces ressources en réalisations qui soient de valeur pour celui ou celle qui opère le choix. Or on sait que l’accès aux ressources demeure fortement inégalitaire en matière de formation continue. C’est pourquoi la liberté de choisir ne peut se fonder sur la seule responsabilité individuelle, mais appelle une responsabilité sociale qui garantisse à chacun une égale capacité d’agir. Que dit à ce propos le texte de 2018 ? Il esquisse une responsabilité sociale qui s’appuie sur deux types de ressources également accessibles à tous les actifs :
- les 500 € cumulables sur 10 ans qui alimentent chaque année le CPF et qui sont laissés au libre usage de son titulaire. Leur financement par mutualisation (de la contribution obligatoire qui s’impose aux employeurs) présente un caractère de responsabilité sociale ;
- la gratuité de l’accompagnement dans le cadre du Conseil en évolution professionnelle (CEP), qui permet de convertir ces ressources monétaires en capacité d’agir.
La loi prévoit certes d’autres ressources, comme le « CPF de transition » et les abondements du compte personnel, mais elle laisse dans les deux cas subsister beaucoup d’ambiguïté.
Le CPF de transition est censé se substituer au CIF, mais ce serait une erreur de penser qu’il peut véritablement le remplacer : très restrictives, ses conditions d’accès reviennent à réserver son usage à la reconversion de personnes dont l’activité est touchée par des difficultés économiques. Dans le cas du CIF au contraire le choix de changer de métier était indépendant de l’entreprise dans laquelle on travaillait ; de ce point de vue la loi de 2018 a restreint la liberté de choix des personnes, et la création du CPF de transition n’a pas vraiment rouvert les espaces qu’offrait le CIF. Certes ces espaces n’étaient accessibles qu’à un petit nombre de bénéficiaires, mais faute de financements appropriés le CPF ne résout pas non plus ce problème.
Car le mécanisme de l’abondement est lui aussi ambigu, dans la mesure où il laisse la recherche de financements complémentaires à la responsabilité des personnes. Cela soulève une interrogation quant à la nature des réalisations à même d’être poursuivies grâce aux ressources allouées par le CPF. Quel type de formation peut-on atteindre via ce compte ? Si l’on prend la liberté de choisir au sérieux, elle implique de pouvoir poser des choix conformément à ses aspirations ; c’est-à-dire choisir une formation et un avenir professionnel qui fassent sens pour soi-même. La notion de réalisation de valeur est ici essentielle. Il importe dès lors de se demander si avec le CPF les actifs disposent bien des moyens d’atteindre des formations qui ont du sens et de la valeur pour leur avenir. Pour le dire plus prosaïquement : qu’est-ce qu’on peut faire avec (au mieux) 5 000 euros ? Des abondements consistants sont indispensables si l’on veut ouvrir le champ des possibles.
Que faire alors pour aller plus loin ?
Je commencerai par formuler un regret. Etant donné que le co-investissement est une condition de réussite du dispositif, il aurait mérité de faire l’objet d’un débat sans tabous. Il aurait été utile de débattre des contributions possibles des individus, des entreprises, des pouvoirs publics, des partenaires sociaux et des prestataires de formation, afin d’associer l’ensemble des acteurs à la construction de ce co-investissement. Sachant qu’aux contributions en argent des uns peuvent répondre des contributions en temps des autres. Mais s’engager sur cette voie supposait de reconnaître d’entrée de jeu que cette loi porte autant sur la responsabilité que sur la liberté des personnes dans la prise en charge de leur avenir professionnel.
Quoi qu’il en soit, il faut désormais se donner le temps de voir quels effets concrets va avoir cette loi. Le risque est qu’il en résulte une moindre implication des entreprises quant au devenir professionnel de leurs salariés, surtout pour ce qui concerne les formations qualifiantes, et pas simplement d’adaptation au poste. Pour éviter cet écueil, il aurait fallu associer les entreprises autrement qu’à travers la seule mutualisation de leur contribution financière.
Comment aller plus loin ? Je vois trois pistes au moins :
- Instaurer la fongibilité du CPF avec d’autres droits cumulables en cours de vie professionnelle, par exemple ceux acquis au titre du compte épargne-temps (CET) ; c’était l’idée maîtresse du « compte personnel d’activité » créé en 2016. Ce levier est aujourd’hui gelé, mais il ne serait pas bien compliqué de le réactiver.
- Aménager le temps de travail des salariés qui se lancent dans des actions de formation qualifiante, y compris quand il s’agit d’un projet de développement professionnel personnel ; la conciliation des temps est une condition importante de la liberté de choix. Mais un tel aménagement suppose l’implication des entreprises.
- Parfois évoquée, la troisième piste est celle de l’assurance-formation. En rupture avec la logique de capitalisation individuelle de droits au principe du CPF (en dépit de l’existence d’une contribution patronale mutualisée de 1 %), la capacité à se former y serait garantie par une redistribution organisée sous l’égide de l’Etat social. On pourrait ainsi construire un dispositif de responsabilité sociale alimenté non seulement par des cotisations patronales et salariales, selon le modèle classique de l’assurance sociale, mais par des cotisations de l’ensemble des actifs et donneurs d’ordre générant un revenu par le travail.
Cette troisième voie serait à même de garantir un véritable droit à la formation qualifiante différée, ouvert à toute personne en cours de vie active. Mais elle soulève des questions complexes quant aux mécanismes et au type de financement permettant d’en faire bénéficier l’ensemble des actifs et d’assurer la portabilité des droits tout au long de la vie.
En dépit des multiples réformes de l’apprentissage et de l’enseignement professionnel, vous regrettez à ce propos le « gouffre français » qui continue de séparer formation initiale et formation continue. Que faire pour le combler ?
 Encourager le retour en formation longue en cours de vie professionnelle peut y contribuer. Mais la question n’est pas seulement, loin s’en faut, celle de la reprise d’études dans le cadre de la formation continue. Si l’on veut vraiment combler le gouffre, il faut aussi et surtout s’attaquer à la formation initiale. À cet égard, les changements apportés par la loi de 2018 ne sont pas suffisants. La réorganisation de la formation professionnelle initiale (lycée professionnel et apprentissage) ne peut suffire si elle ne s’accompagne pas d’une refonte des filières générales, en particulier si on ne touche pas aux filières dites « d’excellence ». Impossible de revaloriser la filière professionnelle sans combler le gouffre entre les deux voies, professionnelle et générale. Un des enjeux est de reconnaître à l’échelle de la société tout entière que l’excellence peut aussi être professionnellement spécialisée, et d’en tirer les conséquences en matière de rémunérations et de hiérarchies sociales.
Encourager le retour en formation longue en cours de vie professionnelle peut y contribuer. Mais la question n’est pas seulement, loin s’en faut, celle de la reprise d’études dans le cadre de la formation continue. Si l’on veut vraiment combler le gouffre, il faut aussi et surtout s’attaquer à la formation initiale. À cet égard, les changements apportés par la loi de 2018 ne sont pas suffisants. La réorganisation de la formation professionnelle initiale (lycée professionnel et apprentissage) ne peut suffire si elle ne s’accompagne pas d’une refonte des filières générales, en particulier si on ne touche pas aux filières dites « d’excellence ». Impossible de revaloriser la filière professionnelle sans combler le gouffre entre les deux voies, professionnelle et générale. Un des enjeux est de reconnaître à l’échelle de la société tout entière que l’excellence peut aussi être professionnellement spécialisée, et d’en tirer les conséquences en matière de rémunérations et de hiérarchies sociales.
Les formations professionnalisées se sont certes beaucoup développées, y compris dans le supérieur ; pour autant le décrochage entre les deux voies reste patent. On aura beau multiplier les passerelles, on restera dans le bricolage tant qu’on ne se sera pas attaqué aux formations générales dites d’excellence. J’ai conscience d’avoir à ce sujet une position radicale, mais pour moi le gouffre ne sera véritablement comblé que si l’on s’attaque à la conception de l’excellence et qu’on en modifie les voies d’accès, ce qui suppose de revoir en profondeur, voire de supprimer le concept de Grandes écoles et les pratiques qui l’incarnent. Tant que le gouffre éducatif perdure, nous souffrirons du gouffre social qui compromet les parcours ascendants en cours de vie active.
Pour ce qui est des parcours, les politiques sociales accordent beaucoup de place à l’accompagnement. Peut-il garantir la sécurité des parcours et la liberté des choix ?
Il y a depuis quelques années un engouement pour l’accompagnement, mais il ne faut pas l’idéaliser. Un certain nombre de travaux sur l’accompagnement des chômeurs en ont montré les limites, en pointant notamment le rôle déterminant pour la qualité de l’accompagnement des conditions de travail et de développement professionnel des accompagnateurs.
Dans la loi de 2018, l’accompagnement gratuit par le CEP est censé être accessible à tous et contribuer à aplanir les inégalités sociales en matière d’élaboration de projet et de recherche d’abondement. C’est très bien sur le principe. Mais il faut prendre en compte la malléabilité et l’ambivalence des pratiques d’accompagnement (voir à ce sujet les travaux d’Anne Fretel). Où se situe la frontière entre information, proposition et imposition dans le cours de l’accompagnement ? Cette question est d’autant plus cruciale lorsqu’existe une asymétrie sociale entre accompagnant et accompagné, ce qui est souvent le cas. Comment s’opèrent la nécessaire sélection des informations et l’identification des possibles par l’accompagnant ? La question est alors de savoir qui décide de ce qu’est une formation de valeur et pour qui ? L’accompagnant peut de fait jouer un rôle extrêmement important, jusqu’à déposséder l’accompagné de sa liberté à travers le type d’information et d’orientation qu’il va donner. L’accompagnement peut donc être aussi bien une façon de soutenir les individus dans le développement de leur liberté, ou plus exactement de leur latitude d’action, qu’un formidable outil de restriction des libertés individuelles.
Une autre question de fond posée par la montée en puissance de l’accompagnement est celle de son statut hybride entre thérapie individuelle et soutien collectif. En tant que travail sur autrui médié par les politiques publiques, il ouvre un vaste champ d’interrogations. La loi de 2018 en fait clairement une pratique individualisante, associant dans un étrange mélange divan de psy et guichet de banque. Mais l’accompagnement peut aussi être vu comme une expression du collectif, une manière de ne pas laisser l’individu se débrouiller seul avec son compte formation. De quel collectif parle-t-on alors ? Non pas d’un collectif de pairs porteur d’identité, mais un collectif abstrait, médié par des experts, les accompagnateurs, dont le métier est de soutenir les personnes dans la mobilisation des dispositifs prévus par la loi.
L’accompagnement est symptomatique d’un glissement du « collectif » vers la « collectivité » dans la gouvernance du social. À défaut de collectif pourvoyeur d’identité, il incarne le lien avec une collectivité qui exerce son pouvoir normatif par l’entremise de dispositifs techniques (l’application numérique du CPF). Ce déplacement a des conséquences lourdes sur la manière de faire société ; il pose à nouveaux frais la question de ce qui tient ensemble une société. Ne serions-nous pas, avec la logique du compte, en train de basculer d’une conception de la formation comme propriété sociale et source d’affiliation — telle qu’elle était conçue dans la loi de 1971 sur la formation permanente — vers une conception de la formation comme propriété individuelle, qui n’est plus source d’affiliation ni à l’entreprise ni à la société, mais l’expression de la singularité des compétences gestionnaires d’individus, assistés par des outils numériques et des accompagnateurs ? Voilà pourquoi la montée en puissance de l’accompagnement m’interroge beaucoup : il y a là une question sociologique d’importance dont on n’a pas fini de cerner les conséquences.
Faudrait-il imaginer des groupes de pairs de discussion sur la formation, comme ceux que propose Yves Clot pour discuter du contenu du travail ?
Oui, cela pourrait être intéressant, mais ces groupes font référence à l’entreprise, alors que dans la loi « sur la liberté de choisir son avenir professionnel » l’entreprise reste à la marge, puisque l’idée du CPF est plutôt de positionner hors de l’entreprise tout le pan de la formation continue orientée vers le développement professionnel. Le risque est grand de voir se raréfier les scénarios vertueux qu’on a pu observer en la matière dans certaines (grandes) entreprises. Une autre difficulté est que l’entreprise prodigue un espace de débat et d’identification pour ses seuls salariés, alors que l’objet de la loi est précisément de sortir du salariat pour couvrir tous les actifs et les différents statuts susceptibles d’être les leurs au cours d’une vie professionnelle.
Justement, les droits sociaux sont souvent présentés aujourd’hui comme devant être « indépendants du statut » (CPF, Compte personnel d’activité, droit à l’orientation, voire retraite par points). Or comme vous l’observez, ces statuts tendent à se multiplier et à se segmenter. Peut-il y avoir des droits universels sans statut universel ?
Cette question soulève un véritable défi auquel tentent de répondre la portabilité et la fongibilité des droits, au service de la sécurisation des parcours tout au long de la vie. C’est un vrai problème : comment sécuriser les parcours dans des conditions de multiplication des statuts au cours d’une même vie active ? Le CPF essaie d’apporter une première réponse au moyen d’un droit universel à la formation, portable tout au long de la vie active. De ce point de vue la loi de 2018 apparaît comme un laboratoire d’expérimentation d’une nouvelle génération de droits sociaux, dont le CPF fait partie.
Cette expérimentation soulève des questions de fond. Que signifie l’universalité en matière sociale ? Peut-on parler de droits sociaux universels ? L’universalité ne signifie assurément pas égalité sociale. Cette nouvelle génération de droits instaure certes une égalité de traitement qui passe par l’application de règles procédurales identiques pour tous. Cela signifie que ce n’est plus la structuration profondément inégalitaire du monde social et du monde du travail qui fait l’objet des politiques publiques, mais la mise en œuvre de procédures et de règles égales pour tous. A l’œuvre dans la loi de 2018, ce principe est réaffirmé aujourd’hui dans la réforme des retraites.
Affirmer un tel principe d’universalité interpelle la sociologue parce cela revient à faire comme si nous vivions dans une société d’égaux. Mais que deviennent les inégalités de naissance ? D’illustres sociologues ont montré avant moi que tout le monde ne naît pas dans des familles dotées des mêmes capitaux sociaux, culturels, économiques. Et que deviennent les inégalités liées à des accidents de parcours, en particulier en matière éducative, quand on sait que ces accidents sont plus nombreux chez les enfants de familles faiblement dotées ? Que peut le principe d’universalité contre le caractère cumulatif des inégalités et des handicaps sociaux ? C’est là une question décisive.
Sans correctifs (il y en a dans la loi de 2018, par exemple sur le temps partiel, mais bien trop peu), le principe d’universalité peut aller jusqu’à remettre en question le caractère social des droits. Quelle est alors la nature des droits que produisent ces lois ?
L’universalité pose un énorme défi, un défi de réarticulation du politique, du social et de l’économique. Je parle de réarticulation, car la solution au principe de l’Etat social, centrée sur le salariat et le compromis fordiste, était non seulement conditionnée au plein emploi, mais aussi à la stabilité des actifs dans un même statut tout au long de la vie. Les droits universels peuvent s’entendre comme une réponse à ce défi de réarticulation ; mais ils passent à côté d’un problème essentiel, celui d’une cohésion sociale minée par des inégalités sociales grandissantes. Parce qu’ils désocialisent les droits, les droits universels ne suffisent pas à eux seuls à relever ce défi majeur de réarticulation. Au lieu d’inventer une nouvelle manière de faire société, ils vident au contraire le social de sa substance.
Même si, dans un contexte de multiplication des statuts au cours d’une même carrière professionnelle, le principe d’universalité paraît un levier intéressant de sécurisation des parcours, la loi de 2018, pas plus que le projet de réforme des retraites, ne prennent suffisamment à bras le corps ce défi de réarticulation du social, de l’économique et du politique. Le risque est grand d’escamoter sous le voile de l’universalité la question de fond qui est celle la cumulativité des handicaps sociaux et de la redistribution des richesses. Telle qu’elle est conçue dans les textes aujourd’hui, l’universalité nous engage au contraire dans un processus de désocialisation des droits, de dilution du social dans le procédural. Je vois là un danger majeur ; on ne fait pas société uniquement avec de l’égalité procédurale.
Pour en savoir plus :
- Ce que travailler veut dire. Une sociologie des capacités et des parcours professionnels, Economica, collection Etudes sociologiques, 2ème édition, 2014
- « Tous responsables ? Transformations du travail, métamorphoses de la responsabilité », Michel Lallement et Bénédicte Zimmermann, Introduction au Vol. 61 — n° 2 (avril-juin 2019) de Sociologie du Travail — Le travail en quête de responsabilité
- « À la recherche de l’organisation capacitante : quelle part de liberté dans le travail salarié ? », Josiane Véro et Bénédicte Zimmermann, Revue Savoirs 18/2 (n° 47), 2018
- « Sécurisation des parcours et liberté professionnelle : de la “flexicurité” aux capacités », Pascal Caillaud et Bénédicte Zimmermann, Revue Formation Emploi n° 113, janvier-mars 2011
- « Sécuriser les parcours par le compte. Formation continue, droits subjectifs et politiques de la singularité », à paraître dans Bessin M., Cavalli S. et Negroni C. (eds), Le parcours en question, Lille, Presses Universitaires du Septentrion, 2020.








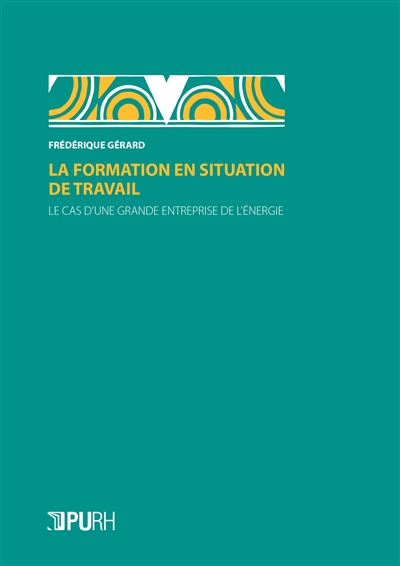

Bonne et heureuse année…de réflexions, d’analyses et de réalisations
Je partage complétement cette interrogation.
« Non pas d’un collectif de pairs porteur d’identité, mais un collectif abstrait, médié par des experts, les accompagnateurs, dont le métier est de soutenir les personnes dans la mobilisation des dispositifs prévus par la loi. »
Et comme Bernadette Zimmerman connaît bien les Groupements d’Employeurs, je pense que l’on peut considérer qu’ils construisent pour les branches, les territoires et les personnes, ce « collectif de pairs » porteurs de solutions qui, contribuent à mettre un coin dans le rapport de subordination, prennent en compte la liberté et la responsabilités des personnes (salariés comme employeurs) et qui tout au long de la vie sont des lieux -des refuges?- qui prennent en compte tout à la fois la dignité de chacun et son émancipation.
Le CRGE a montré, avec la proposition d’accord collectif régional en Nouvelle Aquitaine pour les salariés des GE, accord débattu et négocié par les partenaires sociaux et reconnu par le Ministère qu’il vaut bien mieux, (l Etat, la Région, les Partenaires Sociaux et les GE co-produisent le CRGE) responsabiliser les acteurs plutôt que, comme pour les contrats courts, introduire des pénalisations qui ne sont utiles à personne.
Le GE devient une entreprise à part entière. L’entreprise de l’emploi et de la formation tout au long de la vie…et pourquoi pas outil de gestion du revenu universel.
En 2020, comme l’Universel est de retour profitons en pour faire vivre ce que proclamait le poète TORGA
« L’universel c’est le local moins les murs »
France Joubert